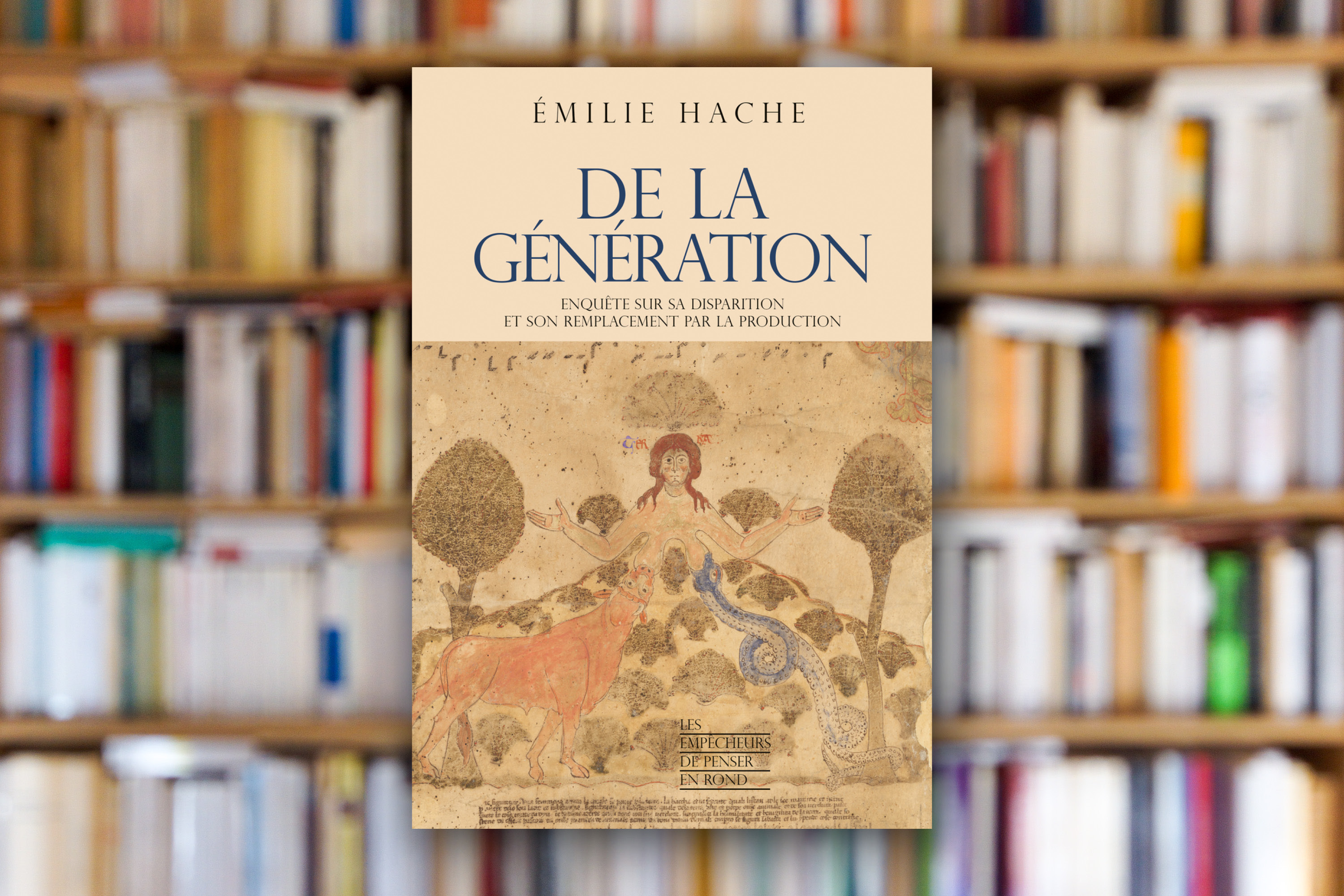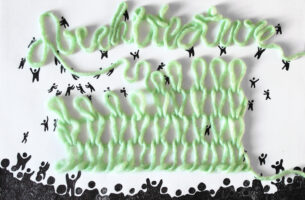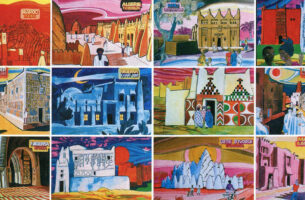Introduction
Alors que la situation environnementale témoigne d’une sérieuse défaillance de l’humanité à reproduire les conditions d’habitabilité du monde, la philosophe Émilie Hache a ces dernières années senti le besoin d’explorer les angles morts de deux théories singulières de la pensée écologique qui avaient la particularité d’établir des liens avec des enjeux de genre.
D’une part, coordinatrice de plusieurs ouvrages sur l’écoféminisme – qui dénonce depuis les années 70 l’exploitation conjointe des femmes et de la nature – l’autrice faisait face à une critique majeure : ce lien présupposé serait une forme d’essentialisation féminine. Une tension qui nécessitait selon elle non seulement de dénouer l’histoire et l’origine de ce lien, mais aussi de se demander s’il incarnait une dimension capacitante ou condamnante pour les deux composantes. D’autre part, un étonnant postulat avancé par Ivan Illich dans le Genre vernaculaire l’avait semble-t-il profondément intéressée. Dans cet essai publié en 1983, le philosophe avait établi une corrélation entre la disparition des interdépendances de genre propres aux sociétés de subsistance (le « monde paysan ») et celle de l’autolimitation humaine dans sa prédation sur l’environnement.
Fruit de dix ans de recherches, nourri de théologie, d’ethnologie, d’histoire et d’hellénisme, ce texte éminemment documenté s’attache ainsi à démontrer les racines chrétiennes de la destruction des pratiques paysannes de (ré)génération, dans une forme de dialogue et de prolongement du texte d’Illich. Dans cette réflexion d’Émilie Hache, la notion de (ré)génération recouvre les pratiques de soin, de renouvellement et de reproduction permettant la perpétuation de l’habitabilité des milieux de vie humains : agriculture, soin des choses et des personnes. Par une foisonnante exploration à travers les millénaires, l’autrice cherche à identifier les origines conjointes de la dépréciation opérée par la société vis-à-vis des connaissances spécifiques des femmes – issues des expériences qu’implique leur physiologie – et de ces pratiques de soin à l’égard du milieu (au sens écologique et social), en s’attardant sur trois grandes périodes historiques occidentales qui en seraient les principaux fondements.
L’assimilation essentialisante de la féminité à la nature trouverait selon elle de premières sources dans l’antiquité grecque, dont certains éléments mythologiques et rituels, mis au jour dans les cercles restreints de chercheurs hellénistes, lui permettent d’exhumer divers mythes fondateurs qui auraient forgé assez tôt les bases d’une différenciation importante des deux genres vis-à-vis de la question de la fécondité et de la naissance : primordiale et spirituelle chez les hommes, « bassement » organique chez les femmes… Si elle a identifié que d’autres mythes, plus égalitaires, avaient également existé à cette époque, Émilie Hache constate qu’ils n’ont étrangement pas été autant propagés à travers les siècles.
Centrale dans cet ouvrage, l’ère chrétienne est le second volet de cette réflexion, décortiquée de son avènement à sa dilution dans la civilisation moderne (sécularisation). Mettant en lien divers travaux de recherches plus ou moins restés confinés dans le milieu académique, elle s’attache à montrer comment le créationnisme chrétien a jeté les bases théoriques de notre crise écologique en générant un détachement décomplexé vis-à-vis de la nécessité de soin à l’égard de notre environnement et de ceux qui partagent notre condition terrestre. La société étant passée d’un « monde non créé dont il faut prendre soin et renouveler chaque jour » à une rhétorique créationniste « où la providence s’occupe de tout », alors que la dégradation des milieux opérée par une approche consumériste des ressources nous prouve aujourd’hui qu’un « monde [habitable par les humains] ne se maintient pas dans l’existence par lui-même ».
Après l’avoir déjà constaté dans l’Antiquité grecque, Émilie Hache nous montre aussi comment le christianisme a également cherché à rompre avec la dimension organique de la génération, par une abstraction et une spiritualisation trahissant une dépréciation des processus naturels. À la fois dans sa promotion de l’abstinence, « proclamant sa confiance dans ses propres moyens de s’assurer une existence perpétuelle », mais aussi et surtout dans une tentative de substitution de la fonction maternelle par l’Église, supposée pouvoir assurer la génération spirituelle, seule digne de considération. Il est passionnant de lire la démonstration qu’elle propose des processus de dévitalisation du vocabulaire charnel par l’Église, détournant consciemment les éléments de description organique du monde. Elle montre aussi comment la promotion idéologique d’engendrements sans génération physique – comme celle de Jésus, né d’une mère vierge – fut aussi une façon discrète d’en évincer les femmes, et par cette occasion de faire disparaître l’expérience genrée et féminine du monde. Pour elle, cette volonté se trahit aussi dans la disparition des divinités féminines (très nombreuses et importantes dans les religions polythéistes), au profit d’un Dieu unique masculin prenant en charge les attributions de l’ensemble des divinités antiques, dont celles des déesses. Elle montre comment la philosophie mécaniste associée à la civilisation moderne en a hérité, dénigrant les compétences spécifiquement féminines, alors appropriées par les hommes, ouvrant ainsi le champ libre à la concurrence entre les genres mise au jour par Illich. L’« équité baptismale des sexes » devant Dieu (la communauté chrétienne est indifférenciée dans le culte) aurait en fait signé l’avènement d’une société certes unisexe, mais sexiste.
Exhumant de nombreuses recherches historiques peu diffusées, Émilie Hache se penche ensuite longuement sur l’Inquisition et la « chasse aux sorcières » des XVe au XVIIe siècles, montrant comment celle-ci a engendré une destruction progressive des sociétés de subsistance et de ses pratiques régénératives, accusées de concurrence païenne à la générosité divine. En lieu et place de la complexité relationnelle vernaculaire – qui impliquait des liens d’interdépendance à l’autre genre, aux saisons, aux animaux, à la fertilité de la terre ; et qui avait trait, il est vrai, à une certaine part de mystère et d’incompréhension – la chasse aux « sorcières » permit l’avènement d’un modèle décontextualisé, partiel et simplifié de régénération mécaniste (logique des intrants, sans considération des relations écosystémiques), qu’elle considère à l’origine des errements de notre agriculture moderne. La philosophe fait en effet un rapprochement intéressant en constatant que cette façon d’avoir retiré aux femmes et aux hommes tout « pouvoir génératif-cosmologique » serait concomitante du « moment où s’affirmait et s’organisait le pouvoir des États monarchiques européens autour de la privatisation des communaux, de la colonisation des Amériques et de l’émergence de l’économie de marché ».
L’ère coloniale est pour cause la troisième période dont Émilie Hache nous propose un décryptage passionnant. L’autrice nous démontre comment le colonialisme a légitimé l’infinité des ressources revendiquée par l’approche créationniste du christianisme : « La fécondité infinie de providence divine s’est incarnée dans l’abondance américaine qui a sidéré les Européens » lors de leur découverte des terres infinies et (faussement) inhabitées de l’outre-Atlantique, perçues comme l’incarnation d’un « Royaume du Ciel sur la Terre ». Selon elle, l’impérialisme a créé un monde « qui a oublié qu’il avait besoin de se reproduire pour exister, un monde se considérant sans limite parce que croyant reposer sur des réserves infinies d’énergie, de terres ou encore de bras », mais qui s’appuyait en vérité « sur des vies humaines, des terres et des ressources pour croître au prix de la destruction généralisée du monde ». A l’heure où le monde entier aspire au même niveau de confort et de droit, les crispations identitaires et les tensions politiques entre anciennes colonies et pays européens montrent bien aujourd’hui à quel point « le régime économique de surabondance [ne pouvait fonctionner que] tant que la majorité de celles et ceux qui (re)produisent la richesse de l’empire colonial [étaient] exclus du corps de la nation », constate la philosophe. Elle est également convaincue que les sévères déséquilibres écologiques témoignent quant à eux du fait que « l’opulence qui gouverne le monde économique colonial unisexe ne peut se maintenir si l’humanité tout entière comme l’ensemble du monde vivant sont pris en compte ».
Au-delà de cette longue exploration historique, le propos devient aussi particulièrement intéressant dans sa dernière partie, où Émilie Hache s’attache à chercher des pistes prospectives pour échapper au dilemme dans lequel Illich était resté coincé. « Si la destruction du genre vernaculaire a entraîné la destruction de toutes limites, qu’est-ce qui peut la remplacer et enrayer l’illimitisme de nos sociétés unisexes économisées ? […] Comment retrouver une perspective générative de subsistance post-genrée ? », se demande-t-elle. Aussi incomprise qu’insatisfaisante aux yeux des féministes, la théorie d’Illich n’était en effet pas parvenue à s’extraire d’un dualisme stérile et rétrograde entre deux modèles tous deux aussi peu engageants : le modèle vernaculaire « genré patriarcal » et le modèle moderne « unisexe sexiste »… Alors qu’il n’y a en fait « aucune raison de penser que toutes les sociétés vernaculaires [auraient été] patriarcales », suggère l’autrice, convaincue que d’autres civilisations ont pu être plus inventives que la nôtre pour imaginer des modalités collectives de soin et d’équité à l’égard des milieux de vie et de ceux qui partagent notre condition terrestre. Émilie Hache s’attaque pour ce faire au champ de l’ethnologie, qui fut longtemps inconscient de ses biais culturels et/ou androcentrés, invisibilisant pendant plusieurs siècles l’existence moderne et contemporaine de sociétés matriarcales (terme dont elle prend soin de réinterroger la pertinence et la définition) et/ou alloparentales (parentalité communautaire), qui recelaient pourtant des ressources organisationnelles passionnantes pour penser la régénération collective de nos milieux et de nos organisations sociales.
Émilie Hache (2024), De la génération. Enquête sur sa disparition et son remplacement par la production, « Les empêcheurs de penser en rond », La Découverte, 277 pages, 21 euros.