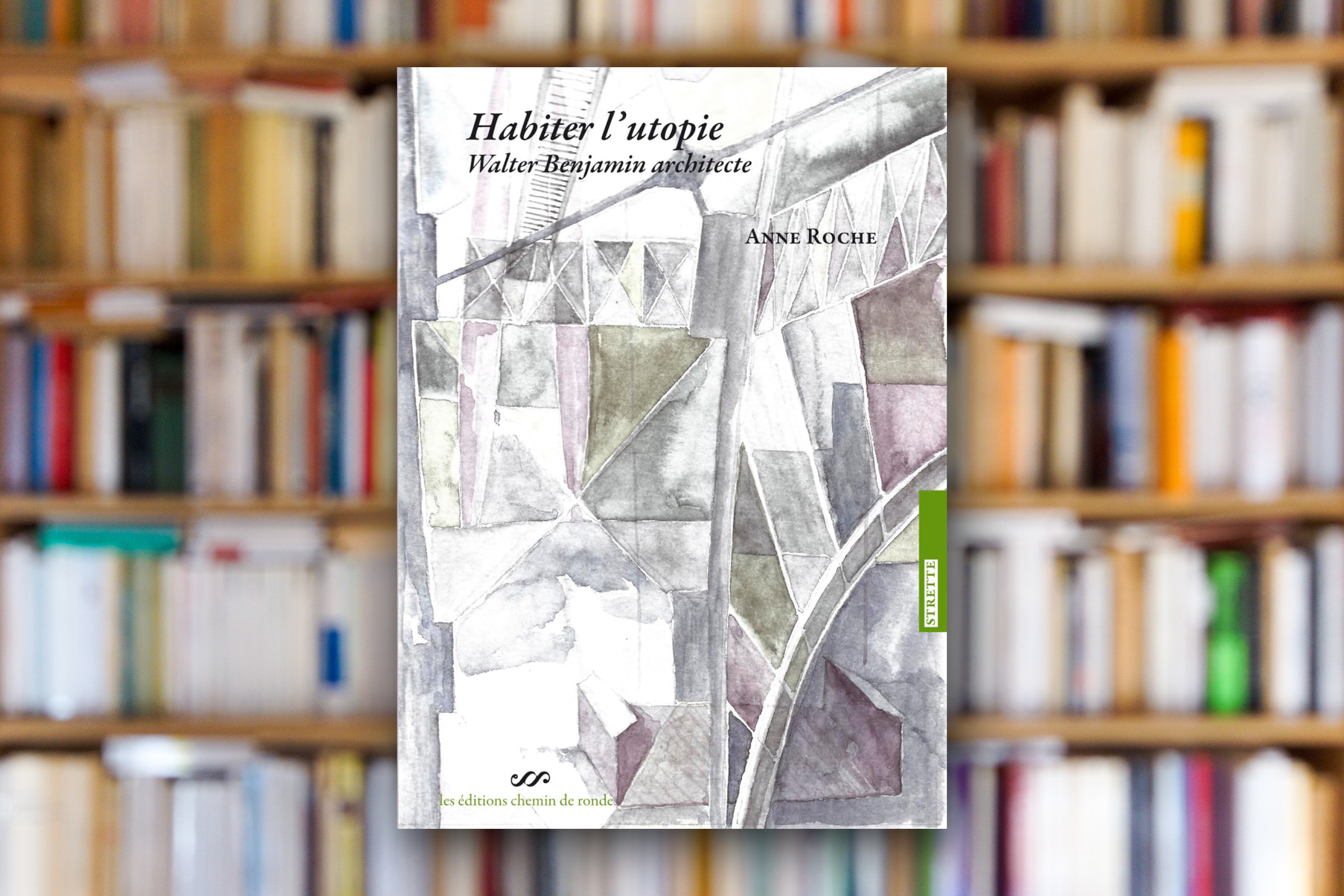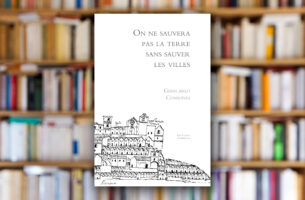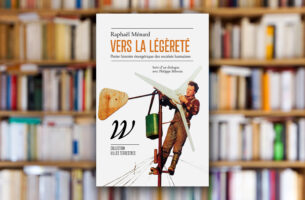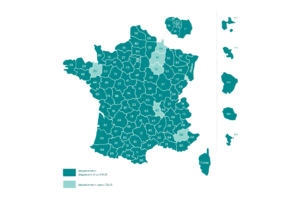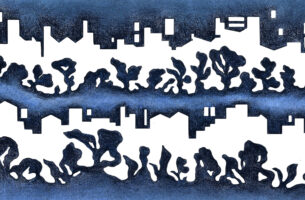Introduction
L’on connait la fin tragique de Walter Benjamin (1892-1940), son suicide pour échapper aux nazis, à Portbou en Espagne. L’on connait aussi son énorme ouvrage inachevé, Paris, capitale du XIXe siècle. Le livre des passages. Il est aussi traducteur en allemand de Balzac, Baudelaire, Paul Valéry, Saint-John Perse, Proust... Si son œuvre a fait l’objet d’études sérieuses, d’analyses de son « concept d’histoire », de sa notion d’« aura », de ses recherches sur Paris et en particulier de celle sur la figure du « flâneur », sa compréhension de l’architecture et des villes attendait un essai conséquent, puisant dans tous ses écrits, le voici. Anne Roche est familière des textes de Benjamin, sur lesquels elle a déjà beaucoup écrit. Là, elle veut en savoir davantage sur les liens qu’il établit, ou non, avec l’architecture de son époque (fin XIXe- XXe siècles), qui connait d’importants changements avec la généralisation de nouveaux matériaux (le fer, le verre, le béton), l’apparition de l’ingénieur qui concurrence l’architecte, l’organisation fonctionnelle des villes et des logements, etc. Le corpus est impressionnant et Anne Roche s’y plonge avec délectation, d’où un essai à l’écriture fluide, aux innombrables références jamais indigestes ou prétentieuses. Elle enquête en créant une complicité avec le lecteur qui l’accompagne dans sa recherche comme dans une promenade vagabonde. Du reste elle commence par la marche, que le petit Walter apprend tout seul et qu’il pratiquera toute sa vie, arpentant les trottoirs de Berlin, Paris, Moscou, Ibiza, Marseille, Naples. Marchant, il observe. Observant, il note. Notant, il questionne. Questionnant, il pointe, ce qui lui manque pour décrire la situation architecturale ou urbaine qu’il aimerait partager... Le chantier est ouvert. Et vaste. Comment rendre compte de tout ce qu’il emmagasine, de toutes ses lectures, de toutes ses impressions d’explorateurs ?
Il s’intéresse à la technique, en particulier le verre et donc la transparence, ce qui permet à Anne Roche de s’attarder sur Paul Scheerbart, auteur en 1914 de L’Architecture de verre, or Benjamin, lui, commente surtout son récit de science-fiction, Lesabéndio. Ein Asteriden-Roman, publié en 1913, qui accorde à la technique la possibilité de changer les humains. Il n’est pas certain que Benjamin le suive sur cette voie, même s’il trouve que la transparence abolit la clôture des maisons en pierre et annonce le « plan libre » de Le Corbusier. La transparence ne lui apparaît pas alors comme l’intrusion dans la sphère privée du logement, une anticipation de la vidéosurveillance... Cette question de la technique, qu’il aborde avec les ouvrages de Sigfried Giedion, secrétaire des CIAM, Anne Roche la développe en fin de volume en confrontant Benjamin à Heidegger.
En 1932 Walter Benjamin séjourne à Ibiza. La vie y est moins chère qu’en Allemagne ou à Paris, il peut y travailler tranquillement, tout en bénéficiant d’un climat clément (il se baigne et se sèche au soleil) et d’un paysage agréable, « le plus intact que j’aie jamais trouvé. » L’architecture vernaculaire, « archaïque », simple et commode l’enchante. Elle intéresse aussi les jeunes architectes du Groupe d’Architectes et de Techniciens Catalans pour le Progrès de l’Architecture Contemporaine (GATCPAC) qui apprécient ces cubes épurés aux volumes modulaires si confortables, été comme hiver. Il y revient l’année suivante et assiste, impuissant, à la modernisation de l’île et avec elle, à la dévalorisation du vernaculaire. Heureusement le site conserve sa beauté sauvage. Ce qui le conduit, une fois de plus, à réfléchir au « progrès » technique qui parfois améliore la vie des gens et plus fréquemment ne génère aucun « progrès » social, tant la logique du capitalisme s’avère dévastatrice...C’est encore le « progrès » dans la construction dont il est question avec Adolf Loos et ses considérations sur l’ornement, qui mène « de la réalité sociale à la réalité naturelle et biologique », qui, rappelle Anne Roche est « un des marqueurs de l’idéologie nazie ».
À Marseille, qu’il affectionne, Walter ne se contente pas d’y flâner, il fouille aux archives et veut tout dire d’elle, or elle résiste : « J’ai lutté là comme avec aucune autre ville. Il est plus dur, pourrait-on dire, d’en arracher une phrase que de tirer de Rome un livre. » Pourtant il la décrit précisément, ainsi lorsqu’il passe rue de Lyon : « La mine que Marseille a creusé dans le paysage pour la faire exploser à Saint-Lazare, Saint-Antoine, Arenc et Septèmes, et l’enterrer sous les éclats de grenade de toutes les langues de la géographie et du négoce : Alimentation moderne, rue de la Jamaïque, Comptoir de la Limite, Savon Abat-Jour, Minoterie de la Campagne, bar du Gaz, bar Facultatif. » De Moscou, où il reste plusieurs mois, ce sont les transformations sociales et politiques qui l’emportent sur les observations d’ordre architectural. Les églises sont nombreuses et confèrent à leur quartier des allures villageoises. Il visite l’ancien couvent Saint-Serge : « J’ai parcouru des pièces remplies d’étoles recouvertes de pierres précieuses, (...) des icônes innombrables de toutes époques garnies d’un revêtement d’or, d’où les têtes de Madones émergent comme d’un carcan chinois. (...) On dirait une chambre froide où une ancienne culture se conserve sous glace pendant la canicule révolutionnaire. » Et puis Naples, dont il ignore le port, et puis Berlin, qu’il parcourt à hauteur d’enfant, et puis Paris, où il revient régulièrement pour dévorer avec gourmandise sa topographie. Les démarcations, les passages, les coupures ferroviaires, les berges du fleuve, les continuités bâties, les rares ruptures jardinées, tout cela le conduit à un constat : « Nous sommes devenus très pauvre en expériences de seuil. » Toute ville est vécue avant d’être analysée, il faut la vivre, jour et nuit, dans ses silences comme dans sa cacophonie, dans ses rues désertes, comme dans ses boulevards encombrés, avec ses murs bavards d’affiches publicitaires ou silencieux de façades aveugles... C’est cela qui séduit Walter Benjamin, le mobilise, l’invite à toujours aller voir en elle ce qui l’étonne et réconcilie, ou oppose, son présent à son passé.
Voici un remarquable ouvrage d’une grande richesse, impossible à résumer, d’autant qu’Anne Roche n’hésite pas à quitter son auteur pour voir s’il nous parle encore quatre-vingts ans après sa disparition, à l’heure de nouveaux enjeux environnementaux et sociétaux. Elle qui la tant lu et médité, apprend-elle encore en le relisant ? Elle laisse Benjamin répondre : « Le décisif n’est pas la progression de la connaissance, mais la fêlure à l’intérieur de chacune d’elles. Imperceptible marque d’authenticité, qui la distingue de toute marchandise fabriquée en série, faite sur un modèle. »
Anne Roche, Habiter l’utopie. Walter Benjamin architecte, Cadenet, les éditions Chemin de ronde, 2025, 368 pages, 25 euros.