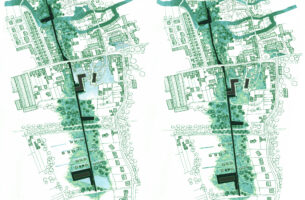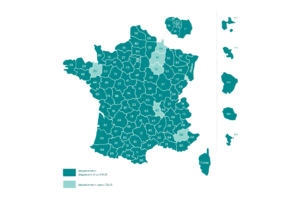Introduction
1984, le Royal Institute of British Architects célèbre son 150e anniversaire. Ivan Illich est invité à prononcer une conférence, elle s’intitule : « l’Art d’habiter ». À une assemblée composée d’architectes, il déclare que l’art d’habiter est hors de leur portée, qu’ils ne peuvent que construire. « Habiter est le propre de l’espèce humaine » affirme-t-il, or les humains n’habitent plus, ils sont logés, c’est-à-dire qu’ils vivent dans un environnement qui a été planifié, construit et équipé pour eux. Les logés traversent « l’existence sans laisser de trace » en se contentant du garage à humains qu'on leur impose ! Habiter est un art et nous sommes des artistes, alors revendiquons non un « droit au logement » mais notre liberté d’habiter.
Habiter est le propre de l’espèce humaine. Les animaux sauvages ont des terriers, les chariots rentrent dans des remises et il y a des garages pour les véhicules automobiles. Seuls les hommes peuvent habiter. Habiter est un art. Une araignée naît avec l’instinct de tisser une toile particulière à son espèce. Les araignées, comme tous les animaux, sont programmées par leurs gènes. L’humain est le seul animal à être un artiste, et l’art d’habiter fait partie de l’art de vivre. Une demeure n’est ni un terrier ni un garage.
La plupart des langues emploient le terme vivre dans le sens d’habiter. Poser la question « Où vivez-vous ? », c’est demander en quel lieu votre existence façonne le monde. Dis-moi comment tu habites et je te dirai qui tu es. Cette équation entre habiter et vivre remonte aux temps où le monde était encore habitable et où les humains l’habitaient. Habiter, c’était demeurer dans ses propres traces, laisser la vie quotidienne écrire les réseaux et les articulations de sa biographie dans le paysage. Cette écriture pouvait être inscrite dans la pierre par des générations successives ou reconstruite chaque saison des pluies avec quelques roseaux et des feuilles. Jamais la demeure n’était achevée avant d’être occupée — contrairement au logement contemporain, qui se délabre dès le jour même où il est prêt à être occupé. Une tente, il faut la réparer chaque jour, la dresser, l’assujettir, la démonter. Une ferme croît et décroît selon l’état de la maisonnée : là voit-on depuis une colline voisine qu’on peut souvent discerner si les enfants sont mariés, si les vieux sont déjà morts. Une bâtisse se perpétue d’un vivant à l’autre ; des rites en marquent les étapes importantes : il peut s’être écoulé des générations entre la pose de la pierre angulaire et l’équarrissage des chevrons. Pareillement, un quartier urbain n’est jamais terminé ; encore au XVIIIe siècle, les quartiers populaires défendaient leur art particulier d’habiter en s’ameutant contre les améliorations que les architectes s’efforçaient de leur imposer. L’art d’habiter fait partie intégrante de cette économie morale si bien décrite par E.P. Thompson. Il a succombé devant les avenues royales qui ont éventré les îlots au nom de l’ordre, de la propreté, de la sécurité et du decorum. Il a succombé devant la police qui, au XIXe siècle, a donné des noms aux rues et des numéros aux maisons. Il a succombé devant les professionnels, qui ont introduit les égouts et les réglementations. Il a été quasiment supprimé par l’économie du bien-être qui a exalté le droit de chaque citoyen à son garage et à son récepteur de télévision.
Habiter, c’était demeurer dans ses propres traces, laisser la vie quotidienne écrire les réseaux et les articulations de sa biographie dans le paysage.
L’art d’habiter est une activité qui dépasse la portée de l’architecte. Non seulement parce que c’est un art populaire ; non seulement parce qu’il progresse par vagues qui échappent au contrôle de l’architecte ; non seulement parce que sa délicate complexité le situe hors de l’horizon des simples biologistes et analystes des systèmes ; mais, plus que tout, parce qu’il n’existe pas deux communautés faisant leur habitat de la même façon. Habitude et habitat disent presque la même chose. Chaque architecture vernaculaire (pour reprendre le terme des anthropologues) est aussi unique que le parler vernaculaire. L’art de vivre dans son entièreté — c’est-à-dire l’art d’aimer et de rêver, de souffrir et de mourir — rend unique chaque style de vie. Et cet art est donc beaucoup trop complexe pour être enseigné par les méthodes de Comenius ou de Pestalozzi, par un instituteur ou par la télévision. C’est un art qui ne s’acquiert que progressivement. Chaque être devient un parleur vernaculaire et un constructeur vernaculaire en grandissant, en passant d’une initiation à l’autre par un cheminement qui en fait un habitant masculin ou féminin. Par conséquent l’espace cartésien, tridimensionnel, homogène, dans lequel bâtit l’architecte, et l’espace vernaculaire que l’art d’habiter fait naître, constituent des classes différentes d’espace. Les architectes ne peuvent rien faire d’autre que construire. Les habitants vernaculaires engendrent les axiomes des espaces dans lesquels ils font leur demeure.

Le consommateur contemporain d’un espace de logement vit topologiquement dans un autre monde. Les coordonnées de l’espace occupé dans lequel il se situe sont le seul univers qu’il connaisse d’expérience. Il lui est impossible de croire que le Peul menant ses bœufs, le Dogon accroché à ses falaises, le Songhaï pêcheur et le Bobo cultivateur vivent dans des espaces hétérogènes qui s’inscrivent dans le même paysage (selon la vision qu’en ont les écologistes). Pour le logé moderne, un kilomètre est un kilomètre, et après chaque kilomètre s’en étire un autre, parce que le monde n’a pas de centre. Pour celui qui fait sa demeure, le centre du monde est l’endroit où il vit, et la proximité peut se situer à vingt kilomètres en amont du fleuve plutôt qu’à deux kilomètres dans le désert. Selon nombre d’anthropologues, la culture de ce dernier infléchit sa vision. En fait, elle détermine les caractères distinctifs de l’espace qu’il habite.
Le logé a perdu énormément de son pouvoir d’habiter. La nécessité dans laquelle il se trouve de dormir sous un toit a pris la forme d’un besoin défini culturellement. Pour lui, la liberté d’habiter n’a plus de sens. Ce qu’il lui faut, c’est le droit d’exiger un certain nombre de mètres carrés dans de l’espace construit. Il apprécie ce droit et s’en prévaut. L’art de vivre lui est confisqué : il n’a nul besoin de l’art d’habiter, mais seulement d’un appartement ; de même, il n’a nul besoin de l’art de souffrir car il compte sur l’assistance médicale, et il n’a probablement jamais songé à l’art de mourir.
Le logé vit dans un monde qui a été fabriqué. Il n’est pas plus libre de se frayer un chemin sur l’autoroute que de percer des trous dans ses murs. Il traverse l’existence sans y inscrire de trace. Les marques qu’il dépose sont considérées comme des accrocs — des signes d’usure. Ce qu’il laisse derrière lui, ce sont des détritus qu’enlèveront des bennes. L’environnement faisait partie des communaux pour des « habitants » ; il est redéfini comme une ressource pour la production de garages abritant des êtres humains, des biens de consommation et des véhicules. Le logement assigne aux gens des casiers de résidence. Il est planifié, construit et équipé pour eux. Être admis à résider minimalement dans son propre logement constitue un privilège particulier ; seuls les riches ont la latitude d’y déplacer une porte ou d’y planter un clou dans le mur. Ainsi l’espace vernaculaire de la demeure est remplacé par l’espace homogène d’un garage humain. Les grands ensembles ont le même aspect à Taïwan ou dans l’Ohio, à Lima ou à Pékin. Partout vous trouvez les mêmes garages à humains — des casiers où entreposer la force de travail pendant la nuit, toute prête à être convoyée vers son emploi. Les habitants occupant l’espace qu’ils modèlent ont été remplacés par des résidants abrités dans des constructions produites à leur intention, dûment enregistrés en tant que consommateurs de logement protégés par la législation sur les contrats de location ou sur les prêts hypothécaires.
Dans la plupart des sociétés, être hébergé est un signe de dénuement : l’orphelin est recueilli, le pèlerin hébergé, le condamné emprisonné, l’esclave enfermé la nuit, et le soldat — mais seulement depuis le XVIIIe siècle — cantonné dans une caserne. Auparavant, même l’armée devait pourvoir par ses propres moyens à son habitat en dressant des campements. La société industrielle est la seule qui s’efforce de faire de chaque citoyen un élément qu’il faut abriter et qui est donc dispensé du devoir de cette activité communautaire et sociale que j’appelle l’art d’habiter. Ceux qui, aujourd’hui, revendiquent leur liberté d’habiter par leurs propres moyens sont soit fortunés, soit traités en déviants. Cela se vérifie aussi bien chez ceux à qui le prétendu développement n’a pas encore désappris le désir de faire leur demeure que chez les « débranchés » qui cherchent de nouvelles formes d’habitat qui rendraient le paysage industriel habitable — au moins dans ses brèches et ses zones grises.
Aussi bien le non-modernisé que le post-moderne contestent le véto de la société face à l’auto-affirmation spatiale, et il leur faudra compter avec l’intervention policière contre la nuisance qu’ils créent. Ils seront stigmatisés en tant qu’intrus, occupants illégitimes, anarchistes et fléaux, selon les conditions dans lesquelles ils affirment leur liberté d’habiter : témoins les Indiens qui, à Lima, pénètrent dans des terres en friche et s’y installent ; les favellados qui, à Rio de Janeiro, reviennent occuper la colline dont la police vient de les expulser alors qu’ils l’habitent depuis quarante ans ; les étudiants qui osent faire leur demeure dans les ruines du quartier berlinois de Kreuzberg ; les Portoricains qui reviennent s’installer dans des immeubles incendiés et murés du South Bronx à New York. Ils seront tous expulsés, moins parce qu’ils causent du tort au propriétaire des lieux ou parce qu’ils menacent la paix ou la salubrité du quartier, que parce qu’ils récusent l’axiome social qui définit le citoyen comme un élément nécessitant un casier de résidence standard.
La tribu indienne qui, des Andes, descend dans les faubourgs de Lima, ou le conseil de quartier qui, à Chicago, se débranche des services urbains du logement, constituent une provocation par rapport au modèle régnant du citoyen en tant qu’Homo castrensis, l’homme cantonné. Mais, avec leurs récusations, le nouvel arrivant ou le débranché provoquent des réactions opposées. Les Indiens, on peut les traiter comme des païens qu’il faut éduquer à apprécier avec quelle sollicitude maternelle l’État veille à les abriter. Le débranché est beaucoup plus dangereux : il témoigne des effets castrateurs de l’étreinte maternelle de la ville. À la différence du païen, ce genre d’hérétique met en question l’axiome de la religion civique sous-tendant toutes les idéologies actuelles qui, en surface, sont antagonistes. Selon cet axiome, le citoyen, en tant qu’Homo castrensis, a besoin d’un bien de consommation appelé « logement » ; son droit au logement est inscrit dans la législation. Ce droit, le débranché ne le conteste pas, mais il objecte aux conditions concrètes qui mettent le droit au logement en conflit avec la liberté d’habiter. Et pour le débranché, cette liberté, si le conflit se matérialise, est jugée plus précieuse que le bien de consommation « logement », rare par définition.
Quel gouvernement renoncerait au pouvoir énorme que lui confère l’idéologie de l’homme naturellement « cantonné » ?
Mais le conflit entre valeurs vernaculaires et valeurs économiques n’est pas limité à cet espace qu’on appelle un intérieur. Considérer que les effets de l’art d’habiter se limitent à modeler cet intérieur serait une erreur ; ce qui s’étend au-delà du seuil de notre porte d’entrée est tout aussi modelé par cet art, bien que d’une façon différente. La terre humaine s’étend des deux côtés du seuil ; le seuil est comme le pivot de l’espace que crée l’art d’habiter. De ce côté, c’est le chez-soi ; de l’autre, les communaux. L’espace qu’occupent les maisonnées leur est commun. Il abrite la communauté, comme la demeure abrite les membres de la maisonnée. De même qu’il n’existe pas deux communautés ayant le même style d’habitat, il n’en est point qui aient des communaux semblables. La coutume régit l’accès aux communaux : qui peut les utiliser, comment, quand et dans laquelle de leurs parties. De même que la maison reflète dans sa forme le rythme et la dimension de la vie familiale, les communaux sont la trace de la communauté. Il ne peut y avoir d’art d’habiter en l’absence de communaux. Il faut du temps à l’immigré pour comprendre que les voies routières ne sont ni des rues ni des chemins mais des ressources réservées au transport. J’ai vu bien des Portoricains à qui il avait fallu des années pour découvrir que les trottoirs de New York ne sont pas des extensions d’une Plaza. En Europe, au désespoir des bureaucrates allemands, les Turcs installent leurs chaises sur le trottoir pour bavarder, parier, faire une transaction, boire un café, tenir un étal. Il leur faut bien du temps avant de renoncer aux communaux, de reconnaître que la circulation est aussi mortelle pour le commerce que pour les commérages sur le pas de la porte. Chez le consommateur d’abri moderne, la distinction entre espace privé et espace public ne remplace pas la distinction traditionnelle entre le logis et les communaux articulée par le seuil — elle la détruit. Pourtant, ce que le logement en tant que bien de consommation a occasionné à l’environnement demeure jusqu’ici inaperçu de nos écologistes. L’écologie continue d’opérer comme une auxiliaire sinon une jumelle de l’économie. L’écologie politique ne deviendra radicale et efficiente qu’à condition de reconnaître que la destruction des communaux entraînée par leur transformation en ressources économiques est le facteur environnemental qui paralyse l’art d’habiter.
La mesure dans laquelle notre monde est devenu inhabitable est une conséquence manifeste de la destruction des communaux. Paradoxalement, plus le nombre des hommes augmente et plus nous rendons l’environnement inhabitable. Alors qu’en nombre toujours croissant ils ont besoin d’un toit, la guerre contre l’habitat vernaculaire est entrée dans sa phase ultime et on force les gens à chercher un logement — qui est un produit rare. Voici une génération, Jane Jacobs démontrait de façon convaincante que, dans les villes traditionnelles, l’art d’habiter et la vitalité des communaux se renforcent au fur et à mesure que la ville s’élargit et que les liens entre les habitants se resserrent. Or au contraire, depuis trente ans, presque partout dans le monde de puissants moyens ont été mis en œuvre pour violer l’art d’habiter des communautés locales et créer de la sorte le sentiment de plus en plus aigu que l’espace vital est rare.
Ce viol des communaux par le logement est aussi brutal que la pollution des eaux. L’invasion des dernières enclaves d’espace voué à l’art d’habiter par des programmes de logement n’est pas moins détestable que la création du smog. Le préjugé juridictionnel en faveur du droit au logement, droit constamment invoqué à l’encontre de la liberté d’explorer de nouvelles façons d’habiter, est aussi répressif que les lois qui prescrivent le style de vie du couple humain « productif ». Il n’en est pas moins affiché de tous bords. L’air, l’eau et les moyens alternatifs de cohabiter ont trouvé leurs protecteurs — ces gens-là bénéficient de programmes de formation, et les administrations leur offrent des postes. La revendication de la liberté d’habiter et de la protection d’un environnement habitable demeure pour l’instant le fait de mouvements civiques minoritaires ; et ces mouvements-là ne sont d’ailleurs que trop souvent dévoyés par des architectes qui se méprennent sur leurs buts.
Le débranché objecte aux conditions concrètes qui mettent le droit au logement en conflit avec la liberté d’habiter.
L’auto-construction est considérée comme un simple violon d’Ingres — ou comme la justification consolatrice des bidonvilles. Le retour à la terre est jugé romantique. Entretenir un vivier ou un poulailler en ville ? Pur amusement ! Les îlots urbains qui « fonctionnent » sont envahis de sociologues grassement payés, jusqu’au moment où ce bon fonctionnement s’enraye. Les squatteurs d’immeubles tombent sous le coup de la loi ; et s’ils rénovent les lieux, on en tire argument pour réclamer davantage de logements et de meilleure qualité. Or dans le domaine du logement, tout autant que dans l’éducation, la médecine, les transports ou les pompes funèbres, ceux qui se « débranchent » ne sont pas des puristes. Je connais une famille qui, dans les Appalaches, mène paître ses quelques chèvres et, le soir, pianote sur un ordinateur alimenté par une batterie. Je connais un occupant illégal qui s’est installé dans un taudis muré de Harlem et envoie ses filles dans une école privée.
Pourtant, ni la dérision ni le diagnostic psychiatrique ne feront décamper les débranchés. Ils n’ont plus la conscience des hippies calvinistes et ils cultivent leur propre variété de sarcasmes et de talents politiques. Leur expérience leur dit qu’ils jouissent d’un art de vivre qu’ils ont recouvré en faisant leur demeure bien plus qu’ils ne jouissaient du confort qu’ils ont abandonné. Et ils deviennent de plus en plus capables de traduire, par de vigoureuses attitudes, leur rejet des axiomes relatifs à Homo castrensis sur lesquels repose en partie la société industrielle.
Et d’autres considérations concourent maintenant à justifier le recouvrement de l’espace voué à l’art d’habiter. Des procédés, des matériaux et des machines modernes rendent beaucoup plus simple et moins fastidieuse l’auto-construction. Le chômage croissant empêche désormais qu’on flétrisse comme asociaux ceux qui court-circuitent les syndicats du bâtiment. De plus en plus les ouvriers de cette branche doivent réapprendre complètement leur métier afin de l’exercer, hors emploi, sous des formes utiles pour eux et pour leur communauté. Les insuffisances criantes des immeubles d’habitation bâtis dans les années soixante-dix y rendent des transformations antérieurement impensables moins choquantes, et même raisonnables, aux gens du voisinage chez qui, voici quelques années, elles auraient déclenché des protestations. L’expérience du tiers-monde et celle du South Bronx convergent. Durant sa campagne électorale, le président du Mexique a déclaré sans ambiguïté que l’économie de son pays ne pouvait, ni dans l’immédiat ni dans l’avenir, construire un parc immobilier tel que tous les citoyens soient logés. Le seul moyen pour que tous les Mexicains aient un toit sous lequel ils se trouvent bien, ce sont des dispositions législatives et matérielles qui permettraient à chaque communauté mexicaine de se loger mieux qu’elle ne l’a jamais été.
Ce qui est proposé ici est énorme : qu’une nation se débranche du marché mondial de la construction des grands ensembles. Je ne pense pas qu’un pays du tiers-monde puisse y parvenir. Aussi longtemps qu’un État se considère sous-développé, il emprunte ses modèles au Nord, que ce soit le camp capitaliste ou le camp socialiste. Je ne peux croire qu’un pays de ce genre — une nation — pourrait réellement se débrancher. Quel gouvernement renoncerait au pouvoir énorme que lui confère l’idéologie de l’homme naturellement « cantonné » ? Bâtir la nation et construire des logements sont des utopies étroitement liées dans la réflexion de toutes les élites que je connais, particulièrement chez celles du tiers-monde. Il m’apparaît que la liberté d’habiter et la fourniture des instruments — légaux et matériels — rendant ce choix réalisable doivent d’abord être reconnues dans les pays dits « développés ». Là, le débranché peut étayer avec beaucoup plus de conviction et de précision les raisons pour lesquelles il place sa liberté au-dessus du droit à un garage humain. Et qu’il se tourne vers le Mexique pour apprendre ce que peut faire l’adobe.
L’espace propre à porter les marques de la vie est aussi fondamental pour la survie que l’eau et l’air non pollués.
Et les arguments qui placent le recouvrement de la faculté vernaculaire d’habiter au-dessus des exigences impuissantes d’un entreposage personnel ne cessent de s’élargir. Comme nous l’avons vu, ils vont dans le même sens que le mouvement écologique lorsque celui-ci rejette la chape de l’économie, science des valeurs rares. Ils s’accordent avec une analyse nouvelle et radicale de la technologie, qui met en opposition les moyens lourds de l’industrie de la construction et les outils modernes adoptés par les citoyens pour remédier à leurs médiocres possibilités d’habiter. Cependant, il est une argumentation encore plus importante, qui n’a pas été correctement formulée jusque-là, mais que je décèle dans bien des initiatives concrètes que j’ai pu observer. L’espace propre à porter les marques de la vie est aussi fondamental pour la survie que l’eau et l’air non pollués. Ce n’est pas le propre du genre humain que de se parquer dans des garages, aussi splendidement aménagés soient-ils, avec leurs douches et leurs économiseurs d’énergie. Le chez-soi et le garage ne sont pas des espaces équivalents. Le chez-soi n’est pas le nid humain à quoi voudraient le ramener les sociobiologistes, ni non plus le casier, même bien rembourré, dans lequel l’homme ne peut vraiment vivre. Les garages sont des locaux d’entreposage pour des objets qui circulent à travers l’espace homogène des biens de consommation ; les nids sont bâtis et occupés par des animaux que leur instinct attache à leur territoire. Les êtres humains, eux, habitent. Ils ont habité la Terre de mille façons et ont copié mutuellement leurs formes d’habitat. Ce qui a déterminé pendant des millénaires le caractère évolutif de l’espace habité, ce ne sont ni l’instinct ni les gènes mais la culture, l’expérience et la pensée. Certes, le territoire et l’espace habité sont tridimensionnels, mais leurs significations respectives en font des espaces d’un genre différent — comme sont différents le chez soi et le garage. Aucune de nos sciences n’est capable de saisir cette variété de topologies — pas plus la sociologie que l’anthropologie ou l’histoire, telles que pratiquées généralement de nos jours, n’abandonnent la perspective centrale dans laquelle disparaissent les différences qui importent. Il m’apparaît que la mise en contraste raisonnée de l’expérience humaine sous le règne des valeurs vernaculaires et sous le régime de la rareté est un premier pas dans la clarification de ces différences. Et à défaut de recouvrer un langage dans lequel on pourrait les énoncer, le refus de s’identifier au modèle de l’homme « cantonné » et la recherche d’un nouvel espace habité vernaculaire ne peuvent devenir politiquement efficaces. Ainsi, lorsque l’acte d’habiter devient un sujet politique, on en arrive inévitablement à un carrefour. D’un côté, on se préoccupera du « logement » — comment permettre à chacun d’obtenir sa part de volume construit, bien situé et correctement équipé. De l’autre, l’emballage des pauvres dans leurs casiers d’habitation représentera un secteur d’activité pour les travailleurs sociaux lorsqu’il n’y aura plus de crédits pour les architectes. Et il y a une autre voie, celle où l’on prend en considération le droit d’une communauté de se constituer et de s’installer selon ses capacités et ses talents. Dans la poursuite de ce but, beaucoup s’apercevront, au Nord, que la fragmentation de l’habitat et la perte des traditions a entraîné le renoncement au droit à un habitat vivable. Les jeunes qui veulent se doter d’un chez-soi par eux-mêmes regarderont avec envie le Sud, où l’espace et la tradition sont encore vivants.
Cette envie naissante à l’égard des sous-développés doit être traitée avec courage et réflexion. Mais, dans le tiers-monde, c’est la survie même qui dépend du juste équilibre entre un droit à l’auto-construction et le droit de propriété sur une parcelle de terre et sous le toit dont on s’est doté.
Notes
Publication originale : Ivan Illich, 1984, « l’Art d’habiter », Dans le miroir du passé : conférences et discours, 1978–1990, traduit par Maud Sissung et Marc Duchamp (Paris : Descartes & cie., 1994), 64‑75. Copyright : Valentina Borremans.
Les rhapsodes suggèrent que cette conférence soit déclamée le premier jour des études d’architecture, de paysage...