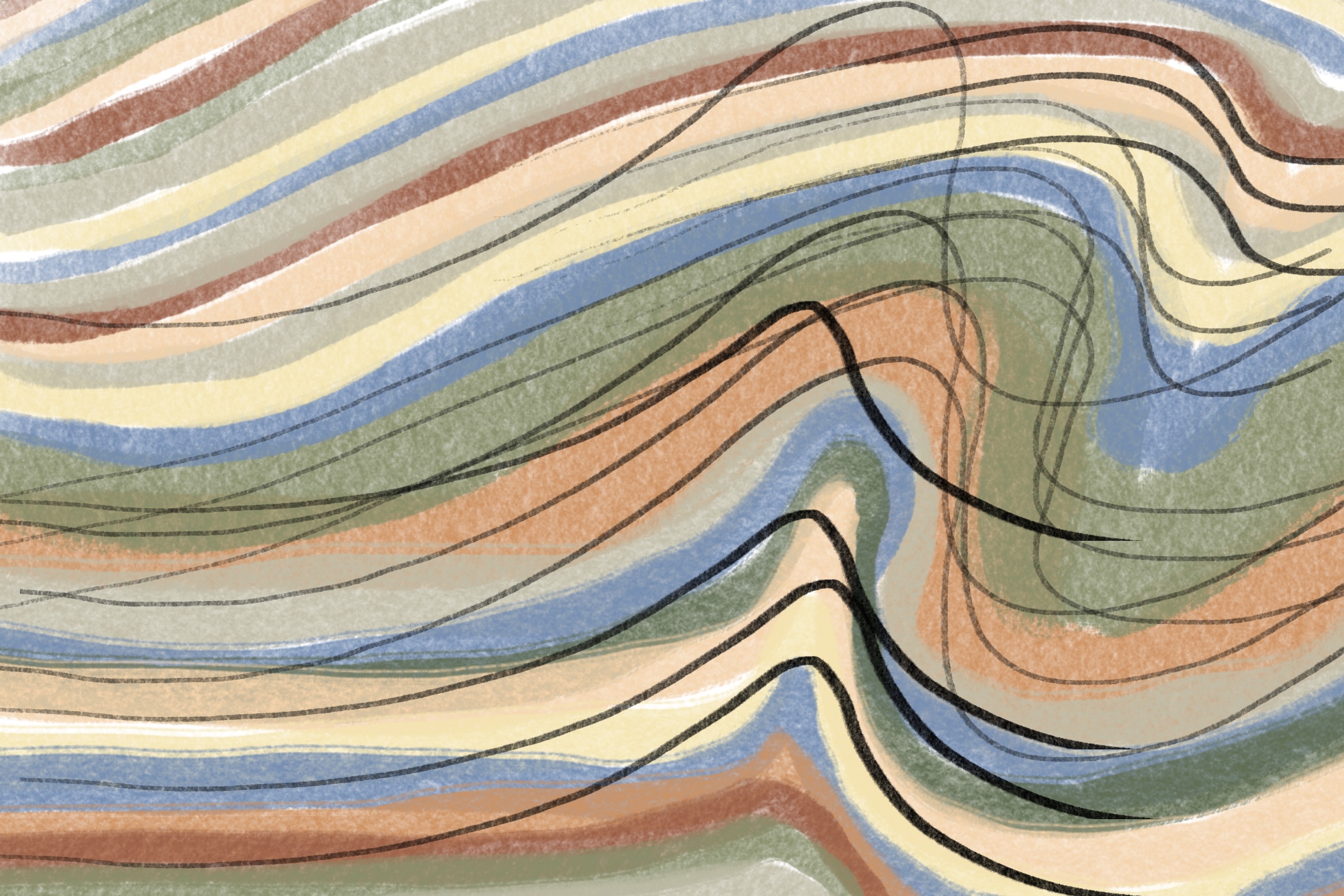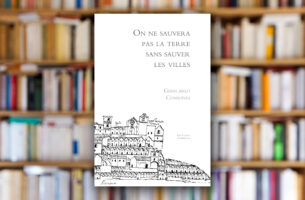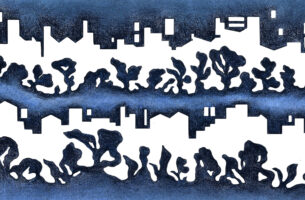Introduction
Si l’écologie est une méthode, Thierry Paquot nous guide sur cette voie à laquelle il confère trois qualités : processuelle, transversale et interrelationnelle. Sur le chemin, il nous introduit à des personnages fabuleux, des esprits brillants, des savants militant pour l’écologie, parfois oubliés (Rauch, Marsh, etc.), parfois célébrés (Humboldt, Haeckel, etc.), qui éclairent toujours, pourtant, notre présent. Il coud, tisse et lie leur vies et leur pensées à travers les siècles, les pays et les sciences et nous démontre que oui, l’écologie est une méthode.
L’écologie n’est pas une discipline universitaire pas plus qu’elle ne serait la ligne d’un parti politique ou son programme. Elle s’avère une méthode, dans le sens grec de methodos, où hodos désigne « la voie, la route », « la direction qui mène au but », ou pour le dire autrement, un cheminement qui nécessite une argumentation répondant à un questionnement. Ce chemin du connaître repose, à la fois, sur la géohistoire de la pensée écologique et sur les trois qualités spécifiques à l’écologie, qui est à la fois processuelle, transversale et interrelationnelle.
Je relaterai, certainement trop brièvement, la géohistoire de la notion même d’écologie, qui comme la plupart des appellations possède sa préhistoire, c’est-à-dire un moment au cours duquel la chose précède le mot qui la désigne. Afin d’incarner cet historique, je vais mentionner quelques individus qui par leurs travaux et aussi leurs convictions préparent le terrain, si j’ose dire, à l’éclosion du mot lui-même, sans le savoir et même le vouloir. Une fois formulé, celui-ci, selon les langues, l’état de la recherche, les forces politico-intellectuelles en présence, la culture de la nature qui domine alors, etc., s’impose plus ou moins vite, « prend » une dimension certaine et entre, peu ou prou, dans le vocabulaire ordinaire. Une fois ce repérage effectué, j’en viendrai aux trois qualités de cette méthode, qui n’a rien de stricte, ordonnée, rationnelle, tant elle récuse la hiérarchie verticale et se déploie en rhizomant…
François Antoine Rauch
Je commence arbitrairement par François Antoine Rauch (1762-1837), ingénieur géographe au service des Ponts et Chaussées dans plusieurs régions du royaume, qui publie en 1792 son Plan nourricier ou recherches sur les moyens de mettre en usage pour assurer à jamais le pain au peuple français, dans lequel il soutient que « le pain, le vin et le bois » sont les « trois premiers besoins du peuple », aussi exhorte-t-il l’Assemblée révolutionnaire à prendre soin des forêts, que l’on commence à vendre sans aucune autre intention que mercantile…
Pour lui, la forêt joue un rôle essentiel pour la vie animale et végétale, tout comme elle tempère le climat et protège les rivières et les pâturages. Il s’inscrit dans la lignée de Buffon, Rousseau, Parmentier et des Physiocrates lorsqu’il réclame la « régénération de la nature ». En 1802, il publie l’Harmonie hydro-végétale et météorologique ou recherches sur les moyens de recréer avec nos forêts la force des températures et la régularité des saisons par des plantations raisonnées, qu’il dédie à Napoléon Bonaparte, espérant l’inspirer dans sa politique agricole. Dans cet ouvrage il explique qu’il existe une interdépendance entre les montagnes, les forêts, les météores, les températures, les ressources en eau et la vie animale et qu’il faudrait maintenir cette ancestrale harmonie par une reforestation, qui incombe à l’État, d’autant plus qu’il constate que les pays de forêts sont les plus prospères. Il est un des premiers à considérer la nature comme un ensemble de « monuments vivants » qu’il convient de fêter lors de cérémonies populaires de plantation d’arbres, par exemple, comme pour les arbres de la liberté, mais aussi à la gloire des vallées, lacs et rivières afin de renforcer les liens entre eux et les habitants.
L’ordonnance des Eaux et Forêts de 1669 de Colbert ne suffit plus pour protéger les forêts, de nouvelles voix, amplifient les craintes de François Antoine Rauch, comme celles de Jean-Baptiste de la Bergerie (1762-1836), Alexandre Moreau de Jonnès (1778-1870) et Antoine César Becquerel (1788-1878). Ce dernier démontre dans Des climats et de l’influence qu’exercent les sols boisés et non boisés (1853) l’influence de la forêt pour la stabilisation climatique. Il constate que la déforestation entraîne la baisse du niveau d’eau dans les étangs et les lacs, la diminution des pluies et l’augmentation tumultueuse des crues.
En France, le XIXe siècle est jalonné d’inondations meurtrières provoquées par un déboisement inconsidéré, comme le précise Alexandre Surell dans son Étude des torrents des hautes Alpes en 1841, que George Perkins Marsh mentionnera dans Man and Nature, or, Physical Geography as Modified by Human Action en 1864. (1)
Alexander von Humboldt
Alexander von Humboldt (1769-1859), géologue, explorateur, aventurier, naturaliste, encyclopédiste, est auteur d’une œuvre appréciée par un large public fidèle, fervent et international. En 1800, observant le lac Valencia au Venezuela, il remarque que les plantations coloniales ont déréglé le climat. La déforestation a stérilisé la terre, baissé le niveau d’eau du lac, fait disparaître la végétation qui retenait la terre, dorénavant lessivée et dispersée par les pluies. Il affirme alors que ce sont les activités humaines qui sont responsables de ce déséquilibre au sein de la nature, car tout est lié, et que perturber un des éléments revient à tout chambouler, peu ou prou. Il ajoute que ce dérèglement climatique touchera les « générations futures », usant d’une formule dont il ignore le futur succès...
Ses autres voyages, ses autres constats, ses nombreux écrits, ne feront que confirmer cette interrelation entre n’importe quel organisme, du plus microscopique au plus gros, et son milieu. « Dans le grand enchaînement des causes et des effets, écrit-il en 1807, aucun fait ne peut être considéré isolément. » (2) Il sera lu par Darwin, qui lui doit sa vocation de savant, par Goethe, qui fut son ami, et aussi par les poètes anglais Coleridge et Wordsworth et les Américains Henry David Thoreau et Marsh.
Alexander von Humboldt, pour qui « l’idée même de colonie est immorale » (il entretiendra une forte amitié avec Simon Bolivar), est scandalisé par la généralisation de l’agriculture de rente, comme la canne à sucre à Cuba, que les colonisateurs imposent aux autochtones qu’ils fouettent sans ménagement, au détriment d’une agriculture vivrière, ce qui les rend dépendants des colons pour se nourrir, lorsqu’ils ne meurent pas de faim…
Partout, il dénonce la monoculture qui appauvrit simultanément le sol et les paysans, sans oublier la déforestation qui la précède. « La région boisée, observe-t-il, a une triple influence : elle agit à la fois par la fraîcheur de l’ombre qu’elle répand, par l’évaporation des eaux qu’elle absorbe, et par le rayonnement qui refroidit la température. » Humboldt constate que la « nature » n’est pas pacifique mais traversée par d’innombrables tensions et même violences entre les espèces. Il découvre que tout est pourtant lié en elle, qu’il est impossible d’isoler un de ses éléments constitutifs, qu’il y a interaction entre le climat et l’altitude, le climat et les plantes et cultures, le climat et l’eau, le climat et les actions humaines, etc.
George Perkins Marsh
George Perkins Marsh (1801-1882), grand lecteur de Humboldt, se nourrit de son œuvre pour édifier la sienne. Cet homme qui parle vingt langues, s’essaie à divers métiers sans succès (éleveur de mouton, agent immobilier, journaliste, forestier, propriétaire d’une carrière de marbre qui fit faillite…) avant de représenter les États-Unis à Constantinople, puis Turin. De là il visite l’Égypte et le Proche Orient et l’Europe, herborise, observe, excursionne, note tout ce qui frappe son esprit aux aguets, en compagnie de Caroline, sa femme, tout aussi curieuse que lui.
Durant plusieurs années, il peaufine son livre à l’aide d’une documentation incroyablement diverse et variée, tant technique que littéraire, naturaliste que politique et économique. Il a trouvé un titre : L’homme perturbateur des harmonies de la nature, que son éditeur le dissuade d’utiliser pour accepter le plus neutre, Man and Nature, qui paraît en 1864, connaît un démarrage commercial assez lent avant de s’imposer comme une référence qui n’effraye pas le grand public, plutôt enthousiaste. Le livre fut plusieurs fois réimprimés. Les activités humaines, sans aucune attention à la nature (elle semble inépuisable), la dégradent immanquablement, l’altèrent profondément, en perturbent les interrelations régulatrices, au point où telle culture intensive gaspille l’eau et épuise le sol, ne sachant pas que cette situation provoque le dérèglement climatique, l’irréversible déforestation, la nervosité des torrents, la disparition de telle et telle espèce animale et végétale qui y perd son écosystème, le tout en des chaines de causalités qui s’enchevêtrent et s’amplifient irréductiblement. « Nous ne pouvons pas savoir jusqu’où se propagera le cercle créé par les perturbations que nous produisons dans l’harmonie de la nature en jetant même le plus petit caillou dans l’océan de la vie organique. » (cité par A. Wulf, p.397)
Sa désolation atteint le sommet lorsqu’il compris que toutes les civilisations sont tributaires des arbres et des forêts et qu’elles s’assèchent elles-mêmes lorsqu’elles pompent ce trésor vital tout autant que poétique. Les paysages désolés, quasi-désertiques, d’Égypte, de Palestine, de Turquie et de Grèce qu’il parcourt à pied, démontrent l’obstination destructrice des moutons et des chèvres et l’appât du gain des humains. « Nous avons assez abattu d’arbres » proclame-t-il, en écho aux admonestations d’Alexander von Humboldt. Il incite les municipalités de se doter de forêts urbaines, inaliénables…
Il influence John Muir, créateur du Sierra Club et infatigable défenseur de la vallée de Yosemite, qui disait qu’« on ne sort pas dans la nature » mais qu’« on y entre », et Gifford Pinchot, premier directeur du Service des forêts des États-Unis, administration qui employa, plus tard, Aldo Leopold et Benton MacKaye. John Muir réclame la préservation de la nature la plus « naturelle » possible (wilderness, c’est-à-dire encore « sauvage ») tandis que Pinchot prêche la conservation au nom d’une exploitation rationnelle des forêts. Deux visions différentes de la manière dont les humains se comportent envers la nature, avec néanmoins un point commun : toute activité humaine a des répercussions sur la nature…
Ernst Haeckel
Ernst Haeckel (1834-1919), allemand, médecin, eugéniste, dessinateur, herboriste, voyageur avait trois amours : Anna — qui mourut deux ans après leur mariage, « je suis mort à l’intérieur » dit-il alors à un ami —, Humboldt et Darwin. Il rencontre ce dernier chez lui, près de Londres et en est bouleversé, il devient une sorte de propagandiste du darwinisme et publie en 1866 deux tomes, plus de mille pages en tout, pour diffuser cette pensée qu’il juge non seulement audacieuse et admirable mais cruciale. C’est dans Generelle Morphologie der Organismen (Morphologie générale des organismes), qu’il invente le mot « écologie » (oïkos, la « maison », la « demeure » et logos, « la connaissance de ») pour désigner « la science de l’économie, du mode de vie, des rapports vitaux externes naturels des organismes. » (vol.1). « Par Oekologie, nous entendons la totalité de la science des relations de l’organisme avec l’environnement, comprenant au sens large toutes les conditions d’existence. » (vol.2)
Dans l’Histoire de la création (1868), nous lisons : « L’écologie ou distribution géographique des organismes (…) la science des rapports des organismes avec le monde extérieur ambiant, avec les conditions organiques et organisatrices de l’existence ; ce qu’on a appelé l’économie de la nature, les mutuelles relations de tous les organismes vivants en un seul et même lieu, leur adaptation au milieu qui les environne, leur transformation par la lutte pour vivre, surtout les phénomènes de parasitisme… » L’écologie est donc l’étude des interrelations entre les éléments constitutifs d’un même ensemble. Il est à noter que Ernst Haeckel n’use que parcimonieusement de ce terme qu’il forge…
Il a d’autres cordes à son arc. Ainsi, une série de planches, Kunstformen der Natur (Formes artistiques de la nature), – qui ont contribué à sa précoce renommée – montrant les radiolaires des éponges calcaires, des méduses. Ces dessins absolument splendides, publiés en 1899, vont inspirer aussi bien Émile Gallé que l’architecte barcelonais Gaudi. Cette même année il fait paraître Die Welträtsel (Les Énigmes de l’univers), qui sera traduit en 27 langues et connut un succès de librairie en Allemagne avec 450 000 exemplaires vendus, il y expose l’unité de la nature et la puissance indiscutable de la science. Depuis ce n’est pas le mot « écologie » qui lui est associé, mais bien ses travaux de vulgarisation du darwinisme et sa conceptualisation du monisme…

Au tournant du siècle
L’on pourrait croire que tout est en place pour l’arrivée de l’écologie et sa consécration. C’est aller vite en besogne. Les réticences des uns, les résistances des autres, tant dans le domaine scientifique que social, font que, selon les cas, l’écologie est reconnue ou rejetée.
Forgé en allemand, ce terme figure dans le titre d’un ouvrage du botaniste danois Eugenius Warming (1841-1924), Plantesamfund Grunträk af den Ôkologiske Plantegeografi (Copenhague, 1895), qui est traduit en allemand en 1896 et en américain en 1909. Conway MacMillan (1867-1929), botaniste américain l’emploie en 1897 dans son étude sur la distribution des plantes sur les rives d’un lac du Minnesota. Un an plus tard, A.S. Hitchock l’utilise dans Ecological Plan Geography of Kansas, ainsi que Henry Chandler Cowles (The Ecological Relations of the Vegetation on the Sand Dunes of Lake-Michigan) et Frederick Edward Clements en 1905 dans sa Research Methods in Ecology. La British Ecological Society est fondée en 1913 ainsi que le Journal of Ecology, l’Ecological Society of America voit le jour en 1916 et la revue Ecology en 1920. On trouve ecologia dans une revue italienne dès 1898.
Par contre, en France, il ne s’impose que très lentement, Patrick Matagne en relate l’historique (3) : l’expression « facteurs écologiques » se trouve sous la plume du docteur X. Gillot, vice-président de la Société d’histoire naturelle d’Audun, dans les Mémoires de la Société d’émulation du Doubs en 1900 ; Charles Flahaut use de l’adjectif « écologie » dans son « Projet de nomenclature phytogéographique » qu’il publie en 1900 ; Jules Pavillard évoque les « facteurs écologiques » en 1901 dans ses Éléments de biologie animale ; Émile Gadeceau dédie un chapitre à « la botanique écologique » dans son Essai de géographie botanique sur Belle-Île-en-Mer en 1903 ; Alexandre Acloque et Casimir Cépède, en 1910, traitent des « facteurs écologiques » dans leurs Observations biologiques et écologiques sur la flore de Wimereux et de ses environs, etc.
Patrick Matagne explique cette situation française par la raison suivante : le mot « écologie » vient d’un zoologue, or les botanistes français, pour la plupart « amateurs » qui herborisent pour le compte d’associations floristiques locales, lui préfèrent « la géographie botanique » ou la « phytogéographie ». Il faut attendre l’entrée du mot à l’université pour qu’il vise à la scientificité et ainsi prétendre à sa reconnaissance, à la suite des travaux de Pierre Allorge sur les Associations végétales du Vexin français (1922), de Marcel Denis sur les mares de la forêt de Fontainebleau en 1925, de la parution en 1933 de la Géographie des plantes de Henry Gaussen et surtout de la publication de l’article méthodologique du biologiste Marcel Prenant, « Adaptation, écologie et biocénotique » dans les Actualités scientifiques et industrielles en 1934.
Écologies
Par la suite, et ceci dans tous les pays qui adoptent la notion d’« écologie », celle-ci se complexifie et se divise en « écologie animale et végétale », « écologie humaine », « écologie urbaine », « écologie sociale », « écologie politique », chacune entretenant avec les autres des relations plus ou moins hégémoniques et changeantes, au fur et à mesure où les unes et les autres s’enrichissent de nouveaux concepts, comme « biosphère » (Éduard Suess, 1875), « biocénose » (Karl Möbius, 1877), « écosystème » (Arthur George Tansley, 1935), « biodiversité » (biological diversity par Raymond F. Dasmann en 1968 et biodiversity par Walter G. Rosen en 1986), etc. L’entremêlement de ces « écologies » à visée spécifique oblige chacune à réagir aux autres ce qui va dans le sens d’un « penser écologique » en construction.
La géohistoire de l’idée d’« écologie », à peine esquissée ici, permet de mieux cerner les enjeux théoriques et aussi juridiques et politiques, les forces intellectuelles et sociales, les actions à mener et les expérimentations à effectuer, qui en relèvent. Elle nous révèle aussi l’existence de blocages de nature différentes, que nous devons comprendre pour les dépasser. Ainsi, par exemple, Alexander Humboldt nous explique, il y a près de deux siècles, que certaines activités humaines sont à l’origine de la destruction du sol, du dérèglement climatique, des inondations, via la déforestation liée à l’agriculture intensive et que celle-ci soit toujours soutenue par de nombreux États et l’Union Européenne et bien sûr l’industrie agro-alimentaire, les semenciers, les fabricants de pesticides et d’engrais chimiques, etc., nous interroge sur la réception et la diffusion de ce type de constat, qui ne devrait plus être discuté et qui pourtant ne se traduit aucunement en une série de décisions, tant politique, sectorielle, juridique, fiscale…
La connaissance ne suffit jamais seule pour réorienter une action collective et même individuelle. Il faut pour cela, tout un « air du temps », une « conception du monde » ou, comme le dirait Kant, une Weltanschauung. Avoir raison tout seul ne suffit pas, il convient d’entraîner avec soi, toute une large partie de la société et pour cela mobiliser tout un imaginaire collectif qui adhère à la même vision du monde, sans pour autant la fixer dans le marbre, sachant qu’elle ne peut qu’accompagner un mouvement ininterrompu, en cours. Cet en cours caractérise notre situation d’humain sur une Terre affectée par tout un faisceau de contrariétés interdépendantes, d’origines diverses et de temporalités différenciées. C’est avouer à quel point notre marge de manœuvre apparaît étroite…
Disciplines
Regardons encore une fois en arrière, dans le miroir du passé, comme nous le murmure à l’oreille Ivan Illich, pour saisir le présent qui s’y manifestait déjà, à l’instar du futur qui « travaille » déjà notre présent. Qu’y voyons-nous ? Un consensus massif au sein de la population en faveur du progrès technique qui n’apporte à chacun et à tous que du plus. Rares sont les personnes qui, de la fin du XVIIIe siècle à nos jours, considèrent que tout progrès génère son accident, comme le théorisera Paul Virilio. Le productivisme s’identifie alors à la modernité libératrice des peurs ancestrales et d’un mode de vie subordonné à la rareté. La prise en considération des enjeux environnementaux n’intervient que sporadiquement (par exemple, en France, à la suite des inondations de 1856 qui provoque une grande émotion, des morts et des destructions) et portée par une poignée de quelques personnes, dont les propos avisés et à contre-courants ont peu d’écho.
L’école, et à dire vrai tout le système scolaire depuis la période révolutionnaire, ne sait trop que faire des « sciences naturelles », que Cuvier dans son Rapport à l’empereur sur les progrès des sciences, des lettres et des arts depuis 1789, remis en 1808, définit comme le regroupement de la botanique, de la zoologie, de la géologie et de la minéralogie (4). Les « sciences naturelles » appartiennent-elles à la Faculté des Sciences, aux côtés des mathématiques et des sciences physiques ou bien ont-elles à voir avec la géographie ? Les avis sont partagés, certains veulent que tout enseignant maitrise globalement les « sciences » afin d’établir des liens entre les différentes disciplines qui en font partie et d’autres que la spécialisation est imposée par la complexité de chacune de ces composantes ce qui exige une formation ad hoc. Les tergiversations durent tout le XIXe siècle, faut-il une ou plusieurs agrégations ?
Parmi ce qui deviendra au milieu du XXe siècle les « sciences humaines et sociales », seule la géographie revendique une formation aux « sciences naturelles ». Emmanuel de Martonne, dans un article de la Revue Internationale de l’Enseignement (n°35, 1898), revendique que tout géographe doit posséder des connaissances scientifiques, car « sans études solides de géologie, botanique, météorologie, etc., tout travail personnel de pure géographie physique est impossible. » (cité par Nicole Hulin)
Ne pénétrant pratiquement pas le corpus généraliste, les « sciences naturelles » demeurent du côté des Facultés de sciences, excepté lors de démarche personnelle comme celle d’Emmanuel de Martonne justement qui consacre le tome 3 de son Traité de géographie physique (publié en 1925-1927) à la Biogéographie qu’il rédige avec la collaboration d’Auguste Chevalier (1873-1960) pour les plantes et de Lucien Cuénot (1866-1951) pour les animaux. Il emploie, dès le premier chapitre, le mot « écologie », cette « analyse des groupements des êtres vivants conditionnés par des facteurs, actuels et passés, du milieu » (5). Par la suite Maximilien Sorre (1880-1962) réalise une admirable fresque écologico-géographique malheureusement très vite oubliée… (6)
Société civile
Si l’université française tarde à se préoccuper de l’écologie qu’en est-il de la société civile ? Je rappellerais quelques dates de fondation, en France, de sociétés savantes qui œuvrent pour l’écologie, comme la Société nationale d’horticulture (1827), la Société protectrice des animaux (1845), la Société d’acclimatation (1854), le Club Alpin (1874), le Touring-club de France (1890), la Société pour la protection des paysages de France (1901), la Ligue pour la protection des oiseaux (1912). (7)
Au cours du dernier quart du XIXe siècle on commence à distinguer les « animaux utiles » des « animaux nuisibles », on parle d’« équilibre naturel » (Albert Cretté de Palluel, de Confevron…), on réglemente la chasse et le braconnage pour protéger les ours et les oiseaux migrateurs, cibles privilégiées des agriculteurs-chasseurs, on dénonce la surexploitation des ressources maritimes, les déboisements, le dépeuplement des cours d’eau, aussi bien en métropole que dans les colonies, où les saccages sont disproportionnés… (8)
Edmond Perrier (1844-1921), physicien, zoologiste, directeur du Musée national d’histoire naturelle à partir de 1900, n’y va pas par quatre chemins, comme en témoignent ces propos vifs, clairs et nets, que nous pourrions faire nôtres : « L’homme n’ayant pas fait le monde, explique-t-il en 1912, n’ayant créé ni la terre, ni les animaux, ni les planètes, n’est que l’affectataire momentané d’une demeure dont il n’a pas le droit de modifier l’aménagement au détriment des générations qui l’occuperont après la sienne ; il n’a pas le droit de l’altérer, par des destructions inconsidérées, l’harmonie qui s’est établie, en dehors de lui, parmi tous les êtres. » La situation ne s’arrangeant pas, il déclare en 1913 : « Avons-nous vraiment le droit d’accaparer la Terre pour nous tous seuls et de détruire à notre profit, et au grand détriment des générations à venir, tout ce qu’elle a produit de plus beau et de plus puissant, par une élaboration continue de plus de 50 millions d’années ? » Et en 1914 : « Chaque génération humaine n’est qu’usufruitière des productions spontanées du sol ; le droit d’en user à sa guise, selon ses besoins réels, ne saurait lui être contesté ; mais ce droit implique pour elle un devoir : celui de ne pas tarir leur source et de transmettre aux générations qui la suivent un monde aussi riche que celui qu’elle a reçu de ses devancières. » (cité par Rémi Luglia, p.209).
De telles mises en garde ne remettent pas en question l’idéologie de « l’acclimatation » (terme que l’on doit à Étienne Geoffroy Saint Hilaire, en 1832, que son fils, Isidore, reprend lorsqu’il créé le Jardin d’acclimatation en 1854) qui vise à importer des espèces faciles à cultiver et à élever en France, pour accroître sa production agricole…
En 1911, Edmond Perrier, encore lui, part en guerre contre les chapeaux à plumes et les manteaux de fourrure qui réclament de nombreuses victimes (9), le combat s’avère rude, le lobby des plumassiers et des fourreurs est puissant et gagne, d’autant que la « femme-objet » n’est alors pas dénoncée par les féministes quasi-inexistantes, du moins sur ce terrain-là. Une de conséquences de cette défense des oiseaux est la création en 1912 de la Ligue française pour la protection des oiseaux, qui s’inscrit dans la lignée de la Royal Society for Protection of Birds fondée en 1889, et de la première réserve ornithologique française sur l’archipel des Sept-Îles au large de Perros-Guirec. Albert Chappelier (1873-1949), Louis Magaud d’Aubusson (1849-1917), Jean Delacour (1890-1985) en sont les plus chauds partisans…
Malgré ces fortes personnalités, ô combien compétentes et motivées, l’ensemble de la société traîne des pieds et ne place pas l’écologie dans son calendrier revendicatif. Il faut attendre 1971 pour que soit créé un « ministère de l’impossible » attribué à Robert Poujade, qui le nomme ainsi, et 1974, pour qu’un agronome atypique, René Dumont se présente aux élections présidentielles en prophétisant « l’utopie ou la mort »…
Processus
J’en arrive à l’écologie comme méthode à trois dimensions : processuelle, transversale et interrelationnelle. Ce que la cohabitation, souvent contrariée, du monde vivant et des humains nous apprend trouve dans ces trois qualités – que je propose de retenir pour définir l’écologie – son intelligibilité.
De quoi s’agit-il ? N’importe quelle espèce vivante résulte d’un processus et pour l’apprécier il nous faut reconstituer sa généalogie et tenter d’en comprendre la genèse. Le mot « nature » en latin, natura, explique bien cette idée d’une naissance, suite à une gestation, d’un développement et d’une mort et le cycle reprend. Le terme grec de phusis laisse également entendre qu’il y a un processus, une dynamique. Il en va de même pour les créations humaines, que ce soit des connaissances, des sentiments, des savoir-faire, des techniques, des croyances, etc., en repérer les conditions d’émergence et en suivre les évolutions représente le principal moyen pour les comprendre.
Si je veux me prononcer sur la disparition programmée d’une bête « sauvage » (le loup, l’ours, pour prendre deux exemples actuellement controversés) ou de son maintien, je dois en rappeler l’historique, non seulement en racontant la longue histoire du loup, mais en l’entremêlant à l’histoire des humains, en explorant les mythes qui le mobilisent et en analysant la symbolique qu’il signifie. Un animal, comme toute créature vivante, est plus que lui-même et la perception que nous en avons se modifie, parfois profondément, au cours du temps et selon les régions et aussi les cultures. Notre rapport à l’animal dit sauvage exprime bien plus que la place qu’occupe, par exemple, le renard ou le chevreuil dans nos campagnes et il importe de savoir ce que nos ancêtres, d’ici ou d’ailleurs, ressentaient à leur égard. Que le cygne soit un mets apprécié par François Ier m’intéresse autant que de comprendre comment la Conquête de l’Ouest a exterminé les bisons, comme l’étudie l’Américain William Temple Hornaday (1854-1937), directeur de zoos, qui nous explique que de 30 millions en 1800, ils se retrouvent un millier un siècle plus tard ! (10)
Cette dimension processuelle est déjà présente chez Alexander von Humboldt et plus encore chez Lamarck et Darwin et pose la question de l’évolution. Résulte-t-elle de la lutte pour la vie ? Sont-ce les plus forts qui gagnent ? Certains savants remarquent que la coopération l’emporte bien souvent sur la compétition, Piotr Kropotkine en tirera son ouvrage sur L’Entraide, relu récemment par Pablo Servigne, qui n’hésite pas à en transposer la thèse dans les sociétés humaines… L’étude des processus ne consiste pas en un recours à une quelconque chronologie, elle s’appuie plutôt sur une conception rétroprospective de l’histoire, sachant que chaque époque revisite l’histoire passée et tente de tenir à la fois le passé qui s’éloigne et le futur qui s’annonce…
Ce qui est nouveau, depuis quelques décennies, sont l’accélération de l’histoire et sa mondialisation. Avec l’accélération nous prenons conscience de la rapidité des mutations et de leur irréversibilité, quant à la mondialisation, elle désoccidentalise notre façon de voir et associe universalité et pluriversalité.
Transversalité
La transversalité s’attache davantage à l’horizontalité qu’à la verticalité des processus. Avec elle, nous traversons les différentes disciplines ou les différentes structures des pouvoirs et substituons à l’arbre de la connaissance, avec ses embranchements, le rhizome et ses racines, qui se démultiplient sans ordre, sans priorité, sans nœuds de communication comme dans un réseau. Chacun aura reconnu les Mille plateaux de Gilles Deleuze et Félix Guattari (11) qui y explicitent le « rhizome ».
Une telle transversalité devrait être à l’œuvre aussi bien dans le gouvernement d’un État que dans celui d’une municipalité, or, ces administrations préfèrent encore le découpage thématique avec ses ministères de l’agriculture, du travail, de la santé, etc., ou ses services de l’urbanisme, des parcs et jardins, de la scolarité, du logement, des espaces publics, etc. Nous mesurons là l’ampleur du fossé qui sépare une pratique politique dominante et une conception méthodologique, d’un côté nous fonctionnons à l’ancienne et de l’autre nous pensons que cela n’est plus possible ! Une telle confusion ne peut que gêner la prise de décision…
Mais ceci ne concerne pas seulement les systèmes de gouvernance, l’école avec son emploi du temps découpé selon les apprentissages disciplinaires et l’université avec ses formations également disciplinaires sont à mille lieux de toute transedisciplinarité, que j’écris avec un « e », comme dans « transe », ces rituels de dépossession/repossession comme le candomblé, le vaudou, le tromba que décrivent les anthropologues. Il s’agit de se déposséder de sa discipline au contact d’une autre puis de revenir transformé à sa discipline qui, de ce fait, n’est plus la même… Edgar Morin appelle depuis longtemps à une telle transversalité, qui est exigeante. En effet, acquérir des bases en biologie lorsqu’on est spécialiste de la Rome ancienne ou en climatologie quand on est économiste du secteur bancaire et des taux de change réclame un gros travail aux retombées pas toujours gratifiantes et rapidement utilisables dans son propre domaine. On le voit, cette transversalité s’apprend dès l’école, c’est dire si la réforme de celle-ci s’avère décisive pour épouser et accompagner la « révolution cognitive » que stimule l’écologie.
Nous pourrions déjà expérimenter à l’échelle communale une telle répartition des prérogatives entre les élu·e·s. Une ville qui entre en transition se doit de tenter cette transversalité en temps réel et en grandeur nature ! L’organigramme de la mairie serait tout autre et les collaborations entre services davantage transversaux. Chacun aurait participé à l’élaboration d’une vision d’ensemble de l’administration de leur commune en relation avec les habitants et les responsables des divers services qui sont appelés à se recombiner différemment.
Il est vraisemblable que la connaissance des usages temporalisés des services et des lieux servirait à mieux ajuster temporalités sociales et temporalités individuelles, temporalités du vivant et des humains. De même, l’approche genrée serait également mobilisée pour éco-féminiser notre rapport aux autres et à la nature… La transversalité décloisonne aussi bien les activités que les manières de les penser et de nous penser vis-à-vis d’elles. Les économies d’énergie, le choix des dépenses collectives (tant pour la cantine scolaire avec son gaspillage que pour le mobilier urbain avec sa standardisation ou pour les transports publics en relation avec les commerces, par exemple, ou les écoles…), la place de chacun (petits et grands) dans la conception, la réalisation, la représentation de la vie citadine (villageoise ou urbaine), deviendront alors l’affaire de chacun.
Interrelationnalité
L’interrelationnalité semble plus commode à effectuer puisque nous sommes convaincus que tout est dans tout et réciproquement, que si nous modifions un des éléments d’une chaîne alimentaire, nous la modifions entièrement, tout en redistribuant les cartes des divers écosystèmes concernés. Le réchauffement climatique entraine l’augmentation du niveau des eaux qui inondent les rivages, bâtis ou non, etc. Pourtant, ces interrelations sont trop fréquemment sous-estimées et rarement prises en compte dans la législation. Ainsi un agriculteur qui assemble diverses parcelles séparées par des haies ou des fossés pour n’en faire qu’une, plus facile à travailler avec ses engins mécaniques, supprime les haies et comble les fossés sans mesurer les dégâts écosystémiques qu’il provoque et devrait être pénalisé.
Penser les interrelations revient à rompre avec les dualismes qui imprègnent notre cerveau depuis notre naissance : nature/culture, homme/femme, noir/blanc, jour/nuit, etc., et à privilégier les entrelacements aux configurations souvent inédites et révélatrices de ce qui ne nous apparaissait pas d’emblée, à nous interroger sur les passages, les transitions et non pas seulement aux « états » fixes définitivement. Les interrelations révèlent les incroyables éventails de situations, d’émotions, de sentiments, qui existent et que nous n’imaginions pas, obnubilés que nous sommes par la norme et non pas ses à-côtés… D’incroyables solutions aux préoccupations environnementales surgissent lorsqu’on déplace légèrement le curseur de nos certitudes, l’interrelationnalité nous y invite. Tout jardinier le sait ou le découvre que si, suite à Voltaire qui nous invitait à « cultiver notre jardin » à la fin de Candide (1759), celui-ci, à son tour, nous cultive, les interrelations ne cessent de s’entrecroiser…
Ainsi, ces trois qualités méthodologiques de l’écologie sont à cultiver, à soigner, à populariser, elles nous ouvrent au monde, ce sont des aurores qui nous font signe et susurrent à nos oreilles que « la vie est faite de matins », comme le prétendait Stendhal…
Conférence prononcée à Chinon, le 15 mai 2019 et initialement publiée dans Écologie des territoires. Transitions et Biorégions (sous la direction de Thierry Paquot, éditions Terre Urbaine, 2021).
Notes
(1) Sur cet historique, lire le très intéressant ouvrage de Caroline Ford, Naissance de l’écologie. Polémiques françaises sur l’environnement 1800-1930, traduit de l’anglais par Béatrice Commengé, Paris, Alma éditeur, 2018. Man and Nature, a été édité par David Lowenthal, qui l’introduit, avec une Préface de William Cronon, Seattle, University of Washington Press, 2003, Surell est cité pp.208, 209 et 227.
(2) On se reportera au passionnant ouvrage de Andréa Wulf, L’Invention de la nature. Les aventures d’Alexander von Humboldt (2015), traduit de l’anglais par Florence Hertz, Lausanne, les Éditions Noir sur Blanc, 2017, que je mobilise plus d’une fois dans cet article, tant il est agréable à lire et très bien documenté…
(3) Lire la précieuse étude de Patrick Matagne, Aux origines de l’écologie. Les naturalistes en France de 1800 à 1914, Paris, éditions du CTHS, 1999.
(4) Cf. « L’enseignement des sciences naturelles au XIXe siècle dans ses liens à d’autres disciplines », par Nicole Hulin, Revue d’Histoire des Sciences, n°55/1, Paris, PUF, 2002, pp.101-120. Sur la lecture des biologistes par Paul Vidal de la Blache, lire, « Lamarck, Darwin et Vidal : aux fondements naturalistes de la géographie humaine », par Vincent Berdoulay et Olivier Soubeyran, Annales de Géographie, n°561-562, Paris, Armand Colin, 1991, pp.617- 634.
(5) Selon Pascal Acot et Jean-Marc Drouin dans leur important article, « L’introduction en France des idées de l’écologie scientifique américaine dans l’entre-deux-guerres », Revue d’histoire des Sciences, n°50/4, Paris, PUF, 1997, pp.461-479.
(6) Cf. Les fondements de la géographie humaine. Paris, Armand Colin, (3 tomes et 4 volumes publiés de 1943 à 1952), Tome 1 : Les fondements biologiques. Essai d’une écologie de l’homme. (2e édition 1947, 440 p., 3e édition revue et augmentée en 1951, 448 p.), Tome 2 : Les fondements techniques. (2 vol.), 1948-1950, 1031 p., vol. 1 Les techniques de la vie sociale. Les techniques et la géographie de l’énergie. La conquête de l’espace. 1948, 608 p. (2e édition revue et augmentée en 1954, 616 p.) ; vol. 2 Les techniques de production et de transformation des matières premières. 1950, 418 p. et Tome 3 : L’habitat. Conclusion générale. 1952, 499 p.
(7) Cf. Des savants pour protéger la nature. La Société d’acclimatation (1854-1960), par Rémi Luglia, Préface de Jean-Noël Jeanneney, Postface d’Éric Baratay, Rennes, PUR, 2015.
(8) Cf. Alfred Crosby, Ecological Imperialism. The Biological Expansion of Europe, 900-1900, Cambridge, Cambridge University Press, 1986 et Richard Grove, Ecology, Climate and Empire. Colonialism and Global Environmental History, 1400-1900, Cambridge, White Horse Press, 1997 et Les îles du Paradis. L’invention de l’écologie aux colonies, traduction française, Paris, La Découverte, 2013.
(9) Rémi Luglia fait état des comptes établis par Le Monde ailé et tout l’élevage sur le marché londonien, centre du commerce de la plume : 28 281 oiseaux de paradis (1907), 20 820 oiseaux-mouches (1911), 20 625 martins-pêcheurs (1907) et 69 140 hirondelles de mer (1908), p.239.
(10) Cf. Rémi Luglia, p. 225. Cette étude est traduite dans le Bulletin de la SNAF entre 1893 et 1895. On lira également The destruction of the bison: an environmental history, par Andrew Christian Isenberg, Cambridge, Cambridge University Press, 2000.
(11) Cf. Mille plateaux, Gilles Deleuze et Félix Guattari, Paris, Minuit, 1980.