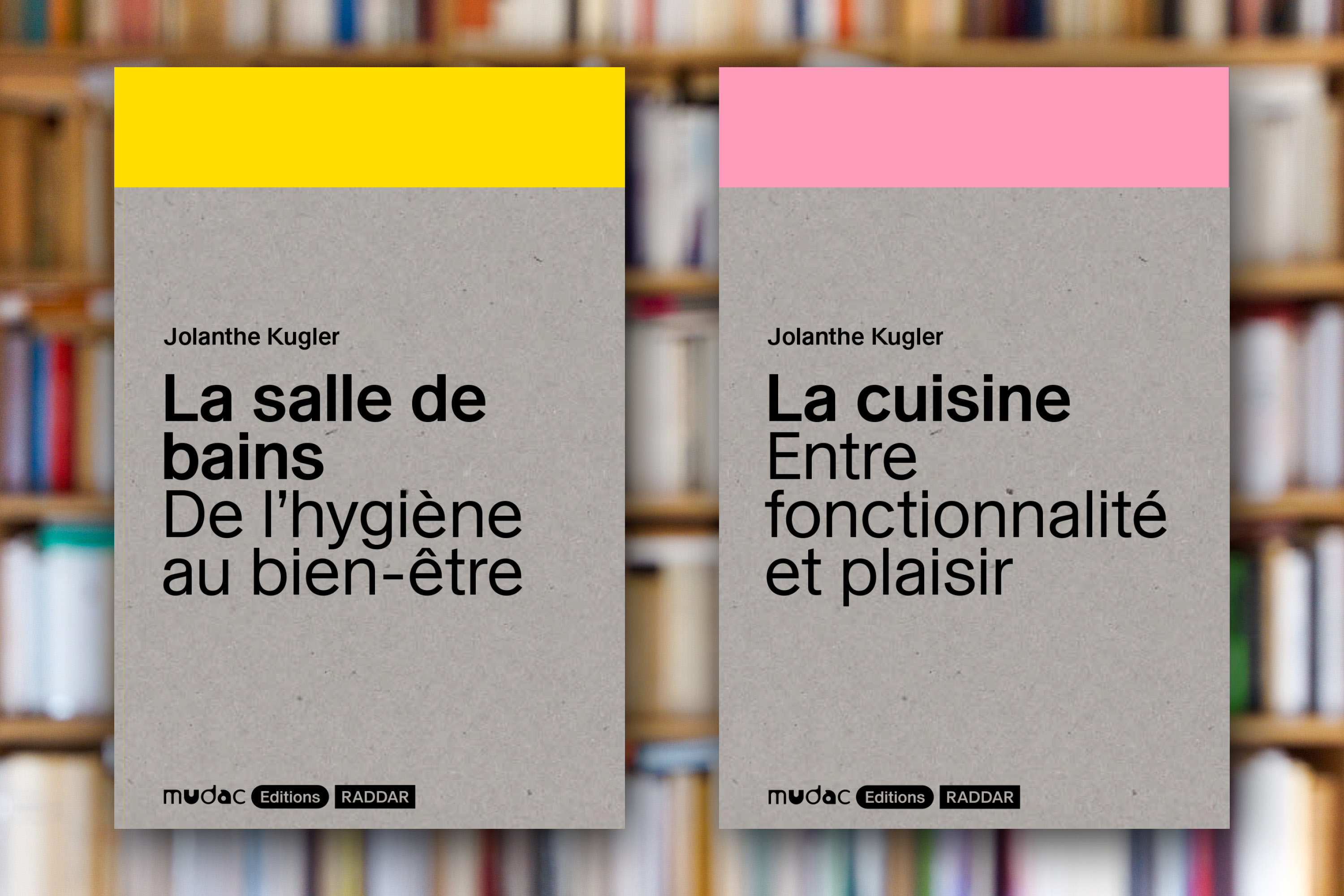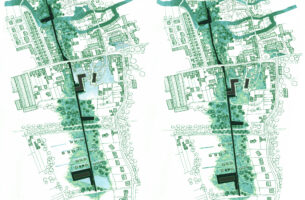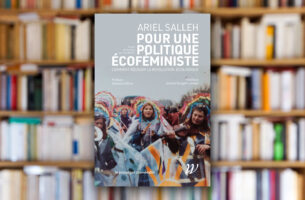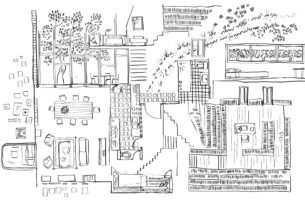Introduction
Il y a plusieurs manières de prêter attention aux détails de nos habitations. Chez Gaston Bachelard, on comprend mieux notre attachement aux pièces d’une maison en se souvenant des rêves et des songes qu’on y projette. Chez Georges Perec, c’est l’enregistrement minutieux de toutes les traces du passage des humains et des objets qui donne le plus à sentir la vie d'un appartement. Jolanthe Kugler nous invite quant à elle à explorer l’évolution des objets, des techniques et des agencements de nos salles de bain et de nos cuisines au cours du temps.
Historienne de l’art et urbaniste, conservatrice en chef du Mudac (musée cantonal de design de Lausanne), elle signe deux ouvrages sur la salle de bain et sur la cuisine. Elle y retrace les histoires techniques, sociales, esthétiques et même morales qui s’entremêlent dans ces espaces. Elle montre comment ces endroits que nous fréquentons chaque jour sont pétris de culture, construits au grès des connaissances scientifiques et de l'ingénierie, façonnés par les mœurs et la spiritualité, et modifiés au gré des modes. Les apparitions de nouveaux objets et pratiques sont illustrées par des images et des anecdotes qui rendent l’histoire compréhensible et attractive.
A travers l’histoire de la salle de bain, Jolanthe Kugler retrace l’histoire de notre rapport à l’eau, tantôt honnie parce qu’elle affaiblirait l’âme et la peau, tantôt recherchée pour la propreté et le soin du corps ; l’histoire de la médecine, de l’hygiène et de la lutte contre les épidémies ; l’histoire sociale (aux XVIIIe et XIXe siècles, on considère par exemple que seuls les domestiques auraient besoin de se laver, parce qu’ils seraient les seuls à se salir) ; mais aussi l’histoire des moeurs. La salle de bain n’a cessé d’être reconfigurée par le mouvement des limites entre ce que l’on fait en public et ce que l’on fait en privé, ce que l’on considère comme propre et ce que l’on considère comme sale, ce qui est jugé convivial et ce qui est jugé intime. L’autrice montre aussi comment les salles de bain ont évolué conjointement à notre sensibilité à certaines visions et à certaines odeurs : furoncles et maladies de peau, odeurs d’excréments et odeurs corporelles n’ont pas toujours incommodé les individus en société. En revanche, à partir du moment où ils furent sujet de préoccupation, la volonté de les camoufler s’est accompagnée de nombreux développements techniques, de petites trouvailles ou de systèmes ingénieux perfectionnés jusqu’à nos jours. On comprend ainsi comment la gestion de nos corps et de nos déjections a transformé l’architecture et l’urbanisme. Des latrines collectives, de véritables lieux de rencontres et de convivialité, nous sommes passés à des toilettes individuelles, desquelles contenu allait directement à la rue avant qu’on ne mette en place des égouts. Ceux-ci ont modifié toute la voirie et l’infrastructure urbaine, réglant ainsi le problème sanitaire et odorant des matières évacuées dans les rivières des villes.
Ces nouvelles techniques du corps et ces modifications au cœur même du foyer ont lentement été appropriées par les habitants. Jolanthe Kugler raconte comment le bon usage des salles de bain a dû être mis en scène dans la presse, au cinéma et par les architectes eux-mêmes qui se sont fait le relai de diffusion et d’éducation de ce nouvel art de la propreté. Dans des films hollywoodiens, des décors de salle de bain luxueux accompagnent des scènes de femmes qui font de la simple toilette un art de vivre et un art de la présentation de soi. Enfin les salles de bain, pour être confortables, ont abrités les premières des objets techniques complexes, comme le chauffe-eau, la chasse d’eau, le siphon et le robinet mitigeur, jusqu’à ce qu’apparaissent aujourd’hui une autre préoccupation : celle de gommer l’apparente technicité d’une salle de bain, ouvrant la chasse aux tuyaux visibles et aux joints en silicone.
« La cuisine. Entre fonctionnalité et plaisir » quitte le ton badin du premier ouvrage et évoque, dès les premières pages, la philosophie de Coccia (la cuisine est le lieu où la frontière entre humain et objet s’efface) et la diplomatie pendant la guerre froide. On y apprend ainsi que Nixon et Kroutchev ont débattu des avantages et des lacunes du communisme et du capitalisme en comparant l’émancipation des femmes dans leur deux pays grâce au confort proposé par leurs cuisines.
Jolanthe Kugler nous rappelle que la cuisine n’a pas toujours été ce lieu convivial et familial dans lequel on mange et on partage. Les cuisines ont davantage été le lieu des employés de maison, dans lesquels les riches propriétaires n’allaient pas, ou la pièce unique où l’on travaillait et on dormait, pour les foyers les plus modestes. Mais les évolutions de la cuisine sont étroitement liées à l’histoire de femmes. Dès le XVIIe siècle, la cuisine est « la pièce des femmes ». Au milieu du XXe siècle, elle devient le « royaume » de la femme au foyer, qui est l’alter ego féminin, la confidente, l’assistance et la nourricière de l’homo economicus.
Histoire de la cuisine et histoire des femmes sont aussi liées d’une autre manière. Ce livre est aussi l’occasion de mettre en valeur le travail des femmes, qui ont justement œuvré à l’amélioration de ces espaces occupées par les femmes. A l’époque du taylorisme, le travail des femmes et les gestes avec lesquels elles entretiennent le foyer sont rationalisés. Ainsi, l’autrice revient sur les études menées par Catharine Beecher (1800-1878) et Christine Frederick (1883-1970), deux pionnières de l’architecture moderne, qui ont voulu soutenir l’émancipation des femmes par la rationalisation du travail domestique. Elles calculent le nombre de pas parcouru et les kilogrammes soulevés chaque jour par une femme au foyer. Elles optimisent les recettes et les positions des objets en cuisine pour limiter les gestes à réaliser. Suivant ces principes, elles dessinent des cuisines standardisées qui rencontrent alors un franc succès. Mais l’ouvrage raconte également comment la cuisine est aussi devenue un espace d’expression pour les femmes au foyer. Dans les années 1950, des cuisines modulaires leur sont proposées. Les femmes peuvent choisir l’aménagement des différents blocs de cuisine en fonction de leurs habitudes. La cuisine devient en même temps une pièce d’apparat où l’on doit exposer la modernité de son foyer et exprimer ses goûts personnels pour asseoir son statut social. Leur place au sein de la maison évolue : elles deviennent de plus en plus centrales, rapprochées des salons et des salles à manger.
Les cuisines contemporaines sont elles aussi traversées par l’esprit de notre temps : elles se veulent souvent plus conviviales, mais aussi moins techniques, faites de bois ou de grès, largement ouvertes sur l’extérieur et si possible, sur la nature. On y bannit les micro-ondes pour y valoriser des bocaux remplis de céréales en vrac sur des étagères minimalistes. On y cuisine une alimentation plus brute et choisie pour être plus saine, censée résoudre les problèmes de notre époque sur nos corps sédentaires et nourri de junk food. On y retrouve aussi le goût du travail manuel et de la transformation des objets que nos emplois de bureau ne nous permettent plus de faire. Ainsi Jolanthe Kugler montre comment ces pièces, qui semblent avoir atteint une forme aboutie, sont toujours forgées par nos idéaux et nos modes de vie.
Jolanthe Kugler, La salle de bain. De l’hygiène au bien-être, Les presses du réel / MUDAC, 2025, 128 pages, 12 euros.
Jolanthe Kugler, La cuisine. Entre fonctionnalité et plaisir, Les presses du réel / MUDAC, 2025, 128 pages, 12 euros.