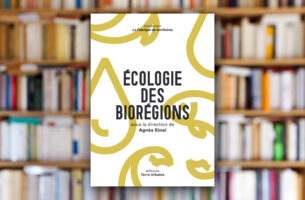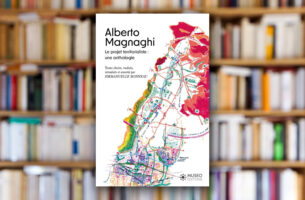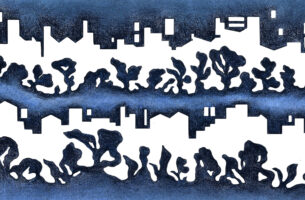Introduction
La Société des territorialistes (2011), et avant elle l’École territorialiste italienne (1990), ont été initiées par un groupe de chercheurs et enseignants topophiles issus de disciplines variées (architectes-urbanistes, géographes, écologues, agronomes, sociologues, anthropologues, philosophes, historiens, archéologues, scientifiques de la terre), menant des projets de recherche-action mêlant savoir et faire dans de nombreuses universités italiennes ayant en commun la centralité des concepts de lieu, territoire et patrimoine territorial.
Flux, lieu, territoire
La modernité a substitué le concept d’« espace physique fonctionnel », domaine (géométrique, linéaire, continu, homogène, mesurable, standardisé, isotrope, objectivable) techniciste des fonctions « objectives », au « lieu », construit dans les temps longs de l’histoire, domaine (subjectif, concret, unique, historique, limité, proche, identitaire, local) des relations entre l’humain et la nature. Comme l’écrit Pierre George en citant Le Lannou, l’homme producteur a remplacé l’homme habitant, provoquant ainsi une dissolution de sa topophilie traditionnelle si bien décrite par le géographe Eugenio Turri. Avec l’avènement de la société robotisée, digitale, de l’« hyperespace télématique » (éthéré, indifférencié, instantané, virtuel, démesuré, illimité, global), une part croissante de l’espace physique de la modernité entre à son tour en crise, à partir du moment où nombre de ses fonctions spatialisées implosent dans le domaine aspatial des réseaux télématiques ; flux qui, comme l’affirme le géographe Franco Farinelli, rendent résiduels les paramètres spatiaux des activités, rendant floue leur cartographie.
Avec la crise de l’organisation sociotechnique de la civilisation des machines et des processus d’homologation des flux aspatiaux du « global », le lieu revient au premier plan en tant que nouvelle centralité du « local » dans les processus de réidentification collective avec les spécificités identitaires du territoire.
Dans ce conflit croissant entre les flux et les lieux, qui renvoie au conflit entre hétérodirection et autogouvernement, le « territoire »,entendu comme un milieu humain (le « milieu ambiant » selon Gilles Clément), nouvel écosystème vivant à haute complexité, produit par les relations coévolutives (la « médiance », selon Augustin Berque) entre établissements humains et nature, est de nouveau interprété au travers des valeurs identitaires des « lieux » qui le composent : en découle précisément un « patrimoine territorial », entendu comme un ensemble de valeurs environnementales, territoriales, urbaines, infrastructurelles, paysagères, produites par les processus de territorialisation accumulés par plusieurs civilisations ; un « ressort remonté au travers des siècles », selon l’expression de l’économiste Giacomo Becattini, qui peut être réactivé quand un milieu socio-territorial en interprète les valeurs en les innovant au travers le développement d’une « conscience du lieu », ainsi que de pratiques de réidentification et de réappropriation.
Ces trois concepts, réinterprétés par des sujets sociaux qui prennent soin du patrimoine territorial en tant que bien commun, sont pour nous fondateurs de stratégies de « développement local autosoutenable » : auto, parce que le « développement local » se configure avant tout comme un développement des capacités de la société locale à se réapproprier les moyens de sa propre autogénération, à partir de la nourriture, réduisant l’empreinte écologique et la dépendance hiérarchique vis-à-vis de territoires lointains ; produisant des parcours alternatifs, « écoterritorialistes », de globalisation « par le bas » de la part de communautés biorégionales autogouvernées, qui s’organisent en réseaux fédérateurs, hétérarchiques et solidaires.

La nôtre est donc une topophilie qui part de la reconnaissance de la qualité, de la valeur et de la beauté, qui résident dans l’identité profonde des « lieux », pour déboucher sur un projet radical de traitement des désastres écosociaux provoqués par la globalisation économique, par la domination des flux sur les lieux, par l’urbanisation posturbaine et écocatastrophique de la planète, par les processus sans retour de déterritorialisation (rupture des relations coévolutives entre l’établissement humain et l’environnement) et déspatialisation (transfert d’une grande partie des activités humaines dans l’hyperespace digital) qui ont vidé de tout sens des mots comme « lieu », « démocratie » et « espace public ».
Le projet de traitement est pratiqué au travers d’un retour au territoire, dans ses déclinaisons du retour aux rôles multifonctionnels de la terre, aux qualités particulières de la montagne, à l’urbanité des villes, aux relations synergiques ville-campagne, aux systèmes économiques locaux à caractère éco-éthico-social, à des formes de démocratie communautaire des lieux.
La topophilie qui motive le parcours des territorialistes oriente leurs savoirs en de nombreux aspects :
- une passion artistique, dans le fait de reconnaître, décrire et restituer les spécificités paysagères qui définissent les lieux avec de nouvelles modalités de représentation (cartographique, littéraire, picturale, etc.) des morphotypologies territoriales adaptées à en interpréter la personnalité (Vidal de la Blache), l’âme (Hillmann) et le genius (Norbert-Schultz);
- une passion sociale, dans la promotion de processus participatifs capables de stimuler des formes d’autoreprésentation identitaire des valeurs patrimoniales du territoire de la part de leurs habitants (community mapping), activant des savoirs contextuels et experts pour l’auto-organisastion des modes de vie ;
- une compétence scientifique multidisciplinaire, dans l’étude des processus de territorialisation-déterritorialistation-reterritorialisation de longue durée qui, au travers de relations coévolutives entre établissements humains et environnement, telles que dessinées par Patrick Geddes dans la « coupe de la vallée » (place-work-folk = coevolution), ont produit les « lieux » qui identifient les « territoires » dans lesquels nous vivons en tant que résultat stratifié d’une longue transformation et croissance ; et dans l’étude des règles « statutaires » qui en définissent les capacités autoreproductives et autogénératives au travers des différentes civilisations ; dans ce parcours de territorialisation, comme l’écrit Angelo Turco, « la territorialité apparaît comme une qualité territoriale en vertu de laquelle les habitants d’une région en perçoivent l’essence du lieu construit historiquement par une collectivité humaine. Cette conscience est tout sauf immédiate, elle constitue pourtant la base à partir de laquelle les populations établies construisent leur sens d’appartenance, organisent leur action territoriale et, au final, définissent leur propre topophilie, l’amour pour la terre où ils vivent » :
- une capacité de mise en projet visionnaire (construction de scénarios stratégiques, visions), à cheval entre art et science, dans la représentation du futur de villes, réseaux de villes et biorégions urbaines, centrée sur la mise en valeur de patrimoines territoriaux reconnus et expérimentés socialement ;
- une capacité technique d’expérimentation de nouveaux outils de planification du territoire, à travers un vaste répertoire de processus participatifs, concertés et d’autogouvernement local (plans paysagers de nouvelle génération, contrats de rivière, de lac, de paysage, de montagne, écomusées territoriaux, observatoires locaux du paysage, parcs agricoles multifonctionnels, biodistricts et ainsi de suite), capables d’impliquer la citoyenneté active vers des formes de mise en projet collective et de nouvelles formes de démocratie communautaire, à partir du développement d’activités auto-organisées de reproduction de la vie dans des lieux de proximité (comme l’anticipait André Gorz).
Outil transdisciplinaire
Le concours des différents savoirs (et des différentes modalités d’action) à la construction de ce système complexe d’arts et sciences du territoire est spécifique dans la manière dont chacun se positionne dans le projet territorialiste. Celui qui étudie l’histoire du territoire a un positionnement différent de celui qui en approfondit les modèles socioculturels ou économiques, qui étudie le fonctionnement des réseaux écologiques ou des bassins hydrographiques, qui définit les services écosystémiques de la néo-ruralité, qui a en charge la gestion des processus participatifs de la citoyenneté active, qui étudie les modèles urbains réticulaires des biorégions urbaines, et ainsi de suite. Des positionnements qui prévoient également des relations différentes entre le savoir et le faire, donc une variété de champs et de modalités d’action. Toutefois chaque contribution n’est pas sectorielle mais procède de la nécessaire contamination de chaque discipline avec les autres dans la définition d’objectifs, méthodologies, instruments de connaissance et d’action ou de langages communs.
Étant donné l’extrême spécialisation avec laquelle chaque discipline mainstream traite désormais « son » territoire, avec « ses » bibliographies, et connecte ses propres savoirs à des organes de gouvernement du territoire tout aussi sectoriels, le parcours est semé d’embûches.
Mais pour surmonter ces difficultés en travaillant à un projet « multidisciplinaire », et pour certains aspects « transdisciplinaire », c’est précisément notre topophilie qui nous vient en secours, au-delà des positionnements spécifiques à chacun : une topophilie entendue comme un exercice quotidien d’observation amoureuse des lieux du monde (et de la science du lieu qui en jaillit), avec pour finalité la mise au point d’instruments scientifiques, techniques et politiques, adaptés à leur ménagement et à leur transformation collective en tant que biens communs de l’écoumène.
Traduit de l’italien par Marco Stathopoulos.