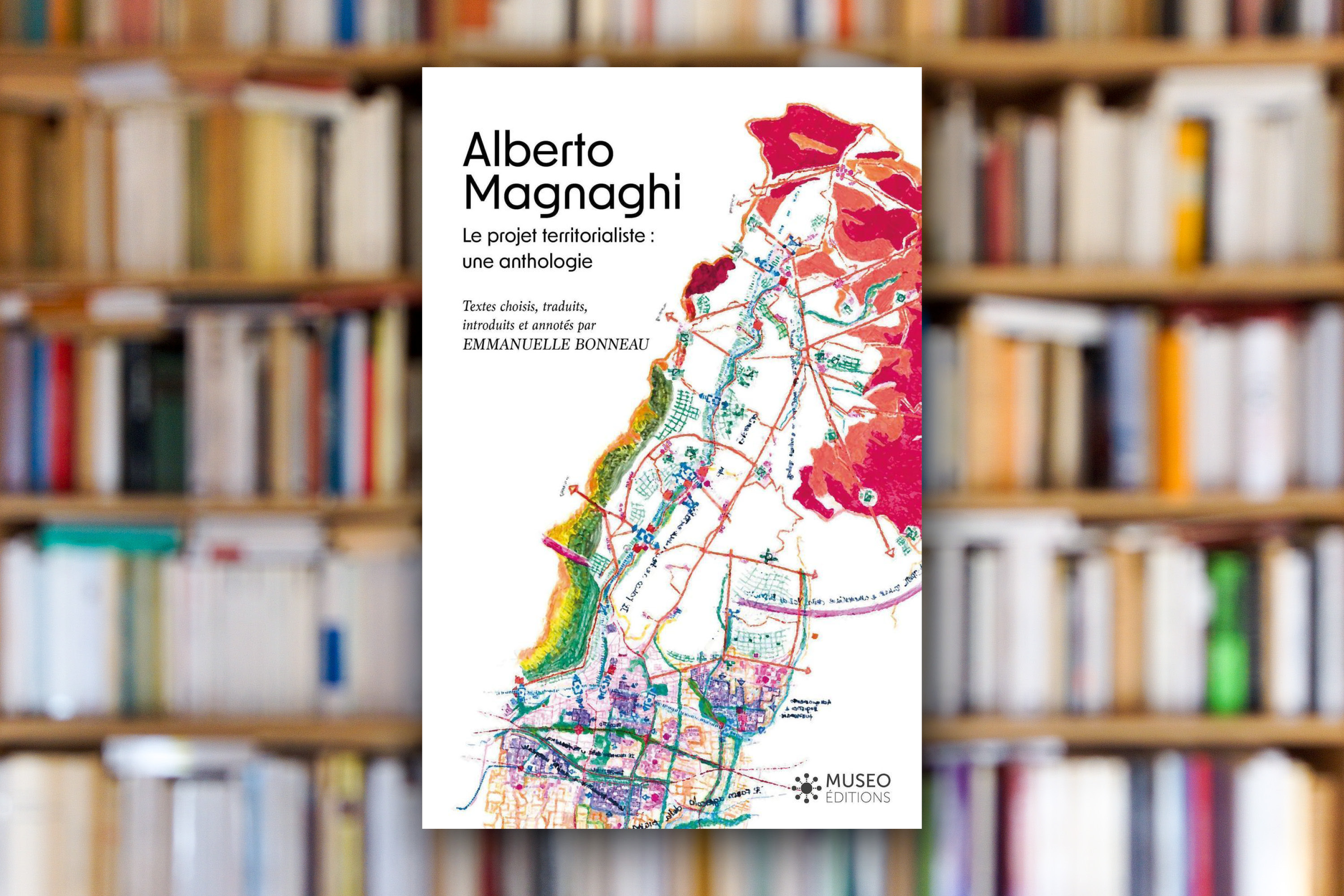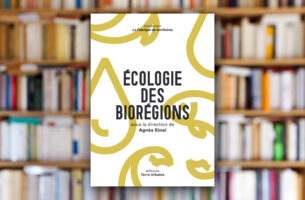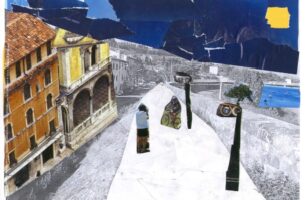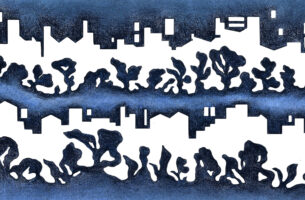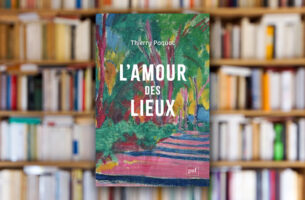Introduction
Cette anthologie rassemble la traduction de quinze textes d’Alberto Magnaghi, inédits en français, choisis, traduits, introduits et annotés par l’enseignante-chercheuse Emmanuelle Bonneau – déjà traductrice de La biorégion urbaine (Eterotopia, 2014). Cet ouvrage conséquent met en scène, dans la durée et dans le contexte politique de l’époque, les conditions d’émergence de la pensée du grand urbaniste italien, le territorialisme, une pensée incarnée dans la pratique et l’action. Trois grandes époques, à la fois chronologiques et conceptuelles, scandent cet itinéraire sur plus de trente ans (1982-2020).
La première époque, intitulée « recherche et projet », rassemble des textes d’orientation politique qui expriment les principes cardinaux qui vont guider l’œuvre entière de Magnaghi. Dès la fin des années 1980, dans le contexte du Rapport Brundtland (1987), Magnaghi décèle les incohérences du concept de « développement durable », alors perçu comme novateur : c’est pour lui la « domination de la croissance » qui a « détruit le territoire », et « les théories proposant des compatibilités possibles entre la croissance économique et l’équilibre environnemental s’avèrent faibles ». En contrepoint de ce constat, qui guidera tout son itinéraire, Magnaghi entend ouvrir un « horizon de projet ». C’est ainsi qu’il affirme le primat de la « production de territoire », vouée à se substituer à la « production de marchandises ».
« Il est nécessaire que chacun retrouve une position sur la terre et que de ce point retrouvé, il tisse les trames pour édifier un lieu habitable, reconnaissable, hospitalier et beau »
Alberto Magnaghi
En 1990, dans Pour une nouvelle charte de l’urbanisme, il définit le territorialisme comme un antidote à l’artificialisation des lieux et à l’uniformisation des rapports sociaux : seule une culture renouvelée de l’habiter peut produire une nouvelle territorialité, fondée sur le retour à une forme de « sagesse environnementale » et de développement local endogène. La rhétorique biorégionale est déjà présente : « Il est nécessaire que chacun retrouve une position sur la terre et que de ce point retrouvé, il tisse les trames pour édifier un lieu habitable, reconnaissable, hospitalier et beau ». Dès cette charte, Magnaghi cite les tenants du biorégionalisme, Peter Berg en particulier, et invoque des principes de complexité, différenciation et autonomie pour « sédimenter des équilibres homéostasiques locaux » d’inspiration biorégionale, un ensemble de « micro-équilibres » « qui redéfinissent le bouclage des cycles d’énergie, des déchets et de l’eau » et qui « produisent des génies reconstructifs des systèmes territoriaux dégradés. » Ces « petites homéostasies », déployées selon une vision polycentrique et réticulaire axée sur le soin des ressources, ont vocation à produire dans le temps « la santé générale » du territoire.
Urbanisme et culture de la limite
A travers cette manière de traiter le territoire comme un sujet vivant, l’enjeu est bien d’en réguler la croissance. L’idée est aussi d’en redéfinir les limites et les confins, « concepts abandonnés dans les modèles d’établissement de la croissance économique ». L’urbanisme, selon Magnaghi, doit être associé à « une culture de la limite » : limite de charge anthropique, limite à la consommation de sol, limite à l'artificialisation du territoire, limite à la consommation énergétique, limite à la production de déchets, à l'émission de substances polluantes. Cet entrelacement de limites fixées aux établissements humains dessine ce que Magnaghi désigne par « les nouveaux confins », du village, de la ville, du système urbain, de la région. De ce double concept, de limites et de confins, surgit ecopolis, une ville qui produit le territoire au lieu de le consommer et de le détruire, une ville qui fonde son propre développement sur la valorisation des ressources environnementales et humaines, en exaltant la spécificité, les différences, les valeurs locales. Ecopolis se veut aussi un projet ouvert de relations avec le sud du monde et avec ses propres périphéries régionales souligne Magnaghi. C'est un projet d'abolition des périphéries pour la construction d'une ville polycentrique.
Les textes sélectionnés dans la deuxième époque (1990-2004) mettent en avant la dimension didactique de l’école territorialiste qui s’affirme alors comme un collectif d’enseignants et de chercheurs. Cette période est marquée par la multiplication de partenariats entre enseignants-chercheurs, élus et techniciens, qui donnent lieu à de véritables projets de territoires. Le pôle universitaire d’Empoli, ville moyenne à une trentaine de kilomètres de Florence, est créé en 2001. Magnaghi y dirige un nouveau cursus en urbanisme et en planification territoriale et environnementale, adossé à deux départements, le département d’architecture et le département de sciences agronomiques, environnementales et forestières.
Au sein du Laboratoire de conception écologique des établissements humains (Lapei), la planification spatiale est ainsi irriguée par plusieurs disciplines et prend en considération les établissements humains en relation avec leur milieu plutôt que de se limiter à l’objet urbain. « La création de ce cursus formalise la création de la pensée territorialiste », souligne Emmanuelle Bonneau. Rattaché à l’université de Florence, ce nouveau pôle universitaire entend incarner les principes d’un polycentrisme régional. En lien avec le Circondario, entité intercommunale constituée autour d’Empoli, les projets conduits par Magnaghi résonnent avec le projet politique de la « Toscane des Toscanes » porté par le programme de développement régional entre 2000 et 2005. A tel point qu’en 2002, le président de la région Toscane et une large assemblée d’élus et de techniciens territoriaux adhèrent à la Charte de la nouvelle municipalité promue par Magnaghi. Dans un contexte de montée de l’altermondialisme, cette charte, qui en appelle à une « mondialisation par le bas », est présentée au Forum social de Porto Alegre en 2002.
La vision territorialiste, une pensée incarnée
L’agencement des textes choisis et introduits par Emmanuelle Bonneau révèle que la vision territorialiste portée par Magnaghi est indissociable d’une série d’expérimentations et de réalisations sur le terrain impliquant les habitants qui s’affirment au cours d’une troisième époque (2004-2020), centrée sur les plans paysagers et les parcs agricoles. A partir de 2004, en Italie, les documents de planification territoriale intégrent la protection du paysage. Le plan paysager (piano paesaggistico) ne s’applique plus seulement à des paysages d’exception mais au paysage dans son entier, dans l’esprit de la Convention européenne du paysage (2000) qui stimule la prise en compte des habitants et des savoirs contextuels. Dans les Pouilles, Magnaghi et son équipe utilisent des « cartes de communautés » qui se veulent des formes d’autoreprésentations du territoire mobilisant et impliquant les habitants, peut-on lire dans « La voie des Pouilles et la planification du paysage » (2013). Ce document retrace le défi de produire « socialement » un plan paysager sur un territoire aussi vaste que les Pouilles, peu coutumier des processus participatifs. C’est une véritable méthodologie qui s’invente ici pour faire naître un sens du commun.
On trouvera également dans cette anthologie substantielle une série de textes relatant l'élaboration du concept de parc agricole, élément majeur du design territorialiste. Le projet de plan territorial de la plaine de Prato (2001-2003) annonce la recherche sur les parcs agricoles multifonctionnels que déploie le Lapei à partir de 2006. Le parc agricole est un outil opérationnel majeur. On y retrouve l'intégration de la société civile chère à Magnaghi. C'est aussi le rêve d'un pacte ville-campagne qui remonte à la fresque du Bon Gouvernement (1338-1339) d'Ambrogio Lorenzetti représentée à Sienne dans le palais municipal. Alberto Magnaghi et David Fanfani définissent le parc agricole comme un espace agroforestier à la jonction du milieu péri-urbain et du milieu rural. S'inspirant de la théorie des designs multiscalaires (patterns) de Christopher Alexander, ils estiment artificielle la juxtaposition fonctionnaliste et utilitariste d'espaces agricoles disjoints des établissements humains riverains.
Le parc agricole se veut un contre-modèle à l'appropriation industrialiste de la campagne. Il se réclame d'une double dimension : morphogénérative et d'empowerment coopératif de la société locale. Il faut aussi comprendre le passage du concept de parc naturel à celui de parc agricole. L'idée est de dépasser le concept de périmètre d'une aire protégée (le parc naturel) au profit d'un parc agricole qui serait soutenu par les agriculteurs eux-mêmes. C'est un prérequis que souligne Magnaghi : « la reconnaissance du principe de multifonctionnalité de production de biens et de services publics par l'agriculture », adossée à « des pratiques de bon gouvernement rémunérées et évoluées socialement et culturellement ». On ne peut que rêver que l'immense travail conduit par le grand urbaniste italien, décédé le 21 septembre 2023, trouve un écho dans nos territoires. Cet ouvrage lui rend un bel hommage en retraçant son parcours, qui demeure d’une vibrante nécessité.
Alberto Magnaghi, Le projet territorialiste : une anthologie, Textes choisis, traduits, introduits et annotés par Emmanuelle Bonneau, Muséo éditions, 2025, 376 pages, 18,50 €.