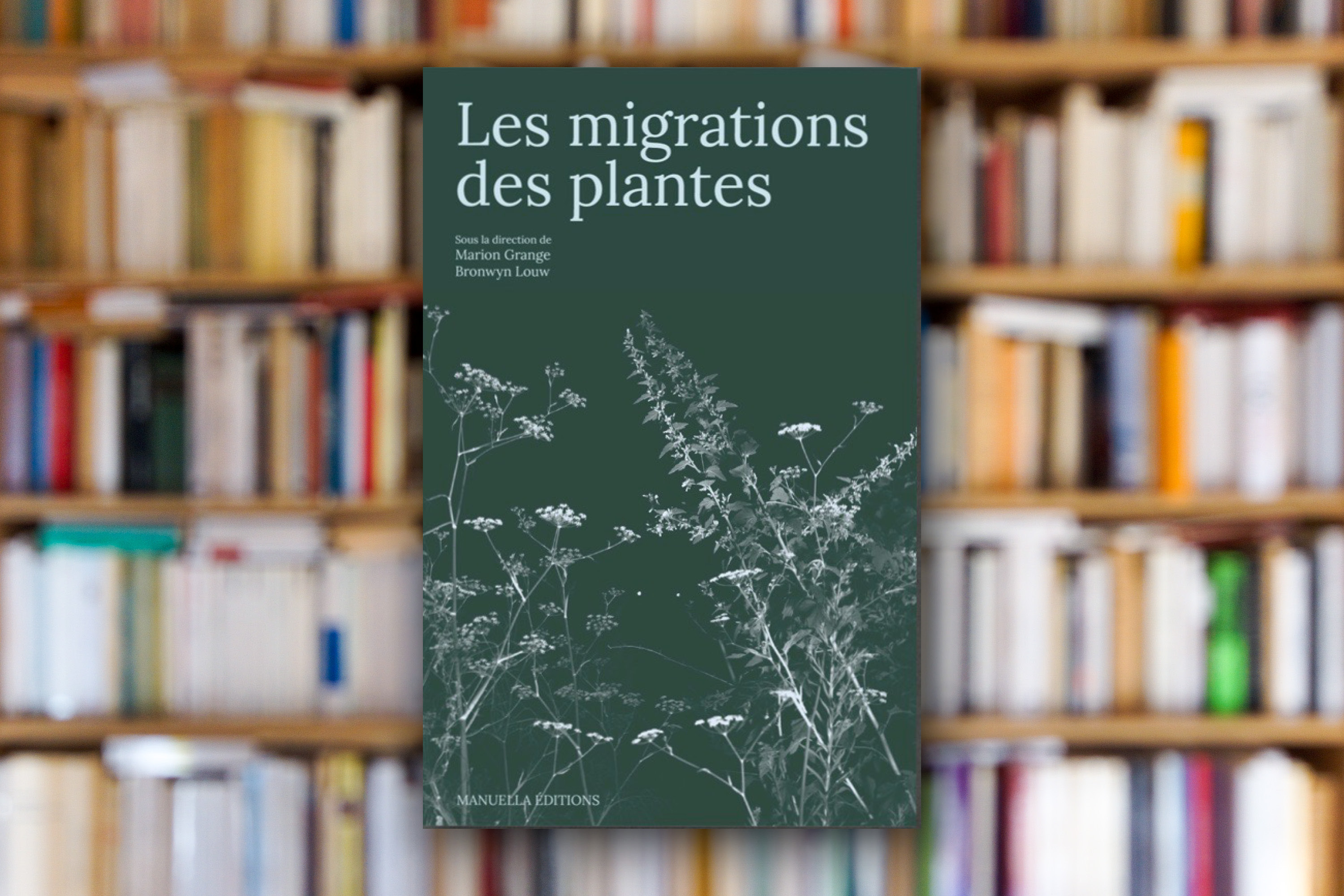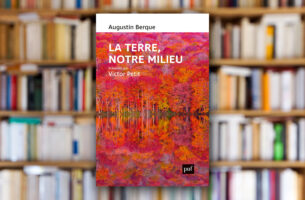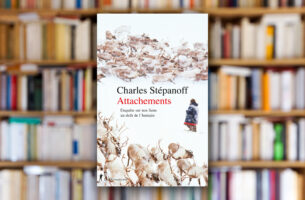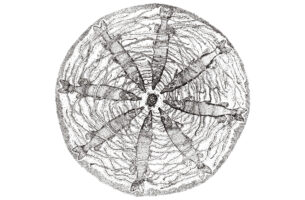Introduction
Depuis quelques années, le substantif de « vivant » s’est imposé dans les nombreux débats touchant à l’écologie, devenant un nouveau mot-tiroir pour évoquer tous les composants de la biodiversité. Il nous paraît aujourd’hui évident d’inclure dans le vivant les plantes, pourtant longtemps tenues pour de simples objets que l’on pouvait déplacer à loisir, produire à la chaîne, maltraiter voire détruire. À l’origine de cette perception de la plante se trouvent de nombreux présupposés et une grande méconnaissance de leur réalité physique. Aussi son basculement sémantique dans le vivant n’a-t-il rien de superficiel ; il dénote un changement de perception et de considération toujours en cours. La capacité de se mouvoir n’a, par exemple, longtemps été envisagée que pour le règne animal. Les plantes ne se meuvent certes pas comme les hommes tout au long des jours, seulement, malgré leurs puissantes racines, elles bougent… Quand elles poussent, bien sûr, mais aussi durant toute leur existence : lorsqu’elles sèment, lorsqu’elles accrochent leurs graines sur les pelages, les plumes, les vêtements, lorsqu’elles cherchent la lumière… Le mot « plante » viendrait du grec planaomai, signifiant « errer ». De fait, dans la Grèce antique, rien n’était perçu comme statique, tout était vivant et mouvant : eau, sols, roches… jusqu’aux morts eux-mêmes. Aujourd’hui encore, l’observation simple permet de se rendre compte qu’il s’agit d’une réalité : les plantes se meuvent constamment, démultipliant les stratagèmes permettant de mener leur cycle à son terme – s’élever, s’agripper, s’enrouler, s’entortiller, ramper, drageonner, se casser… et bien d’autres étapes encore.
Le présent ouvrage collectif, qui rassemble près d’une trentaine de signatures sous la direction de Marion Grange et Bronwyn Louw, se concentre sur une dimension bien particulière de cette mobilité végétale : la question de la migration des plantes. Celles-ci ne voyagent évidemment pas comme les humains. Leurs migrations se font lentement, sur plusieurs générations, mais elles sont réelles et de nombreux travaux de recherche étudient ce phénomène. Elles se passent souvent au moment de la fructification : les graines portées par le vent, les bêtes, l’eau vont les éloigner de la première aire de répartition. Ne s’enracinant que là où les conditions sont propices, c’est-à-dire dans un ici, la graine ne connaîtrait pas d’ailleurs, dit l’écologue Jacques Tassin, qui fait ainsi d’elle une force vitale et poétique en allant germer là où on ne l’attend pas.
« Ne s’enracinant que là où les conditions sont propices, c’est-à-dire dans un ici, la graine ne connaîtrait pas d’ailleurs, dit l’écologue Jacques Tassin, qui fait ainsi d’elle une force vitale et poétique en allant germer là où on ne l’attend pas. »
Cet ouvrage est également un absorbant livre d’histoire. Si, plusieurs articles sont rédigés dans des perspectives scientifiques, d’autres éclairent le contexte de certaines migrations. Une grande part des migrations végétales sont liées à celles de l’homme. Ce dernier a favorisé des plantes selon ses goûts ou suivant leurs caractéristiques ornementales, les semant à travers le monde. Certaines espèces nous sont si familières dans notre vie quotidienne ou dans nos imaginaires qu’on peine à croire qu’elles n’aient pas toujours peuplé nos paysages ou d’autres plus lointains. Le récit de ces migrations constitue celui d’un monde se mondialisant et se tournant de plus en plus vers le consumérisme. À travers ces articles, on prend la mesure de la façon dont les grandes découvertes et la mise en place des voies commerciales mondiales ont eu un impact sur la biodiversité et les paysages qui sont à présent les nôtres. Cette part de l’histoire n’est évidemment qu’un maillon à relier, plus largement, à ceux de la colonisation et de la traite négrière. Le passionnant article de Marion Grange,« Marronner avec les plantes : résistances sympoïétiques en territoire martiniquais », montre comment le jardin « marron » fut un espace de résistance et de résilience pour les esclaves aux Antilles. Un autre article encore, au sujet de l’arada, Petiveria alliacea, plante de la famille des Petiveriaceae, signé par Francesca Cozzolino et Sophie Krier, montre comment une plante peut, au sein d’une communauté, porter en elle le souvenir d’un autre territoire, représenter une force de résistance et de résilience tout en constituant, des siècles plus tard, une part de la mémoire collective.
En abordant les diverses réalités physiologiques et historiques du monde végétal, le livre conduit le lecteur à s’arrêter sur notre propre rapport au vivant, notamment à travers nos usages, nos mots et parfois même nos législations. Il n’est pas anodin qu’un débat récurrent porte sur les essences dites « invasives », soit ces plantes étrangères, notamment à travers l’appellation « espèces exotiques envahissantes » (EEE). Ce vocabulaire non neutre idéologiquement– et qui actuellement ne s’arrête d’ailleurs pas au simple monde végétal – trahit les standards de plus en plus mortifères de notre monde. L’article de Liliana Motta, Thierry Thévenin, Marion Grange et Bronwyn Louw au sujet de la renouée expose l’histoire d’une plante qui, jadis hissée sur les podiums de l’agriculture et de l’ornementation, a basculé dans l’exclusion : il replace avec intelligence la trajectoire de la Reynoutria japonica dans sa réalité biologique et rappelle qu’elle prend sa place au sein de sites très anthropisés, d’écosystèmes bouleversés et altérés, et qu’elle ne se déploie qu’à certaines étapes d’un processus écologique bien plus long et complexe. Cette mise en perspective permet aux novices de prendre de la distance avec l’arsenal administratif et ses qualificatifs sans pour autant amoindrir le potentiel impact de sa présence au sein de notre territoire. Dans une perspective proche, l’article de Marianne Roussier « Plantes voyageuses ou plantes voyagées ? » s’intéresse aux trajectoires de la Reynoutria japonica, de l’Ailanthus altissima, du Robinia pseudoacacia et du Buddleia davidii, montrant qu’on leur impute souvent la responsabilité de l’état de milieux affaiblis car anthropisés. Les campagnes d’arrachage dont elles sont victimes reviennent alors à des actions tournées vers nous-mêmes, afin de nous donner bonne conscience et de nous dispenser d’affronter notre vision idéalisée de la nature qui, selon l’autrice, n’est que le revers de la peur ancestrale qu’elle nous inspire. Car les plantes exotiques considérées comme « invasives » ont aussi une histoire douloureuse : nous les avons bien souvent trop intensivement exploitées.
Plusieurs auteurs et autrices qui, depuis les années 2000, ont œuvré à complexifier le regard que nous portons sur les migrations du végétal ont participé à cet ouvrage. Grâce à eux et aux porteurs du projet, ce livre très singulier défie les lois du genre, tant par la largesse du périmètre qu’il embrasse que par la pluralité des formes et des voix qu’il réunit : on passe de l’article scientifique à la prose poétique, des dialogues très personnels aux études historiques… C’est une excellente porte d’entrée pour celles et ceux qui ont encore une image de la botanique comme une discipline sévère et sèche. Le lecteur migre au fil des pages avec les époques et les plantes, afin de s’enraciner dans un ici plus apaisé et apaisant.
Marion Grange, Bronwyn Louw (dir.), Les migrations des plantes, préface de Gilles Clément, postface de Jean-Marc Besse et Marielle Macé, Manuella Editions, 2024, 304 pages, 23 euros.