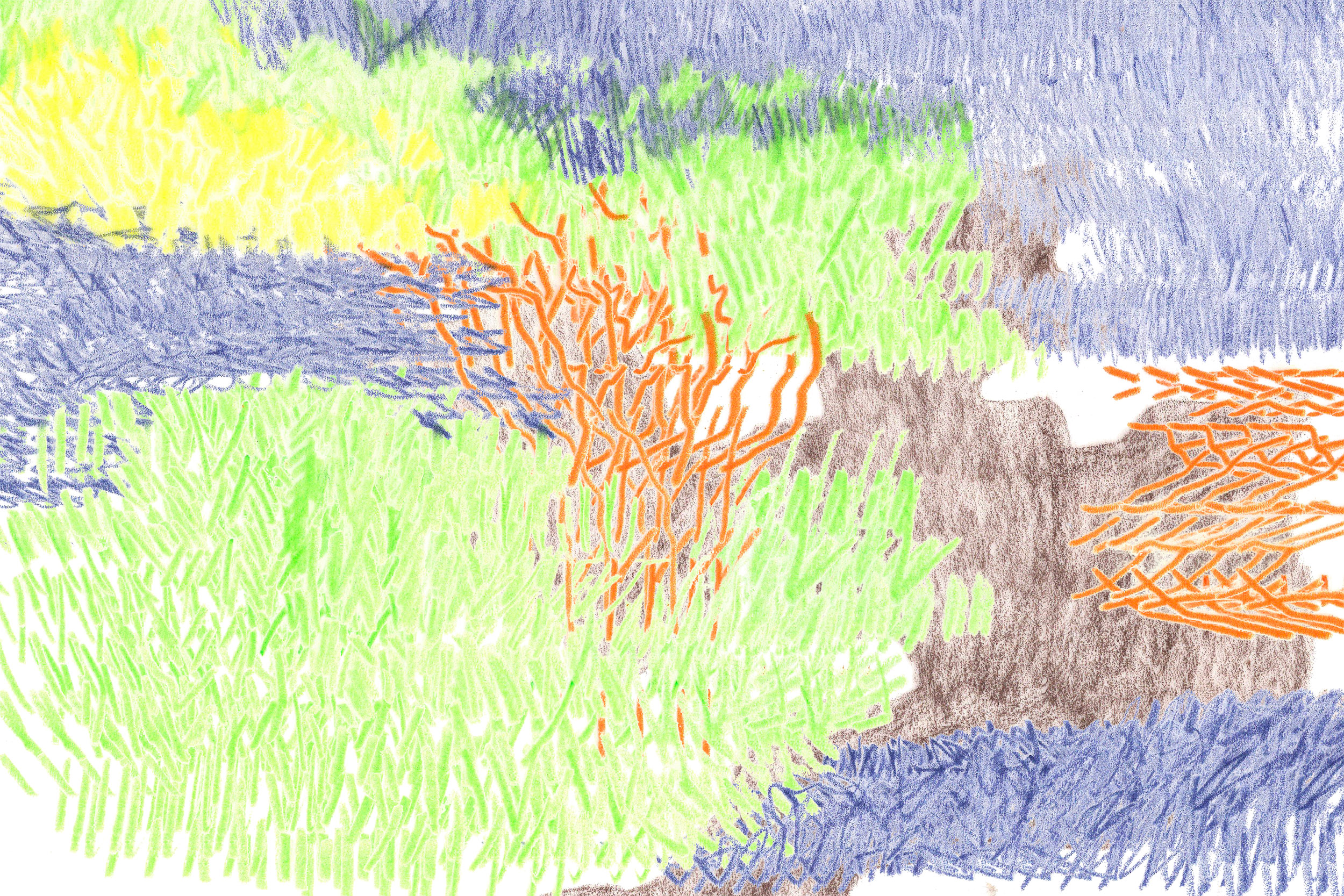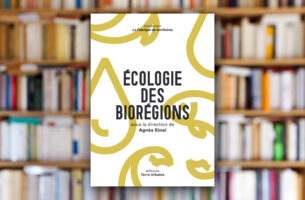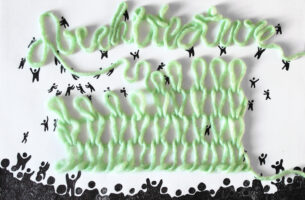Introduction
Une foule de bio-concepts sont apparus ces dernières décennies : le bio-centrisme, le bio-morphisme, le bio-mimétisme, le bio-régionalisme, la bio-assistance, la bio-inspiration, la bio-ingénierie, l’hypothèse bio-philique… On en finit plus de bio-concevoir ! Et parce que la discipline architecturale est tout sauf imperméable à son époque et aux débats qui la traversent, bon nombre d’architectes se sont déjà demandés de quelle manière concevoir des édifices inspirés de ces notions. Théoricien de l’architecture et auteur des Territoires du vivant, un manifeste biorégionaliste (Wildproject, 2023), Mathias Rollot revient sur les origines, les récupérations et les paradoxes du biomimétisme avant d’ouvrir la piste d’un biomimétisme des milieux pour l’architecture.
« Spontanément l'homme dans son activité imitera la nature. Mais on a depuis longtemps remarqué que les réalisations qui se bornent à copier la nature sont sans avenir (l'aile de l'oiseau reproduite depuis Icare jusqu'à Ader). »
Jacques Ellul (1)
Origines et récupérations
La définition de référence du « biomimétisme » nous parle d’« une nouvelle science qui étudie les modèles de la nature, puis imite ou s’inspire de ces idées et procédés pour résoudre des problèmes humains » (2). Drôle de science appliquée qui, si on en croit ces mots, tant s’occuperait de l’étude de la nature prise comme « modèle » (alors que la scientificité se dit dégagée de tout a priori normatif), qu’elle prétendrait aussi prendre en compte la transformation de ces études en procédés capables de résoudre « des problèmes humains » (un solutionnisme qui, en soi, n’a jamais été non plus la vocation de la science, fut-elle appliquée).
Sans surprise peut-être, voilà donc quelques temps déjà que le concept de biomimétisme a été récupéré par la société de consommation comme un excellent outil pour concevoir et promouvoir parfums de luxe, voitures électriques et autres smartphones « inspirés par la nature ». Et ainsi le biomimétisme est-il explicitement utilisé par la recherche en ingénierie dans une optique « d’innovation » – entendre par-là une logique assumée de croissance entrepreneuriale. En témoignent bien les auteurs d’un article portant sur l’ingénierie biomimétique, qui assument, en ouverture de leur texte, à quel point « innover a toujours été fondamental en ingénierie. L’entreprise qui innove se démarque, s’approprie habituellement des parts de marché, se développe et croît » ; raison pour laquelle il serait opportun de mettre en lumière « le potentiel d’éco-innovation associé au biomimétisme » dans une logique de « développement soutenable » (3).
Le concept, pourtant, était d’une toute autre teneurdans les écrits de Janine M. Benuys, scientifique et business-woman américaine qui participa grandement à populariser le terme à la fin des années 1990. Formée à l’écologie et à la biologie, Benuys (née en 1958) a enseigné la restauration écologique et la « soutenabilité », dans diverses universités américaines et a publié une demi-douzaine d’ouvrages sur ces questions, dont le plus connu, Biomimicry: Innovation Inspired by Nature, est paru en 1997. Elle a aussi co-fondé dès 1998 l’entreprise de conseil « Biomimicry 3.8 », entreprise privée se présentant comme « le cabinet de conseil bio-inspiré le plus important à l’échelle internationale en matière de conseil en intelligence biologique, en formation professionnelle et en discours stimulant (inspirational speaking) ». Rien que ça ! Ainsi la page personnelle de Benuys sur le site de l’Arizona State University raconte-t-elle que, de toutes les casquettes qu’elle a pu porter, « son rôle favori est celui de biologiste-engagée-à-la-table-avec-les-équipes-de-conception, informant les innovateurs au sujet des quelques 3,8 milliards d’années de solutions brillantes, validées par le temps » qu’on peut trouver dans la nature. Ce sont ces « solutions durables naturelles » qu’elle et son équipe ont proposé au fil du temps aux « 250 entreprises » avec lesquelles le cabinet a travaillé jusqu’à présent, parmi lesquelles « Boeing, Colgate-Palmolive, Nike, General Electric, Herman Miller, HOK architects, IDEO, Interface, Natura, Procter and Gamble, Levi’s, Kohler, General Mills »… Innover en matière de greenwashing, développer de nouvelles techniques commerciales et des concepts accrocheurs pour les investisseurs et les élu·es : serait-ce alors l’unique objectif de la théorie biomimétique ?
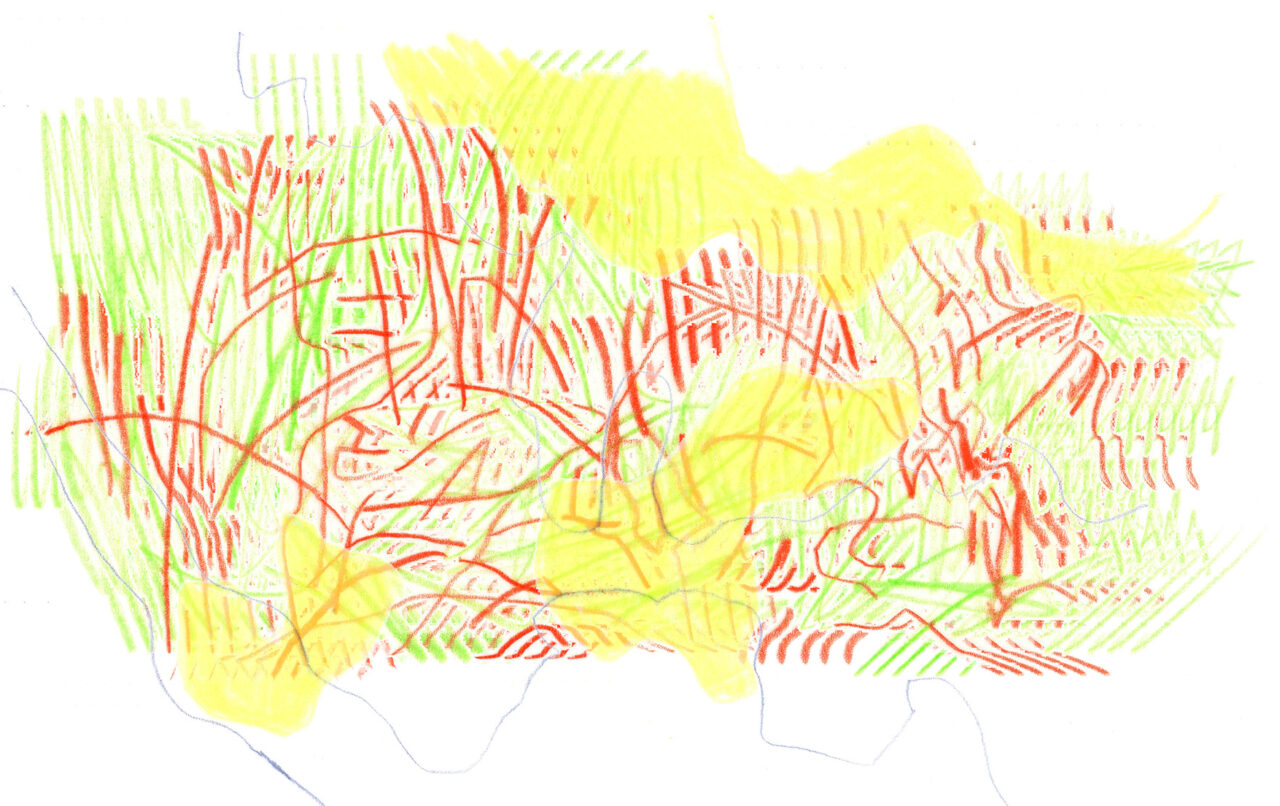
Principes originels
Bien loin des sirènes du green business, son ouvrage Biomimétisme faisait pourtant l’éloge explicite de la modestie ; c’était un hommage aux limites et à la frugalité, un éloge de l’art de l’attention à ce qui nous entoure et encore un plaidoyer, inquiet et sincère, envers l’état du monde contemporain. L’autrice jamais ne prétend ouvrir un nouveau paradigme par ce seul concept ; en même temps qu’elle assume et explicite bien le caractère immémoriel des pratiques biomimétiques de tous les peuples – des Indiens huaorani aux frères Wright, inventeurs de l’avion moderne, jusqu’aux laborantins actuels. Surtout, Benuys invite à considérer le concept comme un moyen et non comme une fin en soi, rappelant bien l’importance d’une révolution écologique qui soit avant tout cosmologique :
« Ce ne sera pas un changement technologique qui nous conduira vers un avenir biomimétique, mais un changement de nos cœurs, une humilité qui nous rendra attentifs aux leçons de la nature. Comme l’a fait remarquer l’écrivain Bill McKibbe, nous déployons toujours nos outils au service de telle philosophie ou idéologie. S’il nous faut les employer dans le sens d’une meilleure intégration sur la Terre, notre relation fondamentale à la nature, y compris l’histoire que nous nous racontons sur notre place dans l’univers, doit changer. » (4) C’est ce qu’il faut avoir à l’esprit pour pouvoir (re)considérer ce concept par-delà les récupérations que la société capitalistique a pu en faire (ne fait-elle pas de même avec toute chose ?).
Ainsi pourrions-nous consulter assez sereinement les dix principes évoqués par Benyus pour mettre en pratique le biomimétisme :
- Utiliser les déchets comme des ressources
- Se diversifier et coopérer
- Capter et utiliser l’énergie efficacement
- Optimiser plutôt que maximiser
- Utiliser les matériaux avec parcimonie
- Ne pas souiller son propre nid
- Ne pas épuiser les ressources
- Rester en équilibre avec la biosphère
- Se nourrir d’information
- Se fournir localement
Ces dix principes ne sont-ils pas applicables en tant qu’architecte ? Ainsi appliqués, ils semblent même assez proche de la démarche globale portée par le Mouvement de la frugalité heureuse et créative. L’un de ses initiateurs, l’architecte Philippe Madec lui-même évoquait d’ailleurs récemment le biomimétisme chez Janine Benuys, invitant les architectes à se passionner « pour les phénomènes naturels » tout alertant simultanément sur la « supercherie » à laquelle le biomimétisme est parfois ramené lorsqu’il est réduit à un pur « effet marketing commercial ».Les principes originellement proposés par Benuys en guise de conclusion à son ouvrage, « quatre étapes pour un avenir biomimétique », n’avaient pourtant rien d’une stratégie très commerciale :
- Se taire : s’immerger dans la nature
- Écouter : interroger la flore et la faune de notre planète
- Encourager la collaboration interdisciplinaire
- Préserver la diversité du vivant
De quelques paradoxes
Ainsi une potentielle architecture biomimétique devrait-elle probablement tenter de revenir à ces principes relevant plutôt de l’écocentrisme et de la frugalité, plutôt que de chercher « l’éco-innovation ». Mieux : elle devrait aussi se rappeler que ce sont ces démarches, ces valeurs morales, ces manières de se comporter qui sont les véritables finalités du biomimétisme, et non pas l’imitation caricaturale d’une figure naturelle simplifiée et instrumentalisée à la fois. En effet, c’est souvent ce que l’on entend sur le sujet : pour être biomimétique, il faudrait s’inspirer d’un fonctionnement de la nature pour en tirer un produit humain. L’analogie entre modèle et artefact devrait être évidente pour obtenir le label. Voilà – à mon sens – précisément l’erreur à ne pas commettre. En effet, outre les réserves déjà mentionnées précédemment, ce mode opératoire est fondé sur un système particulièrement dangereux : la pensée hors-sol, figée et universalisante – cela même que le paradigme scientifique des humanités écologiques s’est attaché à faire voir comme obsolète car factuellement faux. Le passage de l’une à l’autre vision du monde n’est certes pas aisé, car, comme le synthétise Deborah Bird Rose dans son ouvrage éponyme, « les changements dans l’acte de penser sont révolutionnaires : on passe de concepts de climax et d’équilibre aux concepts de déséquilibre proliférant ; des concepts d’objectivité aux concepts d’intersubjectivité ; des prédictions déterministes à une conscience des incertitudes fondamentales. » (5) C’est aussi en ce sens exact qu’on peut comprendre les propos d’Emmanuel Coccia argumentant que le concept « d’écosystème » est « tout à fait dépassé » en ce qu’il « présuppose l’existence d’un équilibre créé de manière presque mécanique et automatique », une hypothèse « fausse », qui n’a « rien à voir avec l’étude empirique de la réalité ». (6)
Bon nombre de biomiméticien·nes semblent vouloir poursuivre ces imaginaires et paradigmes épistémologiques obsolètes, ces mondes volontairement « fixistes », à la manière dont pouvait l’être L’Encyclopédie de Diderot et d’Alembert (où justement « la puce » est décrite telle qu’elle est, de façon parfaitement intemporelle et universelle). Mais voilà : ce faisant, n’enracinent-ils pas le concept dans un monde hyperrationnel et dualiste, voire, pour l’écoféministe Val Plumwood, intrinséquement dominateur ? (7)
Je me suis arrêté par le passé sur les manières dont un tel paradigme universalisant produisait une architecture tout aussi « atopique », monumentale (8). Pour l’heure, poursuivons en remarquant qu’on a beau différencier des biomimétismes de « forme ou de surfaces », d’autres « de processus ou de fonction » et encore d’autres « écosystémiques » (9), cela n’empêche : quand on en vient à croire que la « conception du « nez aérodynamique » du train haute vitesse japonais Shinkansen » s’inspire de « la forme du bec du martin-pêcheur » (10), ce n’est pas le train qui est conçu sur le modèle de l’oiseau, mais l’oiseau qu’on conçoit comme un produit industriel, uniforme et standardisé, parfaitement identique dans le temps et dans l’espace quelles que soient ses répliques.
En ce sens, on est alors quasiment revenu à la vision du monde portée par les tenants de la zootechnique, cette idéologique née au XIXe siècle pour qui « les animaux (…) sont des machines, non pas dans l’acception figurée du mot, mais dans son acception la plus rigoureuse, telle que l’admettent la mécanique et l’industrie. Ce sont des machines au même titre que les locomotives de nos chemins de fer, les appareils de nos usines où l’on distille, où l’on fabrique du sucre, de la fécule, où l’on tisse, où l’on moud, où l’on transforme une matière quelconque. Ce sont des machines donnant des services et des produits » (11). Or, comme l’a bien relevé Canguilhem, « la mécanisation de la vie (…) et l’utilisation technique de l’animal sont inséparables. L’homme ne peut se rendre maître et possesseur de la nature que s’il nie toute finalité naturelle. » (12)
En d’autres termes, prendre « le martin-pêcheur » comme modèle figé, c’est oublier qu’un martin-pêcheur est un membre unique d’une communauté culturelle tout aussi unique, qu’il est un existant à part entière, avec ses domaines conscients et inconscients (13), et non uniquement le représentant de son espèce, voire même que son appartenance à cette catégorie douteuse que nous nommons « espèce » pourrait bien être une pure vue de l’esprit tant ce concept fait aujourd’hui l’objet de vifs débats dans la communauté scientifique (14). Avec Adolf Portmann, on se rappellera que la forme animale n’est pas que l’expression mécanique de besoins environnementaux auxquels une espèce se serait purement adaptée – le prouve à elle seule la beauté animale, que les travaux de l’ornitologue Amotz Zahavi ont démontré être parfois une forme de « handicap » pour l’individu (15). C’est même au contraire, affirme le biologiste Josef Reichholf, « parce qu’ils sont tellement émancipés des contraintes de l’environnement » que tant d’animaux peuvent revêtir de tels attraits esthétiques ; de sorte qu’on peut considérer de bon droit que « le plumage majestueux et le spectacle de séduction rendent visibles le degré d’émancipation par rapport à l’environnement. » (16)
Vers un biomimétisme des milieux par l’architecture ?
Arrivé à ce point, l’enquête biomimétique prend alors un tournant inattendu. Non seulement il semble difficile, voire contradictoire, de vouloir prendre exemple sur « la nature » tout en essentialisant cette dernière et en la réduisant à une pure mécanique dont la forme serait parfaitement adaptée à sa fonction – à savoir sans nier cela même qu’on cherche à valoriser : Natura, soit étymologiquement « ce qui naît », ce qui est en permanence « en naissance ». Et de même, il paraît bien étrange de chercher à s’immerger dans son environnement par la copie d’une nature vivante qui, pour sa part, passe son temps à se singulariser et s’émanciper de son environnement.
Dans un article paru en 2017 sur le sujet, je défendais la possibilité théorique d’une autre forme de biomimétisme, qui pour sa part ne chercherait pas à caricaturer, à simplifier ou à universaliser son modèle ; un « biomimétisme des milieux », qui au contraire s’inspirerait d’un modèle issu de son contexte proche, et y chercherait justement ce qu’il a de singulier, de particulier voire d’émancipé :
« Pourrait-il être fait état d'un biomimétisme des milieux en architecture, d’une architecture inspirée des rythmes, énergies, structures ou symbioses naturelles situées dans une géographie donnée, unique et irreproducible ? Il serait en cela possible de s’inspirer, par exemple, non seulement de la structure générique de l’arbre, mais plus particulièrement encore, de la structure des arbres de la région concernée, pour voir quelles facultés d’adaptations ils ont développé au contact de celle-ci, de ses rythmes et principes. Ce serait faire le pari que dans l’étude des capacités d’élasticité ou d’élancement dont ils ont besoin pour pouvoir s’épanouir puisse se trouver, peut-être, la clef d’une nouvelle architecture plus adaptée encore à son environnement. Et en tout cela, dès lors, il ne serait plus question pour un potentiel « biomimétisme des milieux » d’imiter l’abstraction idéalisé d’un objet rendu générique et utopique, mais de ré-interpréter un objet considéré dans son ipséité et son caractère autographique. » (17)
Les années passent mais c’est toujours cette hypothèse qu’il me tient à cœur de mettre en lumière sur ce sujet, à la fois pour réhabiliter le sens originel de l’idée de biomimétisme tel que pouvait l’entendre Janine Benuys, et aussi comme méthode pour résister au mieux à la récupération capitalistique qui en est fait aujourd’hui.
Penser une architecture sur la base d’un « biomimétisme des milieux », en ce sens, ne signifie nullement en revenir aux propos fonctionnaliste idéalisant le couple forme-fonction comme une « loi intangible de la nature », à l’image de Louis Sullivan écrivant en 1896 dans son célèbre article« L’immeuble de grande hauteur envisagé d’un point de vue artistique » : « Qu’il s’agisse de l’aigle planant dans son vol, de la fleur éclose du pommier, du chêne branchu, du ruisseau qui serpente à ses pieds, des nuages qui dérivent dans le ciel, et par-dessus tout, de la course du soleil, la forme suit toujours la fonction : c’est la loi. Lorsque la fonction ne change pas, la forme ne change pas non plus. » (18) Preuve, au passage, que les discours bio-inspirés sont déjà bien anciens en architecture, et sont présents même chez les théoriciens du modernisme le plus fonctionnaliste ! Sans même revenir sur l’idée absurde qu’un nuage puisse avoir une « fonction » (voire une forme !), on s’éloignera donc également de la mise au singulier du monde réalisée par ces propos bio-inspirés : « la fleur » et « l’aigle », etc. mais aussi « la » forme et « la » fonction. Un biomimétisme des milieux en architecture aurait pour sa part à coeur de travailler avec des paramètres plus complexes, des entités plus dynamiques et des situations hautement plus paradoxales – point réaliste auquel doit probablement aboutir tout art de l’attention capable d’abandonner l’idéalisme et la pureté pour observer plus justement les individus et les milieux vivants en tant que ce qu’ils sont vraiment.
Un potentiel « biomimétisme des milieux » pourrait-il s’ouvrir à des inspirations moins dualistes en termes de nature/culture ? A savoir, en d’autres termes : le biomimétisme n’induit-il pas nécessairement une fracture entre la nature et la culture et une forme de « naturalisme » (au sens que donnait Philippe Descola à ce terme) ? N’induit-il pas une poursuite de l’idéologie de « l’exceptionnalisme humain » (la croyance, pourtant largement démontée par Darwin, que la différence entre l’humanité et le reste du vivant terrestre ne tiendrait pas de degré mais de substance) ? En affirmant qu’il est intrinsèquement « bon » de s’inspirer du non-humain, l’hypothèse biomimétique tend surtout à renforcer la frontière séparant l’humain du reste du vivant ; celui-là même dont on prétendait se rapprocher chemin faisant…
A l’heure où se multiplient les appels à constituer des communautés politiques solidaires avec le vivant non-humain, à se dégager des visions les plus anthropocentrées et des dualismes inopérants voire mortifères, à retrouver des synergies écosystémiques réellement interspécifiques et mutualistes, faut-il alors vraiment creuser plus loin la piste de « l’architecture biomimétique », fut-elle « des milieux » ? Le débat est ouvert !
Texte de Mathias Rollot. Illustrations de Moé Muramatsu.
A lire, à écouter
Mathias Rollot, « Pour un biomimétisme des milieux », dans Manola Antonioli, Biomimétisme. Science, Design et architecture, Paris, Loco, 2017, pp.111-121.
Mathias Rollot (2018), Les territoires du vivant. Un manifeste biorégionaliste, « Le Monde qui vient », Wildproject, 2023.
Mathias Rollot, « L’architecture localement bio- et géo-sourcée de Christophe Aubertin : régionaliste, biorégionaliste ? », Les Cahiers de la recherche architecturale urbaine et paysagère, 11 | 2021.
Mathias Rollot, Ce que le biorégionalisme fait à l’architecture, Conférence à la Faculté d’Architecture de l’Université de Liège, 8 février 2021.
Notes
(1) Jacques Ellul (1954), La Technique ou l'enjeu du siècle, Paris, Economica, 1990, p.18.
(2) Janine M. Benyus, Biomimétisme, Paris, Rue de l’échiquier, 2011, p.4.
(3) Philippe Terrier, Mathias Glaus et Emmanuel Raufflet, «Biomimétisme : outils pour une démarche écoinnovante en ingénierie», VertigO - la revue électronique en sciences de l'environnement [Online], Débats et Perspectives, 2017. URL: http://journals.openedition.org/vertigo/17914
(4) Benyuls, op. cit., p.23
(5) Deborah Bird Rose, Vers des humanités écologiques, Marseille, Wildproject, 2019, p.14.
(6) Emmanuele Coccia, « Le monde est un jardin avant d’être un zoo », Metal Hurlant, n°1, 2021, pp. 47-49.
(7) Lire en ligne : Julie Beauté, «De la critique des dualismes de Val Plumwood aux histoires subalternes enchevêtrées», Diacronie. Studi di Storia Contemporanea : « Can the Subaltern Speak» attraverso l’ambiente?, 44, 4/2020, 29/12/2020.
(8) « Les trois paradigmes de l’architecture » Cahiers du LHAC ; « De l’architecture », Relions-nous
(9) Philippe Terrier, Mathias Glaus et Emmanuel Raufflet, «Biomimétisme : outils pour une démarche écoinnovante en ingénierie», VertigO - la revue électronique en sciences de l'environnement [Online], Débats et Perspectives, 2017. URL: http://journals.openedition.org/vertigo/17914
(10) Idem (je souligne)
(11) Émile Baudement, Les races bovines au Concours universel agricole de Paris, en 1856, études zootechniques… (1862), cité par Émilie Dardenne, Introduction aux études animales, p.34
(12) Georges Canguilhem, La connaissance de la vie, Vrin, 1992, p.111
(13) Florence Burgat, L’inconscient des animaux, Paris, Seuil, 2023.
(14) Sur le sujet, Jérôme Ségal recommande la lecture de : Jean-Jacques Kupiec, Pierre Sonigo, Ni Dieu ni gène : pour une autre théorie de l’hérédité, Seuil, 2003 ; Hervé Le Guyader, « Doit-on abandonner le concept d’espèce ? », Courrier de l’environnement de l’INRA, n°46, 2022, pp.51-64; Richard Monvoisin, Timothée Gallen, « L’espèce est-elle morte ? Vive le flux spécien », L’amorce, n°24, 2020. Jerôme Ségal, Dix questions sur l’antispécisme. Comprendre la cause animale, Paris, Libertalia, 2021, pp.18-19.
(15) Amotz Zahavi & Avishag Zahavi, The handicap principle: a missing piece of Darwin's puzzle, Oxford University Press, 1997.
(16) Josef H. Reichholf, « l’expression de la beauté versus l’adaptation darwinienne », dans Florence Burgat, Cristian Ciocan (éd.), Phénoménologie de la vie animale, Zeta Books, pp.47-63, p.58 et p.60.
(17) Mathias Rollot, « Pour un biomimétisme des milieux », dans Manola Antonioli, Biomimétisme. Science, Design et architecture, Paris, Loco, 2017, pp.111-121, p.118.
(18) traduction de Clause Massu, Paris, Dunod, 1982, présent dans Michaël Labbé, Philosophie de l’architecture, Paris, Vrin, 2017, pp.183-196, p.194.