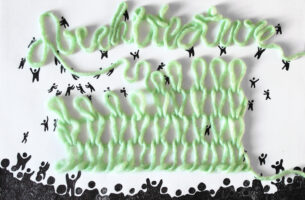Introduction
La pensée d’Ivan Illich (1926-2002), figure inclassable et incontournable de la critique de la société industrielle, se révèle toujours aussi stimulante et pertinente. Elle a nourri et continue de nourrir nombre de mouvements écologistes ainsi que cette humble revue. Illich démontre que les institutions passées un certain seuil deviennent contre-productives, c’est-à-dire se retournent contre leur fin, à l’instar de l’école qui désapprend – il appelle alors à déscolariser la société et prône une société conviviale favorisant l’autonomie et la créativité de chacun. Étienne Verne, dans cet article en deux volets, mêle la vie et la réflexion d’Illich sur l’école depuis la paroisse new-yorkaise jusqu’à l’aventure du Centre interculturel de documentation (CIDOC, 1966-1976) à Cuernavaca au Mexique – où il a séjourné, enseigné, étudié et contribué à la réflexion collective sur la scolarisation du monde (il signe avec Illich un livre intitulé Imprisoned in the Global Classroom, 1976) – et nous rappelle que le savoir n’est pas l’apanage du corps enseignant, tout comme l’école n’a pas le monopole de sa transmission.
Lire le second volet de cet article.
En hommage à Martin Fortier
Des sociétés sans écoles
Revenir en ce moment à Ivan Illich, en pleine pandémie de Covid-19, ne manque pas de sel ; lui dont on dit qu’il est oublié depuis longtemps(1). Dans une tribune que publie Le Monde, deux médecins demandent de ne pas céder le contrôle de notre existence à une science toute-puissante et à une institution incontournable : l’hôpital. « Profitons de ce moment de réclusion pour réfléchir à cette dépendance inouïe de l’homme envers la médecine, que dénonçait déjà Ivan Illich. Cette emprise a grandi à un tel point qu’elle est aujourd’hui capable d’arrêter le cours du monde. Un nombre incalculable de vies souffriront, voire s’effondreront, sous les effets secondaires de cette crise sanitaire. » (2)
L’auteur de Némésis Médicale (Seuil, 1975) ne semble pas totalement oublié par les professionnels de la médecine. Ce n’est pas le cas, semble-t-il, du côté des professionnels de l’enseignement. L’auteur de Une société sans école (Seuil, 1971) aurait-il été effacé des mémoires ? Pour des raisons qui relèvent de la santé publique, de très nombreux pays ont fermé leurs écoles. Pourtant, en cette période où l’état d’exception est la règle, l’école se fait toujours, mais à la maison. À distance, mais par les mêmes, ou par des suppléants, chargés de poursuivre le programme officiel. Toujours à distance : la correction des devoirs, les notes, les examens, le contrôle continu, les partiels, etc. De quoi rassurer : les principaux rituels restent en place. En Asie, en Europe, en Amérique du Nord et du Sud, etc., les élèves, les enseignants, les administrateurs, les personnels de service, ont déserté les établissements d’enseignement, de l’école maternelle à l’Université, il y a toujours école mais à la maison. L’école à la maison, un des avatars de la déscolarisation prévu et dénoncé (3) par Ivan Illich dans Une société sans école.
Il ne faudrait pas trop vite croire que nous vivons dans des temps illichéens : les écoles désertées, les déplacements limités, la consommation d’énergie en forte baisse, le chômage (créateur ?) en forte hausse, etc. jusqu’aux églises et lieux de culte abandonnés par leurs fidèles. L’hôpital tient. Derrière ces mots — Éducation, Santé, Salut, Transport, Énergie, Travail, etc. — les lecteurs d’Illich verront les institutions qui se sont appropriées chacun de ces « mythes » et dont il a fait une critique radicale.
Par la grâce d’une molécule de protéine mortifère, mais peut-être vivante, les écoles, qui ne sont pas encore un champ de ruines, sont délaissées. Il n’y aurait plus d’école. En fait, il y a toujours école… à la maison. Fin d’un rêve. Mieux : le retour à l’école est annoncé, managé, programmé, planifié, organisé, contesté. Difficile d’en douter, même en pleine pandémie, le monde d’après reprendra les voies du monde d’avant, le temps de demain sera celui d’hier. Le retour de tous à l’école en sera une des marques. Les enfants qui jouent, en ce moment, sous ma fenêtre, sur la pelouse de l’immeuble dans lequel eux et moi sommes confinés, me l’ont dit : « ils en ont marre ». Ils veulent y retourner. Ils ne sont pas les seuls. Une enseignante, éditorialiste par ailleurs, l’a annoncé, en tout début de pandémie, en toute candeur, naïve donc touchante : « Incidemment, on se rappelle la grandeur de notre rôle et la force du lien qui nous unit. Ce lien qui est le ciment de l’École, la condition de possibilité de la transmission. Ce lien si négligé : on peut espérer qu’il sera, au sortir de la crise, réhabilité. C’est en tout cas lui qui me permet de me recoucher, apaisée. » (4) Retour à l’École. Avec un peu plus de numérique, peut-être. Tout le reste, inchangé. Les fondamentaux d’une société scolarisée seront toujours là. Le Monde pourra remettre en ligne dans quelques années, comme il l’a fait le 17 avril 2020, une tribune publiée le 18 avril 2000 de Bruno Mattéi : « De la misère en milieu enseignant ». Au temps d’après, rien ne change.
La scolarisation selon Illich ou le « phénomène » école
Une relecture d’Illich aurait pour premier intérêt de mieux comprendre et d’agir en conséquence : « que faire ? » La réponse d’Illich à une question de ce type ne facilite pas la mobilisation militante : « Beaucoup de gens ont très raisonnablement cessé d’essayer d’améliorer les agences et organisations sociales desquelles, il y a à peine vingt ans, ils se sentaient responsables. Ils savent que tout ce qu’ils peuvent faire est d’essayer, par critères négatifs, de diminuer l’impact et la mainmise de cette idée de responsabilité sur leur milieu, afin d’être de plus en plus libres de se conduire anarchiquement comme des êtres humains qui n’agissent pas pour le bien de la cité mais parce qu’ils ont reçu de l’autre le don de pouvoir répondre à son appel. » (5)
Après avoir mis en cause la crédibilité d’un monde basé sur la citoyenneté, le civisme, la responsabilité, le pouvoir, l’égalité sociale, la satisfaction des besoins, les droits, les revendications, les luttes ; après la critique corrosive des institutions en charge de ces valeurs ; après un appel à une « inversion politique des institutions », il n’a à proposer que le choix de la non-puissance. À ne pas le comprendre, on risquerait bien de passer à côté, comme cela a été le plus souvent le cas, de ce qui porte sa critique des « outils ». Beaucoup des meilleurs lecteurs de Illich se sont arrêtés aux publications des seules années 70, celles qu’il qualifiera lui-même de « pamphlets » et dont il dira à des lecteurs convaincus qu’il ne s’y reconnait pas. Est-ce le cas pour Une société sans école ? en aurait-on fait une lecture trop courte ?
S’agissant de scolarisation, encore faut-il préciser ce qu’il entend, ce que nomme ce « phénomène » dont il s’emploie à faire, comme il le dit, la « phénoménologie » pour argumenter ses critiques. Avant de tenir un discours critique sur la scolarisation, dire quelles sont les marques de l’outil, celles qui vont tellement de soi qu’on pourrait ne pas les voir. Quand Illich parle de scolarisation, il désigne :
- l’obligation faite à tous d’aller à l’école pendant une période de cinq à quinze ans et d’être présent physiquement dans des établissements spécialisés ;
- le regroupement des élèves dans des groupes de 20 à 50 personnes ordonnées et hiérarchisées par niveaux, par classes (cinq), par âges, à parcourir en sens unique ;
- l’imposition à tous de programmes décidés bureaucratiquement par une administration le plus souvent étatique et centralisée ;
- le droit d’enseigner réservé à une catégorie de professionnels disposant d’un monopole radical ;
- la sélection des personnes sur la base d’apprentissages sanctionnés par des notes, des examens et des diplômes ;
- un enseignement dispensé dans des lieux spécialisés, coupés de la vie ordinaire et empêchant toute autre activité pendant 500 à 1 000 heures par an.
Ces fondamentaux sont toujours en place. Un exemple : la prolongation de la scolarité obligatoire, il y a deux ans, en France, à l’unanimité. L’école est obligatoire dès 3 ans, au lieu de 6 jusque-là.

[James R. Roberts - University Archives, Northwestern University Libraries]
J’ai rencontré Ivan Illich à la fin des années 1960. Il m’a invité à venir au CIDOC. J’y suis allé au tout début des années 1970. J’y suis retourné jusqu’à sa fermeture en 1976.
Il m’a appris à déchiffrer l’inefficacité du système scolaire et le « programme latent » de la scolarisation, et j’y adhérais. Je n’avais pas encore compris pourquoi il était vain de vouloir profaner cette institution sacrée en lui cherchant une alternative. Il m’a fallu encore plus de temps, pour comprendre ce qui fondait et donnait sens à cette critique : la croyance que « tout humain à sa naissance porte en lui le besoin d’être initié institutionnellement à la réalité concrète où il devra remplir ses devoirs de citoyens » (6), et de remonter à l’origine de cette croyance : « la sécularisation d’un rituel catholique. » (7) Un chemin qui ne se fait qu’en marchant, marqué pour Illich par le franchissement de lignes de partage des eaux (Illich aimait cette image) pour arriver jusqu’aux « fleuves au nord du futur», pour reprendre le titre d’un poème de Paul Celan, un ami de sa famille.
Lorsqu’il prononce ces phrases, Illich a derrière lui un long parcours. Je vais reprendre quelques-unes des étapes « pédagogiques » de ce parcours. On l’évoque trop rarement. Je le fais pour faire observer qu’il ne faut surtout pas le prendre pour un « pédagogue », même utopiste. À des « topophiles », il serait plus exact de parler, à son propos, d’hétérotopie, un itinéraire marqué par les lieux différents qu’il a habités.
L’« ennemi de l’école »
Paradoxe ou dissonance : l’« ennemi de l’école » a passé une partie de son temps à administrer un système d’éducation et une Université, à créer des centres de formation et d’étude, à élaborer des programmes de formation. Il a poursuivi son activité d’enseignant jusqu’au bout de sa vie.
Au départ, un homme, un intellectuel certainement, un scholar, mais indépendant. Il le restera. Il commence ses activités professionnelles (une expression inconvenante s’agissant d’Illich qui n’a jamais manqué de dénoncer le « monopole radical » des professionnels sur les services) comme curé, ou plutôt vicaire, d’une paroisse peuplée de migrants portoricains à New York où il arrive en 1951. Occasionnellement, il enseigne à Princeton University, où il supplée Jacques Maritain lorsque celui-ci ne peut pas assurer son séminaire sur la philosophie thomiste pour raison de santé. Il enseigne aussi à Fordham, l’Université des Jésuites à New York. Auparavant, il a étudié pendant six ans la philosophie et la théologie (« la plus traditionnelle et la plus obscurantiste qui soit ») à l’Université Grégorienne à Rome, après des études de cristallographie à Florence, de philosophie de l’histoire à l’Université de Salzbourg.
Ordonné prêtre à Rome en 1951, il part à New York. L’expérience de l’immigration portoricaine à New York est l’occasion d’un choc qui va déclencher une première bifurcation. Il lance un programme d’enseignement de l’espagnol pour le clergé new-yorkais très majoritairement de souche irlandaise. « Il me semblait important que les gens à New York connaissent suffisamment d’espagnol et aient respiré suffisamment d’air tropical pour qu’ils ne soient pas effrayés par ces ‘marrons’ qui les envahissaient. » (8) Il se préoccupe de la nécessité d’une méthode qui permette un rapprochement amical entre les New-Yorkais d’origine et les Portoricains. Prêtres, « éducateurs, travailleurs sociaux, tous se retrouvaient emportés dans une foule qui parlait espagnol. La connaissance de cette langue leur devenait nécessaire ; mais il leur fallait plus encore savoir entendre, partager l’angoisse d’une population qui demeurait solitaire, effrayée et impuissante. » (9)
Illich ne parle pas souvent de « méthode » pédagogique. Il comprend vite que l’étude de l’espagnol n’a pas de sens en dehors de la prise en compte d’un contexte géopolitique, social, économique, culturel, etc. « On peut savoir fort bien construire des phrases à l’aide du vocabulaire et de la grammaire et se trouver plus éloigné de la réalité que celui qui a conscience de ne pas connaître une langue. » (10) Il ne savait pas encore qu’au même moment, au Brésil, dans une région déshéritée, le Nordeste, Paolo Freire développait cette même intuition pédagogique avec des dispositifs d’alphabétisation par la « conscientisation » : la maîtrise de son monde avec son propre langage. Paolo Freire deviendra quelques années plus tard un grand ami. Illich l’encouragera à écrire et à publier La pédagogie des opprimés (Maspero, 1974). Même engagés sur des routes bien différentes, ils le resteront. Paolo deviendra le très grand pédagogue du XXe siècle.
[James R. Roberts - University Archives, Northwestern University Libraries]
Pour Ivan, la pédagogie comme théorie de l’éducation et/ou comme discours sur la méthode ne sera qu’un passage. Avec l’apprentissage intensif de la langue parlée, il développe un programme d’expériences sur le terrain, l’étude de la culture portoricaine, de ses poètes, de son histoire, de ses chants et de la réalité sociale de l’île caribéenne. Il va y passer des vacances. Il n’hésite pas à dire que ce programme n’est pas que l’occasion d’apprendre de nouvelles connaissances et de maîtriser de nouvelles compétences linguistiques, mais est aussi une expérience de transformation spirituelle. Il pensait que l’apprentissage d’une langue était « une des rares occasions pour un adulte de passer par une profonde expérience de la pauvreté, de la faiblesse et de la dépendance au bon vouloir des autres ».
Cinq ans plus tard, en 1956, Il est nommé Vice-Recteur de l’Université Catholique de Porto Rico à Ponce. Une île où il occupera aussi la fonction de membre, puis de Président du Conseil Supérieur en charge de tout le système éducatif de Porto Rico. À ce titre, il ira jusqu’à se battre pour que soit adoptée une loi portant à cinq ans la scolarisation des enfants portoricains. « Ainsi investi de ce pouvoir administratif et consultatif sur les questions éducatives sur la petite île de Porto Rico, j’avais lieu de me demander dans quelle action je m’engageais. » C’est à ce moment et en ce lieu que l’école devient pour lui un objet de curiosité : « C’est quoi, ce truc ? Jusque-là, je n’y avais jamais vraiment réfléchi. Ça va me prendre dix ans. »
Dans son enfance, la fréquentation de l’école n’avait jamais été vraiment son « truc » : ce n’est pas à l’école qu’il a appris enfant toutes les langues qu’il maîtrisait (à 6 ans, ses « langues normales », celles qu’il parlait, étaient le français, l’italien et l’allemand, en plus du serbo-croate), ni à l’école qu’il aurait lu tous les livres de la bibliothèque de sa grand-mère, les dictionnaires en particulier. Dans l’école élémentaire de Vienne où sa mère voulait l’inscrire, on utilisait déjà des tests et il avait été mis dans la catégorie : « enfant retardé ». Une « école qu’il n’a jamais prise au sérieux » et une fréquentation en pointillé, ne l’avaient pas particulièrement conduit à en faire l’objet de ses réflexions. (11)
C’est l’époque, les années 1960, où les anciennes « colonies » sortent du « tiers-monde » et deviennent des « pays sous-développés ». Dans les années 1970, Ils deviendront des « pays en voie de développement » grâce à l’action conjuguée de toute une armada d’Agences internationales dont c’est la mission. Encore un effort, et, toujours grâce à ces Agences et aux cohortes diverses et variées de « Volontaires pour le Progrès », ils passeront plus tard au statut de « pays émergents ». Les premières analyses qu’Illich va faire de la scolarisation sont sorties du regard qu’il porte sur le système éducatif de Porto Rico au moment précis où l’école est prise à la fois comme objet et comme vecteur principal du développement. Le moment et le lieu sont importants. À Porto Rico, la moitié des élèves de l’école élémentaire, ceux venant de familles pauvres, avaient une chance sur trois de finir les cinq ans de scolarité obligatoire. Les gens qui planifiaient, organisaient, finançaient, construisaient les écoles le faisaient comme partout pour qu’il y ait plus d’égalité, pour que tous aient des chances égales, comme on le disait alors et comme on le répètera jusqu’à aujourd’hui, pour promouvoir plus de justice sociale, pour dynamiser le développement, etc.
Dans tous ces domaines, les effets observés par une intensification de la scolarisation sont de même dimension ou pire. L’école est un dispositif qui produit plus d’échecs que de succès. Pour y parvenir, les politiques et les planificateurs ont augmenté la durée de la scolarisation obligatoire. À la sortie, vous ne retrouvez jamais tous ceux qui y sont entrés. Les personnes que l’école rejette à un moment ou un autre de la trajectoire scolaire sont toujours plus nombreux que ceux qu’elle sélectionne pour la suite du parcours, sauf à refuser de voir les mesures bureaucratiques adoptées pour masquer ce phénomène. Ceux qui sont rejetés (les dropouts, « déscolarisés », « réorientés », « rattrapés », etc.) sont aussi ceux qui auront fait l’expérience d’un service public obligatoire qui aura réussi à justifier qu’ils sont et resteront des laissés-pour-compte. Il leur restera la frustration et le ressentiment, et, pour des groupes entiers, la violence qui leur permet de les traiter. « Vous êtes exclus, mais vous en connaissez les bonnes raisons ». L’école démocratique discrimine et justifie cette discrimination par les résultats pédagogiques. Si la scolarisation ne le faisait pas, elle ne répondrait d’ailleurs pas à sa fonction sociale. Ce n’est qu’un exemple des premiers constats qu’Illich prend en compte. Soixante ans plus tard, ils sont toujours les mêmes. Mais on persévère, toujours et encore. L’institution qui n’a toujours pas réussi à tenir les promesses par lesquelles elle se justifie, reste en place, toujours plus prometteuse des mêmes chimères, toujours intouchées.
[James R. Roberts - University Archives, Northwestern University Libraries]
Il ouvre à Porto Rico un centre de formation pour l’apprentissage de l’espagnol ouvert aux missionnaires que les conférences épiscopales d’Amérique du Nord et d’Europe envoient en Amérique latine pour sauver l’Église dans cette région. La sauver du communisme surtout. Au moment où le département d’État américain mobilise plusieurs agences et envoie en Amérique latine des milliers d’agents, le Vatican demande aux conférences épiscopales d’Amérique du Nord et d’Europe d’y envoyer 10 % de leurs prêtres. Illich a inscrit les centres de formation qu’il va créer, à Porto Rico d’abord, au Brésil ensuite, et, enfin, au Mexique, dans cette mouvance. Il va aussi dénoncer le « missionarisme » et les politiques de développement, et leur amalgame. Cette situation est le point de départ des critiques radicales qu’il va développer, à commencer par l’Église catholique. Sa critique du développement va de pair avec celle du missionarisme, celle des missionnaires avec celle des agents de développement. La formation de tous ces transhumants, habités des meilleures intentions, s’impose à tous ceux qui supportent ces politiques comme une évidence « fonctionnelle ». Pour exercer leur mission, il faut les former et d’abord à la langue espagnole. Il va proposer un dispositif pour dispenser cette formation avec le même rationnel « pédagogique » que celui développé à New York, mais avec d’autres intentions.
Les commanditaires, financiers, sponsors, ne vont pas s’apercevoir, – en tout cas pas tout de suite –, que les buts visés par Illich ne sont pas les leurs. Ses intentions : convaincre les candidats missionnaires de rentrer chez eux. Ils ne sont pas précisément d’ordre pédagogique : mobiliser des moyens pour détourner les missionnaires et les « Volontaires » (on connait les « Volontaires du Progrès », il y avait aussi les « Volontaires du Pape » (12)) de leur « vocation ». Ses objectifs : « éviter que les dommages que risquait de provoquer la demande du pape soient trop considérables » ; dispenser « un programme d’études » qui mette les futurs missionnaires « en face et d’eux-mêmes et de la réalité pour qu’ils puissent en connaissance de cause refuser ou accepter » ; « acquérir une influence suffisante pour être à même de convaincre les autorités responsables de renoncer à l’exécution d’un tel programme. » (13) À ceux qui partent pour annoncer la bonne parole aux déshérités de pays pauvres et les initier à l’american way of life, il propose de méditer sur « l’éloquence du silence », dit plus trivialement : apprendre à se taire, se débarrasser de tout ce qui les a poussés à imaginer que leur mission était de faire bénéficier les déshérités des pays pauvres de la bonne parole et de la civilisation occidentale. Avec une grammaire beaucoup plus difficile à apprendre que celle des sons.
Lire le second volet de cet article.
À lire
Ivan Illich (2003), Œuvres complètes. Volume 1 : Libérer l’avenir – Une société sans école – Énergie et équité – La convivialité – Némésis médicale, Préface de Jean Robert et Valentine Borremans, Traduction, Paris, Fayard.
Ivan Illich (2004), La perte des sens, Traduit de l’anglais par Pierre-Emmanuel Dauzat, Paris, Fayard.
Ivan Illich (2005), Œuvres complètes. Volume 2 : Le chômage créateur – Le Travail fantôme – Le genre vernaculaire – H2O – Du lisible au visible : la naissance du texte – Dans le miroir du passé, Préface de Thierry Paquot, Traduction, Paris, Fayard.
Notes
(1) Pour ceux qui ne le connaîtraient pas et les autres, la meilleure introduction : Thierry Paquot, Introduction à Ivan Illich, La Découverte, 2012.
(2) Éric Caumes, Maurice Maillet : « Coronavirus. Gardons-nous de tomber dans une réactivité maladive, viro-induite, sociale et politique », Le Monde, 16/04/2020.
(3) Par ex., cf. Ivan Illich, De la nécessité de déscolariser la société, UNESCO, 1971. Ce document avait été rédigé à la demande de la Commission Internationale sur le développement de l’éducation. Les travaux de cette Commission ont débouché sur la publication faite sous l’égide de Edgar Faure, Apprendre à être, Fayard, 1972. Le plus grand projet d’éducation totalitaire proposé sous couvert d’humanisme. Inutile de dire que la contribution de Illich n’a pas inspiré les membres de la Commission.
(4) Mara Goyet, « La beauté des liens », in L’Obs, 20/03/2020, p.6.
(5) David Cayley, Ivan Illich, La corruption du meilleur engendre le pire, Actes Sud, 2007, p.298. (Un recueil d’entretiens enregistrés à la fin des années 1990).
(6) David Cayley, Ivan Illich, op.cit., p.197. Le titre en anglais était : The Rivers North of the Future, Toronto, Anansi Press, 2005.
(7) David Cayley, Ivan Illich., op.cit., p.198.
(8) D. Cayley, Ivan Illich in Conversations, p.87 (l’édition française : D. Cayley, Bellarmin, 1996, est introuvable).
(9) Ivan Illich, « L’éloquence du silence », in Libérer l’avenir, Seuil, 1971, p.39.
(10) Ivan Illich, id.
(11) Toutes ces informations sont dans Cayley, op.cit., p.59 et ss.
(12) Beaucoup d’étudiants sont envoyés par un organisme catholique américain : le PAVLA (Papal Volunteers for Latin America)
(13) Ivan Illich, op.cit., p.49.