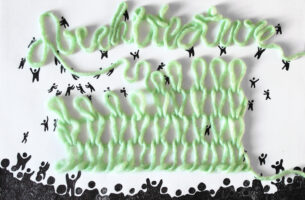Introduction
La pensée d’Ivan Illich (1926-2002), figure inclassable et incontournable de la critique de la société industrielle, se révèle toujours aussi stimulante et pertinente. Elle a nourri et continue de nourrir nombre de mouvements écologistes ainsi que cette humble revue. Illich démontre que les institutions passées un certain seuil deviennent contre-productives, c’est-à-dire se retournent contre leur fin, à l’instar de l’école qui désapprend – il appelle alors à déscolariser la société et prône une société conviviale favorisant l’autonomie et la créativité de chacun. Étienne Verne, dans cet article en deux volets, mêle la vie et la réflexion d’Illich sur l’école depuis la paroisse new-yorkaise jusqu’à l’aventure du Centre interculturel de documentation (CIDOC, 1966-1976) à Cuernavaca au Mexique – où il a séjourné, enseigné, étudié et contribué à la réflexion collective sur la scolarisation du monde (il signe avec Illich un livre intitulé Imprisoned in the Global Classroom, 1976) – et nous rappelle que le savoir n’est pas l’apanage du corps enseignant, tout comme l’école n’a pas le monopole de sa transmission.
Lire le premier volet de cet article.
En hommage à Martin Fortier
L’immersion latino-américaine
En octobre 1960, Illich est limogé par l’évêque de Ponce. Sa présence est devenue « dangereuse » après le combat politique qu’il a mené contre ceux qui mettent « l’évangile au service du capitalisme (ou de toute autre idéologie) » (1). Commence un long périple qui va lui faire parcourir toute l’Amérique du Sud alors en pleine effervescence révolutionnaire. Au bout du voyage, Cuernavaca, au Mexique, la ville « sous le volcan » décrite par Malcom Lowry, la ville résidentielle et touristique connue pour son « éternel printemps ». L’évêque de la capitale du Morelos, Méndez Arceo, a une solide réputation d’évêque progressiste. Il lui rend une première visite, sans s’annoncer, pour commencer une conversation qui va durer neuf heures. Illich dit que, dès la première phrase, il annonce son projet : « j’aimerais créer ici un centre de formation dédié à la déyanquification ». Ce centre (le CIF : Centre pour une Formation Interculturelle) est ouvert en 1961. Il recrute vingt-cinq enseignants locaux, tous entre vingt-cinq et vingt-huit ans. Ils assurent chacun au moins cinq heures de cours par jour à des groupes de quatre étudiants : trois heures d’exercices guidés, au moins une heure de laboratoire de langue, une autre heure de conversation dirigée ou de grammaire.
Plus intensément qu’à Porto Rico, ce sont bien deux logiques qui s’entremêlent et s’entrechoquent alors : théologique et politique. Une théologie de la mission qui est un refus de toute compromission avec les luttes contre la pauvreté administrées par les agences internationales et les gouvernements des pays riches et industrialisés. Une politique du développement qui préserve la liberté des communautés locales à choisir elles-mêmes et à décider de ce qui est bien pour elles. Sur le terrain plus politique, il veut peser sur les décisions prises par les instances dirigeantes et « les dissuader de mettre leur plan à exécution ». Il écrit en 1966 « The Seamy Side of Charity », soit « Le côté sordide de la charité » (2). L’article est publié dans la revue America. « Charité » chrétienne et « aide » sont mis dans le même sac : ce que les nantis ont trouvé de mieux à faire pour ceux qu’ils ont assignés au statut de « pauvres ». Elles font l’objet d’un même procès appuyé par la critique des deux rationalités qui les supportent : théologique et politique. Une controverse à fort retentissement qui est délibérément orientée, à ce moment, vers un choix : travailler pour la révolution en Amérique latine ou rentrer à la maison.
Le CIF devient progressivement un centre dédié au travail intellectuel. Illich organise de nombreuses rencontres, notamment avec des théologiens radicaux. Les publications, les CIF Reports en particulier, sont diffusés à partir de 1962. Elles portent pour l’essentiel sur « les réalités sociales, économique et politiques de l’Amérique ». De centre de formation à la langue espagnole et aux réalités latino-américaines, le CIF devient de plus en plus un centre de recherche d’alternative pour la région qui s’appuie sur tout un réseau d’intellectuels et de théologiens avec des ramifications au Brésil et au Pérou en particulier. C’est ce foyer qui est à l’origine du CIDOC, un CIF sécularisé.
Commence alors, ou se poursuit, un long et très dur conflit avec les autorités de l’Église catholique. Il va se terminer par un procès inquisitorial que le Vatican instruit en 1968. À la suite de ce procès, Illich « renonce à bénéficier des privilèges de l’état ecclésiastique ». Cette « sécularisation » a été anticipée par la création du CIDOC (Centro Intercultural de Documentación) en 1964. Il ouvre en 1966. Son statut, son organisation n’ont plus rien à voir avec l’Église institutionnelle. Il l’installe en 1966 dans un nouveau campus. On y retrouve l’empreinte du CIF, mais c’est bien d’un autre lieu dont il s’agit. La distance physique marque dans l’espace l’arrivée dans un autre monde. Le CIDOC n’est plus une institution confessionnelle.
Le CIDOC : un lieu convivial
J’arrive à Cuernavaca pour la première fois dix ans après la création du CIF. Je découvre un grand parc, une végétation tropicale, des pelouses, des allées. Dans le parc, divers bâtiments plus ou moins cachés, des lieux de réunion, des lieux de détente (bar, snack). Au centre, la « Casa Blanca », une grande maison de style californien. Trois niveaux. Au premier, donnant sur le parc, la bibliothèque (le cœur de l’entreprise), une salle de lecture, des salles de réunion. Au deuxième, des salles de réunion, des bureaux. Au troisième, des locaux plus privatifs et une terrasse. C’est là que, le matin, avant le lever du soleil, Illich convie les personnes avec lesquelles il souhaite converser tout en prenant un premier café. En toile de fond, le Popocatepelt (5426 m), son sommet encapuchonné toute l’année de neige, ses fumerolles… et le soleil levant qui l’éclaire.

[James R. Roberts - University Archives, Northwestern University Libraries]
Après le cadre, le public, très diversifié. En ce début d’année, le Centre est plein : 200, 300… jusqu’à 600 personnes, suivant les semaines. Aux mois de janvier, de février… vous avez ceux qui viennent du Nord de l’Amérique pour y trouver chaleur et soleil : un point de rassemblement obligé pour des transhumants qui s’affichent « contre-culture », « New Age », « Hippies »… Ils logent dans leurs camping-cars autour de Cuernavaca. Ceux d’Amérique du Sud, ils sont en vacances d’été : souvent des militants, izquierdistas, très engagés politiquement, s’ils ne sont pas ou pas encore dans la « lutte armée », chrétiens de gauche, déjà marqués par la « théologie de la libération », à la naissance de laquelle Illich a présidé lors d’une réunion qu’il a organisée à Petropolis (à côté de Rio de Janeiro) en février et mars 1964. Beaucoup de « latinos » vivent dans une sorte de caravansérail, « El Ciruelo », une grande et énorme bâtisse, sombre, l’ancien séminaire du diocèse de Cuernavaca. J’y retrouve François de l’Espinay. Il dirige la maison. Il a été un des premiers étudiants du CIF, en charge des prêtres français envoyés comme missionnaires en Amérique du Sud par la Conférence des évêques. Il avait été pendant la guerre d’Algérie aumônier général des armées en Algérie avant que l’état-major ne le remercie après ses prises de position sur la torture. Il ne faut pas oublier tous ceux qui n’entrent pas dans ces catégories : intellectuels, « scholars », professeurs, politiques, journalistes, cinéastes, etc. Une dominante parmi les participants : une forte concentration, mais hétéroclite, de « radicaux ». Un public disparate, bigarré.
Une « université libre » ? Plutôt un lieu pour favoriser les rencontres et les échanges, un convivium, un sumposion. Illich aimait ces mots qui désignaient d’abord : « le partage de la soupe, du vin ou d’autres liquides ». Un lieu « où tout repose sur la conviction qu’il faut pouvoir partager ce qui est vraiment important avec d’autres qu’avant tout on aime et avec qui dès lors on veut partager. » (3) Pour entrer sur le campus, il vous faut un badge qui vous est remis contre un droit d’entrée, modeste, plus élevé pour les américains du Nord et les quelques européens, plutôt symbolique pour les sud-américains. Avec le badge qui vous donne accès à tous les services du Centre, vous signez un « règlement », très court, mais d’application stricte jusqu’à l’exclusion en cas de non-respect. Pour comprendre, il faut se rappeler le contexte latino-américain de la fin des années 1960 et du début des années 1970, plus précisément la violence des luttes politiques, souvent armées, partout présentes. Le règlement prévoyait, au moins à une époque, l’interdiction de porter des armes à l’intérieur du campus, liée à l’interdiction d’utiliser le Centre pour organiser tout type d’action politique subversive ou révolutionnaire. Il prévoyait aussi que les « intervenants », ceux qui proposaient d’animer un séminaire, et souhaitaient une rémunération, devaient la négocier avec les participants, mais la négociation ne pouvait commencer que deux heures après qu’il ait exposé le contenu du séminaire et les méthodes d’investigation utilisées.
À partir de là vous pouviez vivre, lire, écrire, apprendre, vous détendre, converser, débattre, boire, manger dans l’enceinte du CIDOC comme vous l’entendiez, avec qui vous le souhaitiez et sur tous les sujets que vous vouliez. Exemple : un architecte venu au CIDOC avec des questions sur sa discipline. Il témoigne que les échanges avec d’autres participants l’ont aidé à définir et à donner forme à son projet : l’utilisation du film dans la formation des architectes. Le CIDOC lui a donné l’opportunité de démarrer une aventure intellectuelle avec un groupe de personnes auxquelles il a pu présenter et discuter son projet. (4)
[James R. Roberts - University Archives, Northwestern University Libraries]
Pas de programme imposé, pas de curriculum, pas de diplôme, même pas de certificat de présence. Les activités, séminaires, groupes de discussion, groupes de recherche, classes, conférences, etc., sont affichés à la semaine ou à la quinzaine. Ceux qui les proposent — et tous ceux qui sont inscrits peuvent le faire — les présentent, généralement le vendredi matin en fin de matinée, à un moment entièrement banalisé, sur la pelouse du campus. Les groupes se constituent, se font, se défont. Les participants inscrivent leur nom. L’administration du CIDOC affichera « le programme » de la semaine suivante une fois la « foire » terminée et attribuera aux groupes constitués un lieu de rencontre sur le campus. Des activités qui couvrent des domaines très variés : philosophie, éducation, médecine, architecture, histoire du Mexique et autres pays latino-américains, et tout un ensemble d’autres sujets. J’ai suivi un cours d’obstétrique dispensé par une indienne mexicaine illettrée, par curiosité, mais plusieurs sommités médicales étaient là. André Gorz, une autre autorité, s’est inscrit à un de mes séminaires. Pas de statut clivant : vous pouvez participer à des enseignements et diriger un séminaire. Il serait trop long de rappeler ici la liste des intervenants prestigieux qui ont participé et dirigé des séminaires au CIDOC.
Le CIDOC héberge l’ICLAS (Institute for Contemporary Latin Studies). Ceux qui veulent assurer un enseignement l’annoncent dans le Catalogue. Lorsque cinq étudiants ou plus se sont inscrits, le « dialogue » est programmé. Un de ces Course Catalogue, en 1970, en offrait jusqu’à quarante-cinq. Un professeur venu de New York remarquait que, pour lui, le plus dur était de dispenser un cours de deux semaines à des étudiants qui n’étaient soumis à aucune obligation, sans test, sans prérequis, sans évaluations. Autre « rituel » enfin : le Ciclo, un programme de conférences données par des experts, résidents ou visiteurs, à 11 h 00 chaque matin. Illich y participe jusqu’en 1972.
Il resterait à ajouter aux activités du CIDOC l’activité d’édition, et ce n’est pas la moindre : près de soixante publications par an, du volume à quelques feuillets, tous imprimés sur papier bible pour être expédiés à moindre coût, tous imprimés sur place. C’est de cette fournaise que sortiront les cinq premiers livres d’Illich édités au début des années 1970.
« Au nord du futur »
À partir de 1972, Illich n’intervient plus dans le cadre du Ciclo. En 1973, il quitte la Casa Blanca et va habiter à Ocotepec, à cette époque un village rural. Il y construit avec les paysans du coin une curieuse habitation, utilisant un matériau traditionnel : l’adobe (argile, paille hachée, eau). Illich est déjà ailleurs. Si l’inversion politique des institutions est de moins en moins à son agenda, il va s’employer, dorénavant, à l’expliquer et à comprendre pourquoi il en est arrivé là. Et à découvrir, peu à peu, la forme de vie qu’il convient d’adopter : l’amitié, l’ascèse et la non puissance. Le CIDOC sera fermé en 1976. Il consacrera de plus en plus son enseignement à des groupes d’amis.
À suivre cet itinéraire, ponctué par une succession d’initiatives pédagogiques, on pourrait douter qu’il ait été celui suivi par l’auteur d’une Société sans école. Mais la pédagogie, l’analyse de la scolarisation, n’étaient déjà plus ce qui retenait l’attention de tout ce public. On n’allait pas au CIDOC pour vérifier ce que pouvait être une société sans école, ni pour y découvrir un modèle d’institution conviviale. Pour ma part, j’avais lu au fur et à mesure de leurs publications, les textes rassemblés dans Libérer l’avenir, y compris « L’école ou la vache sacrée » ; et je n’en oubliais pas le sous-titre : « Appel à une révolution des institutions ». Lorsque nous venions à Cuernavaca au tout début des années 70, c’était pour nous conforter dans l’idée qu’il fallait changer le monde de façon radicale et, pour cela, savoir mener une critique radicale, mais surtout pertinente, des institutions existantes, ou, comme l’écrivait Illich à ce moment, nourrir notre « action politique » non pas essentiellement à partir d’une « idéologie préalablement acceptée », mais à partir d’un « style » qui « marquera[it] la transformation du conflit latent entre l’homme et l’outil en une crise ouverte, exigeant une réaction globale et sans précédent », disposer d’« une grille interprétative afin de reformuler les valeurs et de réévaluer les intérêts » (5).
Serait-ce trop dire ou mal dire qu’on y allait pour « se déniaiser », après avoir réalisé l’inanité des idéologies alors dominantes – le marxisme et la psychanalyse – et subi les impérialismes exercés par leurs chapelles respectives ? La déscolarisation de la société, une politique de convivialité, étaient une alternative. Les écrits des années 1960, la plupart des textes critiques des années 1970, ont encore la révolution comme horizon. On y lit des appels à un changement politique radical. Mais, avec un peu plus d’attention et un peu moins d’assurance, il aurait déjà été possible de repérer qu’Ivan avait déjà dépassé cette étape « politique ». J’ai fait référence tout à l’heure à Libérer l’avenir (1969, pour l’édition en anglais). Sans doute avions-nous passé trop rapidement sur les pages où il se démarquait d’un personnage : celui du « révolutionnaire politique » qui « ne veut qu’améliorer les institutions existantes sur le plan de la productivité, de la qualité ou de la distribution de leurs produits » ; trop vite, sur celles où il prenait ses distances avec une « révolution uniquement politique » (6) ; et encore plus vite sur celles où le pouvoir n’était plus au centre de toute passion politique. Si la distance mise l’était par rapport au « révolutionnaire politique », au profit du « révolutionnaire culturel », la « désirabilité de la révolution » était déjà bien entamée, bien avant, en tout cas, que la critique du « désir de révolution » devienne un lieu commun de la pensée politique. Dans ses premiers entretiens avec Cayley, il rapporte qu’il en était « arrivé à [se] demander qui étaient ces jeunes gens […] qui parlaient de révolution et de ce renouveau auquel ils voulaient se consacrer », et qu’il s’était demandé : « quels [étaient] les antécédents de la révolution d’aujourd’hui ? de la possibilité de désirer un changement social ? »
[James R. Roberts - University Archives, Northwestern University Libraries]
En tout cas, ces « jeunes gens » n’étaient pas là pour découvrir de nouvelles pédagogies. Ils avaient pu avoir quelques faiblesses pour des pratiques pédagogiques alors innovantes, et s’essayer à en faire usage dans leur propre pratique (la pédagogie non directive, la pédagogie institutionnelle, etc. ou les méthodes audiovisuelles, comme on disait alors). Ils n’en étaient pas moins là pour inventer un projet de déscolarisation de la société. Et Illich de nous mettre sur un projet de repérage des « avatars de la déscolarisation.» (7) C’est le titre d’un séminaire qu’il nous avait demandé à Heinrich Dauber et à moi-même d’organiser en 1974. En filigrane, le souci de Illich de se démarquer de tout ce et de tous ceux qui estimaient pouvoir se couvrir de son autorité pour justifier les innovations qu’ils proposaient (free schools, école à la maison, « nouvelles » méthodes pédagogique, « nouvelles » technologies pédagogiques, réseaux d’apprentissage, etc.) ou s’autoriser de son parrainage pour recycler de vieux mythes pédagogiques (« éducation permanente », « éducation récurrente », « formation continue », « éducation tout au long de la vie », etc.).
Nous pouvions être quelques-uns à chercher et à expérimenter les voies de la déscolarisation, à mettre en place une alternative à l’école. Ce fait ne doit pas faire oublier que le plus grand nombre avait refusé l’analyse illichienne de la scolarisation. Ce refus commençait et s’arrêtait au titre donné à l’édition française de Deschooling Society : Une société sans école. La traduction littérale aurait été : « déscolariser la société ». Le titre français n’a pas facilité la réception de cet ouvrage. La cible d’Illich n’était pas l’école, mais la scolarisation, un phénomène social massif, global, uniforme, devenu incontournable dans nos sociétés, envahissant. On aurait été plus proche de l’idée d’Illich si on avait compris que celui-ci rêvait plutôt de sociétés où fleuriraient « mille » écoles. À la place, nous avons l’école unique, universelle, et uniforme. Cette globalisation est la forme prise par la scolarisation. Il n’y a plus qu’un seul système scolaire global(8). Une standardisation qui permet de jauger chaque système scolaire national — il n’y en a plus qu’un ! —, de comparer les établissements d’enseignement entre eux avec les mêmes indicateurs, et de jauger le niveau de chaque élève à l’aune d’un même instrument de mesure. Après avoir été imprégné de notation scolaire, il ne faut pas s’étonner qu’on puisse se laisser prendre aujourd’hui sans soucis excessifs dans les filets de la notation sociale.
Deschooling society a été le premier d’une série de livres portant sur la critique sociale des institutions de service. Plus tard, il prendra ses distances avec ce qu’il appellera des « pamphlets ». Il n’en renie rien, mais il reconnaît que la critique qu’il en fait ne concerne que les effets les plus manifestes. Comme tels, ces « pamphlets » se suffisent à eux-mêmes et peuvent être largement partagés et utilisés par ceux qui se limitent à une lecture séculière. Mais la compréhension qu’il va en donner, il va l’énoncer par la suite à un tout autre niveau de profondeur. En historien, ou en ethnologue, il aurait pu se limiter à l’analyser comme « la sécularisation d’un rituel catholique ». Ou se satisfaire de faire l’histoire d’homo educandus, une espèce dont il aurait aimé écrire l’histoire, et découvrir, en en faisant la généalogie, comment on en est venu à croire à « l’idée que l’homme a besoin d’une révélation magistrale pour connaitre tel ou tel aspect de la réalité, et que cette révélation gagne à être administrée à travers un rituel strictement organisé » (9) ; ou : « remonter à l’origine de cette croyance, propre à notre culture, que seule une institution structurée peut rendre les gens compétents quant à ce qui est bon pour eux-mêmes et la collectivité, savoir qu’on n’acquiert pas en vivant mais bien à travers l’educatio. » (10) . Il fait de l’educatio, une lecture théologique, à la manière qui lui est propre de faire de la théologie, tout en refusant d’être vu comme un théologien. Et de comprendre que lorsque nos sociétés sécularisées ont adopté la scolarisation, elles ont aussi « tété » au sein de l’Église, et sucé avec son lait, la corruption du meilleur, celle qui engendre le pire.
Lire le premier volet de cet article.
À lire
Ivan Illich (2003), Œuvres complètes. Volume 1 : Libérer l’avenir – Une société sans école – Énergie et équité – La convivialité – Némésis médicale, Préface de Jean Robert et Valentine Borremans, Traduction, Paris, Fayard.
Ivan Illich (2004), La perte des sens, Traduit de l’anglais par Pierre-Emmanuel Dauzat, Paris, Fayard.
Ivan Illich (2005), Œuvres complètes. Volume 2 : Le chômage créateur – Le Travail fantôme – Le genre vernaculaire – H2O – Du lisible au visible : la naissance du texte – Dans le miroir du passé, Préface de Thierry Paquot, Traduction, Paris, Fayard.
Notes
(1) Ivan Illlich, op.cit., p.48.
(2) Ivan Illich, “La charité trahie », in Libérer l’Avenir, op.cit., p.48-64.
(3) David Cayley, Ivan Illich, La corruption du meilleur engendre le pire, op.cit., p.205.
(4) « CIDOC: Alternatives in Design and Education”, Architectural Record, July 1971, p.117-118.
(5) Ivan Illich, La convivialité (1972), in Ivan Illich, Œuvres complètes, vol.1, préface de Jean Robert et Valentina Borremans, Paris, Fayard, 2003, p.571.
(6) Ivan Illich, Libérer l’avenir (1971), in Ivan Illich, Œuvres complètes, op.cit., p.193 et ss.
(7) H. Dauber, E. Verne, L’école à perpétuité, Seuil, 1974.
(8) Ivan Illich, Etienne Verne, Imprisoned in the Global Classroom, London, Writers and Readers Publishing Company, 1976.
(9) David Cayley, Ivan Illich, op.cit., p.197.
(10) David Cayley, Ivan Illich, op.cit., p.199.