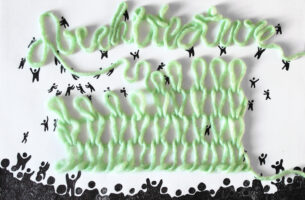Introduction
Alors que les étudiants se questionnent sur le sens des métiers qu’on leur propose, alors que les jeunes (et moins jeunes) travailleurs et travailleuses bifurquent en remettant en cause le travail tant son organisation que sa finalité, la sociologue du travail Geneviève Pruvost - autrice du Quotidien politique (La Découverte, 2021) - enquête sur le milieu de l’éco-construction. Elle explore, compare et distingue dans l’essai suivant, publié en trois volets, les chantiers participatifs, les chantiers autogérés, et les chantiers collectifs. Quand construire un lieu revient à construire des liens, le chantier devient politique, le geste manifeste.
Le chantier collectif comme action directe
Les chantiers participatifs qui se déploient au sein de la lutte d’occupation menée à Notre-Dame-des-Landes proposent encore une autre configuration de la participation et de la démocratie directe au travail : il n’y a pas d’échange marchand du savoir, ni même d’échange de sa force de travail contre des biens en nature. La formule « chantier collectif » est du reste préférée à celle de « chantier participatif ». Quant au terme « travail », il renvoie à un cadre légal d’activités rémunérées qui ne saurait être en usage sur ce site d’expérimentations libertaires. La question de la participation et de l’organisation des tâches mérite ici d’être posée à nouveaux frais : dans cette lutte, il ne s’agit pas seulement de militer ponctuellement contre la construction d’un aéroport, mais aussi de proposer des modes de vie alternatifs visant à révolutionner, entre autres, le rapport au travail. La sociologie du travail et des professions ne saurait par conséquent se passer de l’étude des luttes d’occupation (par-delà les usines) pour comprendre les transferts qui s’opèrent entre l’espace-temps militant et l’acquisition de savoir-faire, pouvant conduire à de véritables conversions indissolublement professionnelles et politiques.
En témoignent les effets de la lutte du Larzac qui associent tous ces niveaux de reconfiguration. C’est ainsi qu’une partie des militants antimilitaristes venus défendre les terres agricoles contre l’extension du camp militaire de 1971 à 1981 a concrètement aidé les fermiers mobilisés dans la défense de leurs terres au point de devenir des éleveurs de brebis — ou, plus exactement, des paysans politisés qui ont renouvelé le syndicalisme agricole en créant la Confédération paysanne en 1987 et contribué à la constitution de l’altermondialisme. S’il est trop tôt pour mesurer les effets sur le long terme de la lutte menée à Notre-Dame-des-Landes, l’observation ethnographique permet en revanche de rendre compte de l’intensité des échanges de savoirs à tous niveaux : pour une partie des militants, participer aux activités qui se déploient sur les 1650 hectares de cette zone relève d’un apprentissage tout à la fois politique, agricole et artisanal.
Participer, c’est prendre position
Si la lutte est totale — « contre l’aéroport et son monde », selon la formule consacrée —, elle prend notamment pour cible « les grands projets inutiles » (Camille, 2014) et, par là, vise tout particulièrement le BTP, en tant que secteur énergivore, fondé sur l’exploitation d’intérimaires au profit de grands groupes qui ont partie liée avec les marchés financiers et l’État qui les subventionne.
Un rappel chronologique des événements s’impose ici (10) : en 1972, un projet de construction d’un aéroport est arrêté dans la campagne nantaise à Notre-Dame-des-Landes par les aménageurs du territoire. Le projet sera enterré, puis réactivé comme projet d’intérêt public en 2008, en dépit de la loi européenne sur l’eau qui interdit de construire sur une zone humide. S’amorce une première vague d’occupation de cette zone à aménagement différé (ZAD) par des opposants à l’aéroport. Une deuxième étape est franchie quand en 2010, Vinci, premier opérateur européen de concessions d’infrastructures (autoroutes, ouvrages routiers, parkings, aéroports), obtient l’ensemble des terres et le marché de construction et de gestion de l’aéroport. Le conflit se radicalise à partir d’octobre 2012 quand plus de deux mille agents des forces de l’ordre viennent détruire une grande partie des fermes squattées et des cabanes construites et expulser leurs occupants en vue de commencer les travaux. En réponse à la violence policière, le 17 novembre 2012, une manifestation de réoccupation est organisée, réunissant plus de 40 000 personnes pour reconstruire ce qui a été détruit. Suit une deuxième vague de peuplement : la ZAD, rebaptisée « zone à défendre », passe de 80 à 250 habitants permanents. Il ne s’agit alors pas seulement d’édifier des barricades pour empêcher les assauts des forces de l’ordre, mais de manifester une opposition radicale aux politiques d’aménagement du territoire, pensées comme autant d’instruments de contrôle des populations, en édifiant, entre autres, des cabanes. La ZAD se visite comme un lieu d’expérimentations anarchistes à ciel ouvert.
On retrouve dans cette lutte les paradigmes de la preuve par l’exemple et de la politisation du moindre geste. Il s’agit bien de bâtir autrement : au béton, au fuel et aux fosses septiques chimiques sont préférés le bois, les matériaux de récupération, l’isolation en feutre, en paille et en terre, le poêle, l’énergie solaire et les toilettes sèches. En cela, les cabanes de la ZAD héritent du savoir-faire à la fois artisanal et militant de toute une population qui a fait le choix politique — et non économique — de l’habitat léger (roulottes, yourtes, tipis, cabanes) en zone rurale, et qui s’est mobilisée en 2010 pour contester l’adoption de la Loi d’orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure du 21 décembre 2010 (LOPSI 2) visant à interdire ce mode de vie. Vivre de peu, cesser de bâtir en dur, réduire l’emprise humaine au sol constitue un credo décroissant que les militants les plus rétifs à l’écologie politique sont contraints d’adopter, une fois immergés dans le bocage, étant donné les difficultés objectives d’accès à l’eau et à l’électricité. Pour les zadistes peu sensibilisés à l’écologie, aller à la ZAD, c’est dès lors simultanément faire l’expérience d’une lutte — avec son cortège de réunions, de manifestations, d’actions ciblées et d’un mode de vie rural où la hiérarchie des activités manuelles est totalement revisitée. Nombreux sont les récits militants qui relatent la même histoire sidérée d’incorporation du modus vivendi de la zone, qu’il s’agisse d’ingénieurs, d’étudiants, d’itinérants vivant en camion ou d’anciens cuistots, et qu’on peut synthétiser en ces termes : « je suis venu pour manifester à la ZAD, je pensais rester trois jours et ça fait un an que je suis là. Je ne pensais pas que je dormirais dans une cabane, encore moins que j’apprendrais à en fabriquer une ».
La construction collective de cabanes participe plus largement d’un type de mobilisation politiquement situé s’inscrivant dans le sillage de l’Action mondiale des peuples qui a eu lieu à Toulouse en 2006, des altervillages d’ATTAC depuis 2008, du Camp climat qui s’est déroulé en 2009 à Notre-Dame-des-Landes, ou du chantier éclair organisé par un squat de Lausanne en 2010, consistant à préfabriquer clandestinement et en autogestion une maison en paille et à l’installer le plus vite possible dans un parc public pour militer pour le droit au logement (Collectif Straw d’la balle, 2013). Les comités de soutien qui se sont créés en France, s’inscrivant dans ce même registre d’action, ont ainsi préconstruit des cabanes démontables et remontables sur le site. Construire à la ZAD en un temps record avec des biomatériaux relève par conséquent de l’action directe non violente, prolongeant le geste accompli par les chantiers participatifs en une prise de position, dans tous les sens du terme, dans l’espace public.
De quel espace public s’agit-il ? La zone est délimitée en apparence par des barricades. Elle n’en est pas moins un espace ouvert dans lequel véhicules et piétons peuvent librement circuler. Les barricades sont en réalité des chicanes qui obligent, matériellement et symboliquement, les passants à ralentir, marquant le passage dans un monde affranchi du droit privé et public. Construire une cabane à Notre-Dame-des-Landes, c’est par conséquent accomplir un acte de libre expression politique, poussant jusqu’à son terme le geste entrepris par l’écoconstruction militante : bâtir n’est pas un « travail », c’est la matérialisation d’un projet de société. Toutes les participations à ce projet sont-elles néanmoins les bienvenues, ou assiste-t-on à des regroupements militants exclusifs ?
Qui fait quoi ? Divisions et turn-over militant
La participation la plus massive aux chantiers collectifs de la ZAD prend place en premier lieu lors des manifestations d’ampleur organisées sur le site qui, dans ce cas, ne se préoccupent pas des clivages militants, puisqu’il s’agit de faire nombre. Riverains, Nantais, Bretons, camarades de lutte venant de l’Europe entière, anarchistes de toutes les mouvances, autonomes, membres ou sympathisants d’Europe écologie et du Front de gauche participent de concert à des « chantiers participatifs plus plus plus » (selon la formule d’un charpentier rencontré en Bretagne), par-delà l’étendard des partis, qui ne sont pas admis sur le site.
Le processus est différent pour les cabanes préconstruites par une partie des comités de soutien à la lutte de Notre-Dame-des-Landes qui se fondent avant tout sur des réseaux régionaux d’interconnaissance issus des mêmes cercles militants. La construction de cabanes par les résidents sur place obéit également à des logiques affinitaires, qu’elles soient politiques ou liées à la constitution d’amitiés. On a ainsi pu observer que des écolos radicaux qui prônent uniquement l’usage de clous, de marteaux et de scies, voire de bois mort et non vivant, ne vont pas initier un chantier avec des zadistes pour qui le squat des cabanes déjà construites ou des maisons existantes, jugées plus confortables, prime sur toute autre considération.
Il serait toutefois réducteur de considérer que cette répartition affinitaire des chantiers constitue l’unique mode de ventilation de la main-d’œuvre. Le principe d’ouverture est maintenu par la prolifération des « collectifs » (11), qui permet de trouver son cercle militant, sans compter les mutations politiques qui s’opèrent à l’échelle biographique : pour certains, cheminer dans l’espace-temps de la ZAD peut consister à passer de cabane en cabane, autrement dit à expérimenter différents modes de vie et différentes propositions politiques. Le principe d’entraide entre voisins rebat également les cartes des divisions initiales. Plus que de logiques affinitaires, il s’agit d’expériences plurielles et croisées qui rendent impossible toute cartographie figée de cette lutte.
Cette pluralité des expériences est renforcée par le défilé continu des sympathisants à la cause, encouragé par le site internet de la ZAD qui se fait le messager hebdomadaire d’appels à participation aux chantiers collectifs, drainant une population sensibilisée à cette cause, mais non nécessairement militante (au sens classique du terme). Pour ne donner que quelques exemples, certains pensaient se promener en curieux sur la zone, se trouvent à participer à un chantier d’isolation en laine d’un dôme géodésique et séjournent in fine plus longtemps que prévu. D’autres pensaient « casser du flic » sur les barricades et, arrivant au printemps, se lancent dans l’agriculture.
L’intégration à divers chantiers des étudiants et collègues de notre collectif d’enquête (12) est symptomatique de ce processus de conversion. Précision importante par rapport aux alternatives écologiques précédemment étudiées, les sociologues sont considérés dans cet espace en lutte comme des experts inféodés à l’État capitaliste. Dans un tel contexte, il ne s’agit pas de faire de l’observation participante ou de la participation observante, mais de la participation à temps plein. La question de la neutralité ne se pose pas : aller à la ZAD, c’est soutenir cette lutte d’occupation et y contribuer dans la mesure de ses moyens et de ses préférences politiques. Dans mon cas, aller à la ZAD a principalement consisté à faire des chantiers. Quid du travail proprement sociologique ? Il fut rétrospectif et, point fondamental, collectif : multiplier les points de vue (à la fois politiques et sociologiques), débriefer ensemble, créer des liens d’amitié et de confiance entre nous, autant d’opérations qui se sont imposées comme nécessaires pour comprendre l’inventivité sociale de cette mosaïque politique inédite.
Résultat important de ce dispositif d’enquête, nous avons tous pu participer à des chantiers, quels que soient nos affiliations politiques et notre degré d’engagement militant préalable. C’est bien la preuve que la contribution à la geste zadiste l’emporte sur les logiques affinitaires qui sous-tendent chaque chantier.
Lors des sept séjours que j’ai pu faire à la ZAD de 2012 à 2014, un même principe d’organisation s’est à chaque fois dégagé : toute personne présente sur les lieux peut proposer son aide, sans connaître le moindre zadiste sur le chantier. Personne ne vous demande d’où vous venez, pourquoi vous êtes là, ni même comment vous vous appelez. « Tout le monde s’appelle Camille », est-il significativement répété à la ZAD afin d’affirmer par ce prénom épicène que cette lutte n’a pas de leader identifié. Nul chef, nul président d’association à qui demander une quelconque autorisation. Ce principe radical d’entrée libre est de prime abord déconcertant : le rituel d’accueil et de visite guidée du chantier — auquel se livrent ordinairement les commanditaires des chantiers participatifs — est sur la ZAD très variable et le plus souvent absent. Seuls les pauses et l’engagement dans la durée permettent d’entrer dans des relations plus personnelles que diffère l’impératif militant de discrétion.
À la différence des chantiers participatifs ou des chantiers autogérés d’Interstelle, la main-d’œuvre n’est par ailleurs pas stabilisée et change de jour en jour : les zadistes, concepteurs des plans de la cabane, dont certains sont des professionnels de la construction ou des bricoleurs expérimentés, assurent le lancement du chantier, mais ils ne seront pas présents à plein temps, pris par d’autres activités militantes ou professionnelles. À ceci s’ajoute que personne ne peut prévoir le nombre de participants de passage à la ZAD, encore moins leurs compétences. « Y a-t-il un pilote dans l’avion ? », s’exclamera avec humour un zadiste sur un chantier, cherchant une visseuse et ne trouvant personne capable de lui répondre. Ce brouillage est entretenu par l’absence de désignation des uns et des autres par un quelconque titre : personne n’oserait employer le terme de « chef de chantier ». On retrouve ici l’esprit horizontal des chantiers participatifs qui conduit les plus experts en écoconstruction à accomplir les travaux de force comme les autres, accentuant l’effet d’indistinction des niveaux de compétence. Il n’en reste pas moins aisé de repérer très vite les personnes ressources, capables de vous dire ce qu’il faut faire et surtout de vous expliquer comment le faire.
Étant donné le turn-over des zadistes, la dimension pédagogique, mise en avant par les chantiers participatifs, peut-elle être maintenue ? Des ateliers sur des techniques constructives spécifiques sont proposés, renvoyant à la tradition militante de l’éducation populaire qui prévaut dans l’écoconstruction. Ces ateliers s’en distinguent toutefois par leur gratuité totale et la revendication d’une position amatrice : « On est là pour apprendre ensemble, faire des essais-erreurs. On ne veut pas de pros qui se mettraient en position de surplomb. L’idée, c’est que tout le monde s’approprie la technique, fasse sa propre expérience des matériaux », revendique une animatrice d’un atelier d’écoconstruction. La transmission pédagogique est censée s’accomplir dans le cours du chantier : une personne trouve toujours le temps de vous expliquer tel ou tel geste technique.
Distinction majeure par rapport aux chantiers participatifs, il est possible de ne rien faire, de juste regarder. Étant donné la main-d’œuvre surnuméraire, il est ainsi fréquent qu’il y ait plus de gens à discuter que de main-d’œuvre active. La règle implicite est que la participation au chantier se fait sur la base du volontariat. Ces chantiers sont bel et bien ouverts au public en ce qu’ils se donnent à voir et à photographier — à partir du moment où aucun visage n’est identifiable — en vue de diffuser la bonne nouvelle de la détermination zadiste : « aussitôt détruit, aussitôt reconstruit ». Autre point de divergence avec les chantiers participatifs, la participation à un chantier ne conditionne aucunement le droit à une quelconque contrepartie en nature : il est conseillé aux visiteurs de venir avec de quoi manger et il n’est pas garanti qu’il reste de la place dans les « sleepings » collectifs.
En bref, la règle de participation la plus partagée sur l’ensemble de la zone est celle de l’offre volontaire de sa force de travail en fonction des besoins du chantier en cours.
Brèches fondatrices
Cette autorégulation des places dans le travail de construction ne s’accomplit toutefois pas sans heurts, ni opération de clôture.
L’une des revendications du groupe féministe qui s’est constitué à la ZAD concerne précisément le sexisme de certains zadistes sur le chantier des barricades et des cabanes qui, par toute une série de gestes et paroles déplacés, reproduisent le stéréotype de l’inaptitude technique des femmes, décourageant certaines de participer à l’action de construction (13). Dans l’idée de proposer une transmission de savoir-faire qui prenne en compte ces expériences d’exclusion, un chantier en non-mixité, réservé aux « meufs-trans-gouines », a été organisé sur la zone entre avril et septembre 2013. Il ne s’agissait pas, pour les féministes de la ZAD, d’accuser l’ensemble des chantiers d’(hétéro)sexisme, mais bien de rendre visible cette discrimination transversale à toutes les luttes.
La construction de cabane, du choix des matériaux à celui de sa situation géographique, constitue un autre point de conflit majeur : pour certains écologistes radicaux, il n’est par exemple pas cohérent de pirater le réseau nucléaire d’EDF pour alimenter en électricité les nouvelles constructions. Cette position est loin d’être partagée sur la zone, peuplée de squatters, de punks, d’autonomes et d’agriculteurs pour qui la lutte anti-nucléaire n’est pas fondatrice. Le tronçonnage des arbres de la zone suscite également de houleux débats : pour les uns, il est aberrant de détruire la forêt de ce bocage pour construire des cabanes en bois ; pour les autres, l’usage des ressources locales et l’entretien de la forêt justifient de prélever quelques fûts. Les premiers sont qualifiés de « primitivistes » et d’« embrasseurs d’arbres » par les seconds, taxés quant à eux de « bourgeois » qui se sont trompés de lutte.
Le conflit le plus récurrent touche le choix d’implantation des cabanes : faut-il investir les friches, les forêts, les champs des agriculteurs, les routes, les chemins ? Ces options n’ont rien d’anecdotique, elles dessinent des alliances avec les paysans et les riverains et rendent compte d’un plus ou moins grand souci de la cause environnementale. Ces clivages politiques engendrent des stratégies de répartition sur la ZAD. C’est surtout à l’est de la zone que se trouvent les collectifs les plus engagés dans une démarche de sobriété anti-industrielle et de « deep ecology » (Naess, 2009).
Un autre conflit vient perturber le principe d’échange libre : comment gérer l’usage du matériel et de l’outillage de chaque chantier ? À l’ouest de la zone, un atelier avec des outils a été constitué par des dons. Toute personne peut se servir librement, à condition de rapporter les outils après usage. Les difficultés de circulation et la dispersion des cabanes sur les 1650 hectares, surtout pour les cabanes de l’est qui se trouvent à l’écart des circuits de dons spontanés, n’ont cependant pas rendu possible le maintien d’un minimum d’outillage commun. Les zadistes viennent munis de leur propre outillage et le prêtent dans un cercle de confiance.
Pour ce qui concerne le matériel de construction, une règle tacite veut par ailleurs que tout matériel accumulé près d’un chantier lui soit réservé. Mais la pratique du « freeshop » — terme qui désigne sur la ZAD le fait de se servir librement dans des espaces prévus à cet effet — s’étend parfois au stock des chantiers en cours, suscitant des conflits qui du point de vue des « freeshoppers » sont contraires à l’esprit de la ZAD où rien n’appartient en propre à personne. On touche ici une dimension fondatrice des chantiers collectifs à la ZAD : la non-propriété.
Sur ce point, les conflits cessent. À l’instar des chantiers participatifs, contribuer à la construction d’un habitat n’implique pas de droit de propriété, ni même de droit d’usage sur ce lieu. Le moment de partage d’un chantier est à lui-même sa propre fin. Une étape supplémentaire est cependant franchie par rapport à l’autoconstruction participative : initier la construction d’une cabane, avoir acheté les matériaux et l’outillage n’accordent pas de droits spécifiques sur la cabane construite. Un collectif de zadistes qui a construit sa propre cabane, s’il se disperse, peut voir cette même cabane investie par d’autres qui, voyant la porte ouverte et les lieux désertés, décident de s’y installer, d’ajouter des éléments de construction et de finition. L’architecture hirsute des cabanes qui passent de mains en mains témoigne de ces occupations successives.
Ainsi la cabane est-elle à tous égards un chantier collectif ininterrompu reposant sur une participation fondée sur un don sans contre-don, sans exigence de contrepartie (Testart, 2007). Ce mode de construction n’est pas seulement un outil militant ; il incarne une autre manière d’habiter les territoires. Dans le même temps et indissociablement, se diffuse un autre rapport au travail. Une partie des zadistes vit sur ses économies ou du RSA et s’en contente, actualisant le projet politique gorzien d’un revenu d’existence qui ne conduirait pas à l’inactivité : des cabanes habitables sont édifiées, des champs sont cultivés. L’évaluation marchande du « boulot » (à la ZAD, le terme de « travail » est proscrit) est également contestée par la dissociation des activités productives et des rétributions. Nul n’est contraint de contribuer aux différentes tâches nécessaires à la vie du site ou d’être formé au nom d’une libre participation et d’une libre formation. À la norme de la professionnalisation et de la spécialisation est opposée la viabilité de savoirs polyvalents, éminemment profanes.
Il est impossible de se figurer les lignes d’horizon que peuvent former la combinatoire de ces principes et leur diffusion à terme. On se bornera à constater que des agriculteurs, des étudiants, des ouvriers, des artisans, des employés, des travailleurs sociaux, des chômeurs, des punks se rendent à la ZAD, participent à la construction d’une cabane, d’un four à pain, d’une serre et en ressortent, métamorphosés : ils quittent leur emploi, songent à fonder une SCOP, font des séjours d’initiation et de formation dans des « écolieux », projettent d’acheter un terrain ou d’intégrer un collectif déjà installé sur un site et s’engagent dans d’autres luttes, en plus de celle de Notre-Dame-des-Landes. Il s’agit bien d’une expérience politique totale.
Conclusion
Du point de vue des écoconstructeurs engagés et des zadistes, il va de soi que « les activités liées au travail (occupation) sont si fondamentales [...] qu’elles fournissent le schème, ou le cadre, de l’organisation structurelle des traits mentaux » (Dewey, 1976, pp. 41-42, cité et traduit par Renault, 2012, p. 141), lesquels schèmes déterminent en retour la reconfiguration des institutions éducatives, professionnelles, gouvernementales. Il s’ensuit que changer d’organisation et de conception du travail, c’est changer de société. Comment s’opère la bascule ? La singularité des alternatives écologiques étudiées réside dans la simplicité revendiquée du mode de conversion.
Parce que ces chantiers participatifs, autogérés, collectifs sont de petite taille et s’adressent à des proches (familialement, localement, politiquement), parce qu’ils échappent au « tropisme procédural » des institutions (Blondiaux et Fourniau, 2011), parce qu’ils reposent sur une contribution manuelle modulable selon la force physique, l’âge, les compétences et la disponibilité, parce qu’ils se fondent sur le partage et la rotation des tâches, parce qu’il est possible, le temps du chantier, d’œuvrer à un travail dont les moyens et les fins dépassent la seule promotion de l’écoconstruction, ce type d’initiative, loin de stagner, augmente d’année en année, inversant la tendance observée dans les dispositifs de démocratie participative qui peinent à mobiliser dans la durée citoyens et habitants (Charles, 2012b).
Les alternatives écologiques et libertaires n’ont cependant rien d’homogène. Les trois types d’organisation de chantier étudiés, en dépit de principes communs, déclinent différentes conceptions du travail et différents niveaux de participation. L’échange bénévole de sa force de travail contre gîte, couvert et formation, sous la houlette d’un professionnel rémunéré, constitue la base des chantiers participatifs. À cette économie mixte de la participation est opposée celle d’une rétribution nécessairement salariée du travail dans le cadre légal d’une SCOP où la participation ouvrière est pleine et entière : les salariés ne partagent pas seulement les moyens de production et les bénéfices, ils s’emploient à ce que le processus de décision, de gestion et de répartition des tâches soit le plus horizontal, égalitariste et rotatif possible. La construction de cabanes à Notre-Dame-des-Landes s’écarte de ces deux modèles en rejetant frontalement et publiquement l’échange marchand au profit d’une libre association et de l’auto-organisation de la société civile.
Ces expériences qui explorent la voie des alternatives non autarciques, pour être distinctes, sont-elles en lutte les unes avec les autres ? L’hétérogénéité, que certains qualifient de « biodiversité » et qui peut traverser chaque collectif de travail, n’est significativement pas érigée en obstacle. Le conflit, l’absence de modèle de référence, la dimension expérimentale, la libre circulation d’un projet à l’autre sont revendiqués comme une marque de fabrique libertaire : la myriade des propositions politiques, tantôt combinées, tantôt juxtaposées, forme un réseau qui ne vise pas à faire système, mais à s’étendre de cercle en cercle, redessinant les contours du politique (Ogien et Laugier, 2014) : il ne s’agit pas de « dire », mais de « faire » sous la forme d’une action directe — en ce qu’elle a lieu ici et maintenant —, non-violente — en ce qu’elle ne prend pas la voie des armes —, qui consiste à changer radicalement de mode de vie. Cette politisation du moindre geste ne peut que conduire à redéfinir la notion de travail qui prend le statut d’expérience tout à la fois politique, éthique, ludique et créative, susceptible de reconfigurer le monde (Dewey, 1976).
Geneviève Pruvost, « Chantiers participatifs, autogérés, collectifs : la politisation du moindre geste », Sociologie du travail, Vol. 57 - n° 1 | 2015, 81-103.
Nous remercions Geneviève Pruvost et la rédaction de la revue Sociologie du travail de nous avoir donner l’autorisation de republier ce texte.
Notes
(10) Pour une chronologie détaillée voir http://zad.nadir.org.
(11) Tel est le terme en vigueur dans les milieux libertaires, distincts des communautés.
(12) Il s’agit d’une enquête qui a porté sur 9 séjours et a mobilisé en tout une quinzaine de masterants, doctorants et chercheurs, sur trois ans, avec pour les uns un séjour unique dans le cadre de l’enquête, pour les autres des séjours plus réguliers. Afin de respecter les règles d’usage de cette enquête collective, je n’utiliserai que les notes de terrain que j’ai prises lors de mes propres séjours, en conservant une anonymisation maximale dans la description.
(13) À chacun de mes séjours à la ZAD, j’ai compté entre un tiers et un quart de femmes.
Bibliographie
Arendt, H. (1993), Condition de l’homme moderne, Calmann-Lévy.
Abbott, A. (1988), The System of Professions. An Essay on the Division of Expert Labor, University of Chicago Press.
Beck, U. (2001) La société du risque. Sur la voie d’une autre modernité, Aubier.
Blondiaux, L., Fourniau, J.-M. (2011), « Un bilan des recherches sur la participation du public en démocratie : beaucoup de bruit pour rien ? », in Participations 1, 8-35.
Boltanski, L., Chiapello, E. (1999), Le nouvel esprit du capitalisme, Gallimard.
Camille (2014), Le petit livre noir des grands projets inutiles, Le passager clandestin.
Collectif Mauvaise Troupe (2014, Constellations. Trajectoires révolutionnaires du jeune 21e siècle, L’Éclat.
Collectif Straw d’la balle (2013), La maison de paille de Lausanne, La Lenteur.
Charles, J. (2012a), « Les charges de la participation », in SociologieS.
Charles, J. (2012b), « Comment la cartographie méconnaît les habitants. Le formatage de la participation dans une commune belge », in Participations 3-4, 155-178.
Dejours, C. (1997), « Virilité et stratégies collectives de défense dans les formes d’organisation du travail », in Les Cahiers du Mage 3-4, 147-157.
Dewey, J. (1976), « Interpretation of Savage Mind », in Dewey, J., Middle Works 2, Siu Press, pp. 39-66.
Dubar, C. (2000), La crise des identités. L’interprétation d’une mutation, PUF.
Hopkins, R. (2010), Manuel de transition. De la dépendance au pétrole à la résilience locale, Écosociété / Silence.
Hughes, E. (1996), Le regard sociologique. Essais choisis, Éditions de l’EHESS.
Illich, I. (2005), La convivialité, in Illich, I., Œuvres complètes, tome 1. Fayard, pp. 451-582.
Gallioz, S. (2007), « La féminisation des entreprises du bâtiment : le jeu paradoxal des stéréotypes de sexe », in Sociologies pratiques 14, 31-44.
Gorz, A. (1988), Métamorphoses du travail, quête du sens. Critique de la raison économique. Galilée.
Jounin, N. (2010), Chantier interdit au public. Enquête parmi les travailleurs du bâtiment, La Découverte.
Lacroix, B. (1981), L’utopie communautaire. Histoire sociale d’une révolte, PUF.
Lulek, M. (2009), Scions… travaillait autrement ? Ambiance Bois, l’aventure d’un collectif autogéré, Éditions Repas.
Messu, M. (2007), L’Esprit Castor. Sociologie d’un groupe d’auto-constructeurs. L’exemple de la cité de Paimpol, PUR.
Naess, A. (2009), Vers l’écologie profonde, Wildproject.
Nez, H. (2011), « Nature et légitimités des savoirs citoyens dans l’urbanisme participatif », in Sociologie 4 (2), 387-404.
Ogien, A., Laugier, S. (2014). Le principe démocratie. Enquête sur les nouvelles formes du politique. La Découverte, Paris.
Ollitrault, S. (2008), Militer pour la planète. Sociologie des écologistes, PUR.
Pruvost, G. (2013), « L’alternative écologique. Vivre et travailler autrement », in Terrain 60, 36-55.
Pruvost, G., (2015), « Quand l’arène des proches s’invite à la table du système des professions : coopérations et coalitions hybrides en écoconstruction », in: Demazière, D., Jouvenet, M. (Eds), Andrew Abbott, sociologue de Chicago. Héritages, dépassements, ruptures, Éditions de l’EHESS.
Renault, E. (2012), « Dewey et la centralité du travail », in Travailler 38, 125-148.
Rosental, C. (2009), « Anthropologie de la démonstration », in Revue d’anthroplogie des connaissances 3 (2), 233-252.
Sennett, R. (2010), Ce que sait la main. La culture de l’artisanat, Albin Michel.
Testart, A. (2007), Critique du don. Études sur la circulation non marchande, Syllepse.