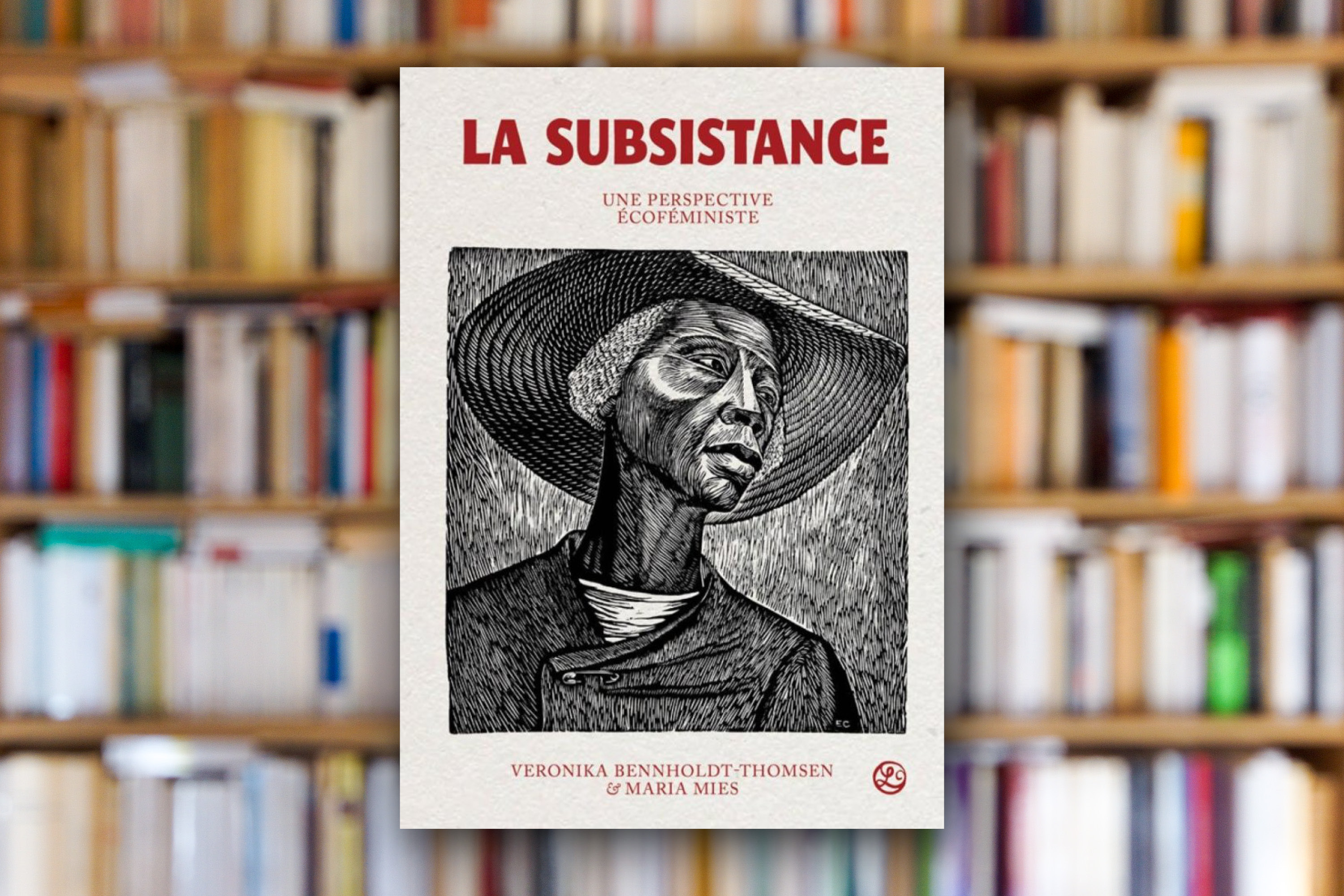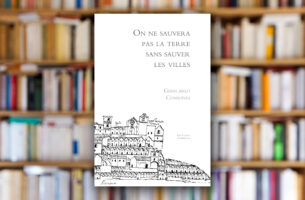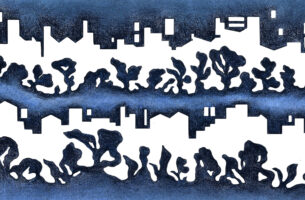Introduction
Voici un ouvrage exceptionnel, particulièrement bien traduit par Annie Gouilleux, qui ne peut laisser indifférent quiconque recherche la plus large autonomie pour chacune et chacun dans le plus grand respect envers le vivant. Maria Mies (1931–2023) est une sociologue, ayant cosigné avec Vandana Shiva Écoféminisme, traduit en français chez L’Harmattan en 1999. Veronika Bennholdt (née en 1944) est ethnologue. Toutes les deux sont, avec Claudia von Werlhof (née en 1943) associées à l’école de Bielefeld, qui combine écologie, féminisme et décolonisation du tiers-monde.
Ce livre est passionnant et original. Passionnant car les autrices désoccidentalisent et écoféminisent leurs propos tout en l’ancrant dans le débat politique contemporain. Original dans sa forme puisque des souvenirs autobiographiques se mêlent à l’analyse très bien documentée et en facilitent la lecture. L’édition allemande est parue en 1997, sa traduction anglaise date de 1999, c’est une version actualisée et complétée qui est présentée ici, un quart de siècle plus tard. Dans un avant-propos de mai 2022, Veronika Bennholdt-Thomsen concède que le livre soit devenu « un document historique », que bien des choses ont changé depuis sa parution. Ainsi, par exemple, le mot « tiers-monde » a disparu, tout comme le mot d’ordre « lutter contre l’impérialisme ». La globalisation du capitalisme financiarisé a imposé le productivisme dans toutes les activités humaines, ainsi que son corollaire, la « société de consommation ». Ce qui demeure présent est « la dévalorisation du féminin » et les « deux féminismes » qu’avaient alors repéré les autrices. Elles distinguaient le « féminisme autonome », auquel elles adhérent encore, qui milite pour une « transformation profonde des rapports économiques et sociaux entre les sexes », et le « féminisme intégré », qui réclame l’accès aux mêmes postes et aux mêmes salaires que les hommes. Ce féminisme axé sur l’égalité des droits entre les femmes et les hommes est bien insuffisant puisqu’il ne vise pas les profondes racines patriarcales à l’origine de la subordination des femmes, entendue comme « naturelle »...
En privilégiant le « travail de subsistance », elles sont persuadées de renouveler le féminisme et la pensée écologique. Mais elles ne sous-estiment pas la réticence de nombreuses féministes, majoritairement blanches et appartenant à la middle-class, à admettre que les tâches ménagères puissent être un point de départ pour une économie anticapitaliste. Afin de mieux comprendre cette position, elles constatent le développement progressif dans plusieurs sphères de la société – et pas seulement pour les femmes au foyer – de ce qu’elles appellent l’housewifization, ces activités dévalorisées, qui pourtant, s’avèrent indispensables à l’entretien même de chacune et chacun. Dans son « Avant-propos », Veronika Bennholdt-Thomsen affirme que « la perspective de la subsistance consiste à regarder le monde par en bas, depuis la vie quotidienne, et non par en haut, depuis les instances de pouvoir qui manipulent l’opinion dans le seul but de se perpétuer. » Elle ajoute : « L’organisation de la subsistance suppose la coopération communautaire (les communs) dans les conditions à chaque fois données qui permettent d’assurer la vie, et elle oppose une résistance au totalitarisme de l’argent et de la marchandise, c’est-à-dire à la guerre que mène l’économie de marché globalisée contre le monde entier, mais aussi à la guerre militaire. »
« La perspective de la subsistance consiste à regarder le monde par en bas, depuis la vie quotidienne, et non par en haut, depuis les instances de pouvoir qui manipulent l’opinion dans le seul but de se perpétuer. »
Veronika Bennholdt-Thomsen
Neuf chapitres structurent cet important essai. Dans le premier, « Histoire de la perspective de la subsistance », les autrices montrent comment la marchandisation généralisée a marginalisé le travail de subsistance tout en uniformisant la culture et en rendant tout individu dépendant du marché, ce qu’Ivan Illich avait subtilement analysé dans Le Travail fantôme dès 1981. Elles précisent alors que ce qu’elles entendent par « subsistance » : terme qui existe dans la plupart des langues ; qui exprime le mieux l’alternative sociale riche d’une « économie morale » et « d’un nouveau mode de vie » émancipateur ; qui concerne aussi bien les pays du Sud que ceux du Nord ; qui assure une continuité géohistorique entre des modes de production apparemment inconciliables ; qui la relie à la nature, non pas à travers une dépendance liée à la nécessité et à la rareté, mais à ce qui peut être une chance ; qui enveloppe ce qu’on nomme « économie locale, autosuffisance, création de communautés, styles de vie alternatifs, économie du soin, économie vivante, etc. ».
Le chapitre suivant examine les conditions du processus d’housewifization (« ou domestication du travail des femmes ») qui perdure même quand les femmes deviennent salariées, car à la journée de travail vient s’additionner le travail ménager non rémunéré. Ce processus a bénéficié de la colonisation – un des moments de la globalisation de l’économie – pour envahir la vie quotidienne de femmes du tiers-monde. Les autrices se concentrent sur les dernières décennies et dénoncent les agissements des institutions internationales (Banque mondiale, FMI, Gatt, OMC, AMI, zones franches, zones de libre-échange et de sécurité alimentaire...), qui conduisent à cette housewifization, contrairement à leurs discours. La politique économique néolibérale réduit la part des dépenses sociales, parfois drastiquement, et oblige les femmes à la combler. La flexibilité du travail vantée par les pouvoirs publics, avec bien souvent la complicité des syndicats, n’a servi que les entreprises qui la mettaient en place et qui n’hésitaient pas à jeter au chômage de nombreux travailleurs. Elles expliquent en quoi le capitalisme justifie la course folle au « toujours plus » afin de contrecarrer l’implacable « loi de la rareté », ainsi la croissance pour la croissance devient un impératif. Pour elles, le développement est pervers et le « développement durable » vicié. Aussi proposent-elles un « nouveau modèle » de société reposant sur la subsistance. Puis, listent des propositions applicables rapidement : pour le travail (« la production de subsistance passerait avant la production de marchandise ») ; la technologie (la réparation sera privilégiée ainsi que les savoir-faire des gens) ; l’économie (en respect de la nature, décentralisée...) ; le commerce (marchés locaux) et la satisfaction des besoins (nouvelles relations entre les villes et les campagnes, réappropriation des communs...).
« Pour les autrices, le développement est pervers et le développement durable vicié. »
Thierry Paquot
Le chapitre consacré à l’agriculture est particulièrement vivant avec des entretiens avec des fermières allemandes et les enquêtes que Maria et Veronika ont mené auprès de paysannes sur différents continents. Ce chapitre est quasiment un essai à lui tout seul, qui mériterait une longue présentation, il mise sur un « retour à la terre », selon les perspectives biorégionales, la protection de la biodiversité, l’agroécologie et la multiplication des écovillages. Le marché n’est pas condamné par les autrices, à condition, toutefois, qu’il accorde à la subsistance une place de choix, c’est-à-dire qu’il cesse de faire croire à l’existence de « la loi de l’offre et de la demande », alors même que les monopoles et la publicité la déterminent... La seconde main, la ressourcerie, les coopératives, les marchés paysans, le faire-soi-même (ou production vernaculaire), etc., sont des modalités commerciales à promouvoir... La ville n’est pas diabolisée, une agriculture de subsistance peut s’y déployer à partir de jardins solidaires. De même les bidonvilles possèdent des ressources sous-utilisées, comme le savoir-faire de nombreux bidonvillois qui viennent des campagnes. Mais les obstacles sont nombreux, à commencer par la morphologie des villes imposée par l’automobile, le fonctionnalisme et la spéculation...
L’examen des communs, dans le chapitre six, conduit au principe suivant : « (...) les biens communs ne peuvent exister sans communauté, mais une communauté ne peut pas non plus exister sans économie, au sens d’oikonomia, c’est-à-dire de reproduction des êtres humains au sein du foyer social et naturel. » Ce qui suppose une « défense et réappropriation de l’espace public », une biorégionalisation (le terme n’est pas utilisé, les autrices parlent d’une « écologie de la région »), une décentralisation, une « justice sociale », une gouvernance horizontale et une pluralité de communautés.
Le salariat fait l’objet du chapitre suivant, il est le meilleur garant de la double journée de travail des femmes et du renforcement de la subordination des femmes au foyer. Sortir du salariat et du système hiérarchique ne peut que renforcer l’autonomie de chacun. Or, le salariat est une obsession masculine, constatent les autrices, qui entrave sérieusement la possibilité même d’un autre rapport au travail. Elles ne croient pas non plus à une robotisation des tâches qui « libéreraient » les humains des travaux pénibles, répétitifs et sans grand intérêt personnel. Ce qu’elles précisent dans le chapitre suivant, en critiquant la « révolution informatique » et André Gorz, en dénonçant les féministes qui souhaitent obtenir les mêmes avantages que leurs collègues hommes et acquérir de plus en plus de pouvoir dans les institutions. Elles rappellent que « les principaux problèmes des femmes à travers le monde ne sont pas les questions de différence et/ou d’identité, mais l’exploitation, l’oppression, la violence et la colonisation. » Elles rejettent « le dualisme qui sépare la matière et l’esprit et dévalorise la matière pour idéaliser l’esprit ». Elles fondent le pouvoir d’autonomie « sur la confiance de soi, l’aide mutuelle, l’auto-organisation, l’auto-approvisionnement, les réseaux locaux et internationaux et sur le remplacement des relations de profit par les relations de subsistance. » Elles souhaitent offrir à leurs filles et à leurs fils autre chose que ce que le « capitalisme mondial machiste et militariste » affiche...
« [Nous fondons le pouvoir d’autonomie] sur la confiance de soi, l’aide mutuelle, l’auto-organisation, l’auto-approvisionnement, les réseaux locaux et internationaux et sur le remplacement des relations de profit par les relations de subsistance. »
Veronika Bennholdt-Thomsen et Maria Mies
Le dernier chapitre recense les difficultés qui parasitent le processus d’une politique de la subsistance. Et ils sont nombreux ! Aussi, rien n’est gagné... Les autrices sont lucides sur la séduction de la croissance pour la croissance et sur les aspects rébarbatifs de la subsistance, néanmoins, elles ne peuvent imaginer d’autre issue. Aux lectrices et lecteurs de discuter leurs thèses (certaines sont plus convaincantes que d’autres, certaines méritent d’être actualisées) et de zader leur existence...
Veronika Bennholdt-Thomsen et Maria Mies (1997), La subsistance. Une perspective écoféministe, traduit de l’anglais par Annie Gouilleux, avec la collaboration de Chloé Pierre, Paris, Éditions La Lenteur, 2022, 430 pages, 24 euros.