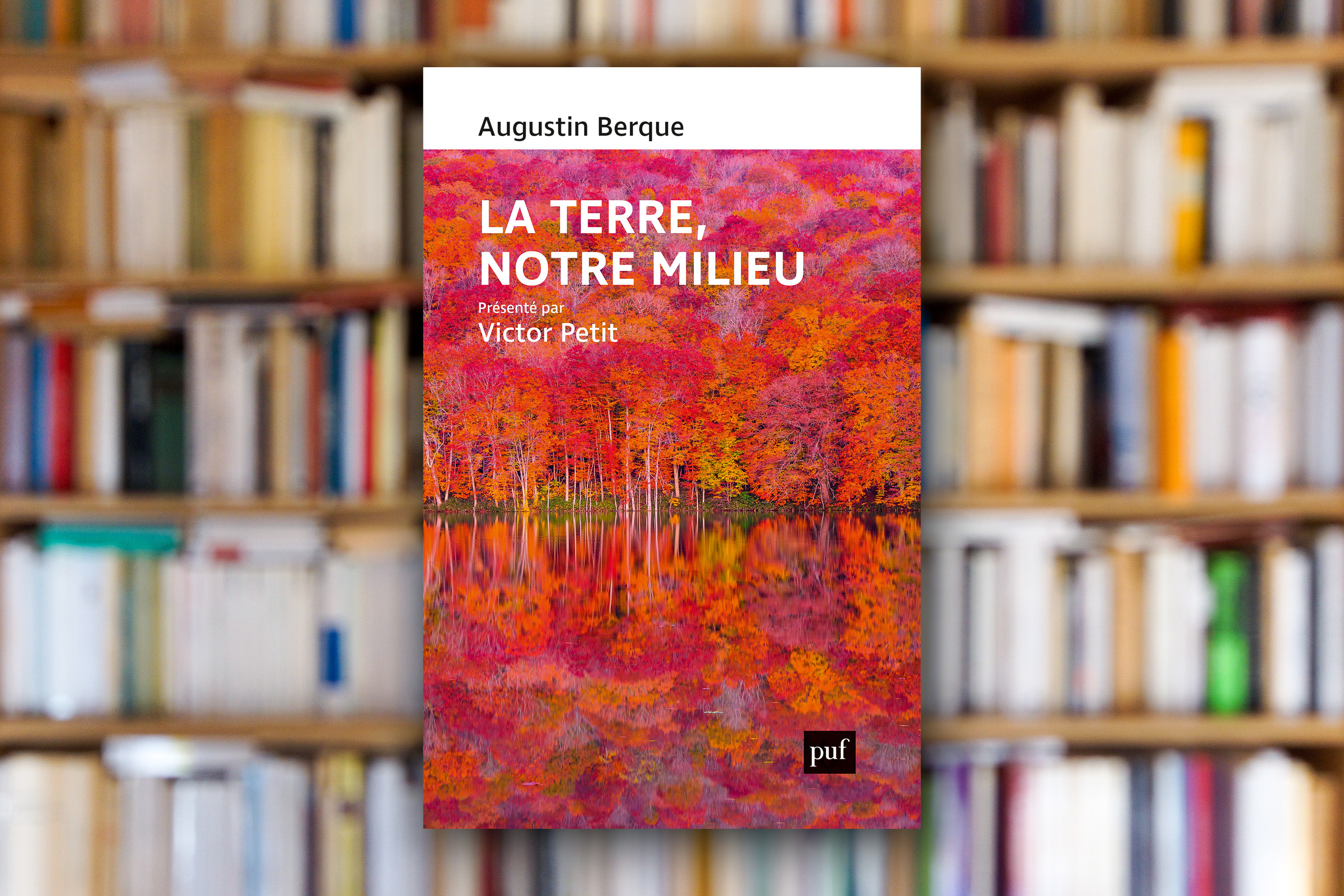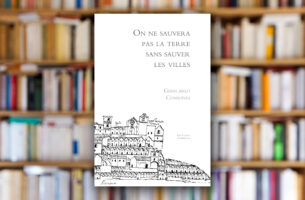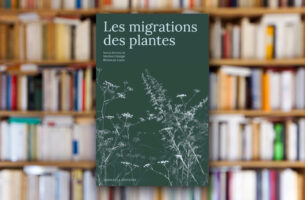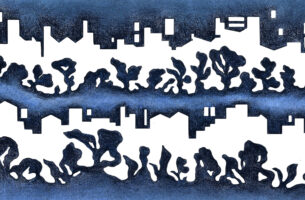Introduction
L’œuvre d’Augustin Berque est unique pour la simple raison qu’il est le seul à combiner une connaissance exceptionnelle du Japon (et du japonais) à la philosophie, aussi bien occidentale, née en Grèce, qu’orientale, avec en particulier Wetsuji, dont il a traduit le maître-livre, Fûdo. Le milieu humain (CNRS-éditions, 2011). « Qu’est-ce qu’habiter la terre à l’anthropocène ? » est une conférence donnée à l’École Normale Supérieure en février 2016, et peut être considérée comme une introduction à ses nombreuses publications, qui dialoguent entre elles, tant l’auteur les relient les unes aux autres. Ainsi ce court texte théorique, particulièrement dense et non dénué d’humour, reprend les principaux concepts forgés par Augustin Berque, en les développant et les enrichissant.
Le lecteur qui lit pour la première fois cet auteur découvrira son vocabulaire (écoumène, trajection, milieu, mésologie, habiter, médiance, etc.), le lecteur fidèle, aura la confirmation que tout nouvel écrit prend appui sur les précédents pour explorer un nouveau territoire. Il faut avouer que depuis La Rizière et la Banquise. Colonisation et changement culturel à Hokkaidô (1980) à Longitudes. De lieu en lieu, Mémoires sans l’être tout en l’étant (2024), soit près d’un demi-siècle, ses enquêtes géographiques au Japon tout comme ses lectures renouvellent sa réflexion de plus en plus focalisée sur ce que la notion de « milieu » nous fait et nous dit.
Cette conférence, éclairée par les judicieux commentaires de Victor Petit, revient sur certains termes « berquiens », comme « mésologie », néologisme du médecin et biologiste Charles Robin, (1848), qu’il distingue d’« environnement » ; « écoumène » qui est « le lien onto-géographique entre la Terre et l’humanité » ; « nature » qui relève de la culture, donc des hommes... Les deux auteurs qui accompagnent Augustin Berque dans cette conférence sont le philosophe Watsuji Tetsuro (1889-1960) et le biologiste et naturaliste Jakob von Uexküll (1864-1944). Le premier a été l’étudiant de Heidegger et le second a été étudié par Heidegger, c’est donc tout naturellement que nous retrouvons le philosophe allemand dans ses propos, d’autant que sa célèbre conférence de 1951, « Bâtir Habiter Penser », inspire Henri Lefebvre lorsqu’il pense la « production de l’espace » que mentionne également le conférencier...
La conférence s’attarde sur le verbe « habiter », qui en japonais se dit sumu, qui signifie aussi bien « s’achever » que « se clarifier », d’où l’idée de « pureté » qu’on retrouve dans certains usages, comme se déchausser avant d’entrer dans une maison, prendre un bain chaud après le travail, etc. Le « foyer » est consubstantiel à la demeure, comme le dit Augustin Berque : « le feu est un puissant éco-techno-symbole de l’habiter humain, par les voies de la construction (la lignée d’oikos) comme par celles du maintien du corps en un lieu social (la lignée d’habere). » Qu’en est-il à l’heure de l’anthropocène ? Non seulement le productivisme saccage les lieux, mais « le sujet moderne », qui le cultive, prétend ne plus dépendre du milieu terrestre et s’avère prêt à déshabiter la Terre ! En exemple d’une telle situation, Augustin Berque prend Le Corbusier et son architecture qui « fait » paysage et Rem Koolhaas et son « espace foutoir », également sans relation aux lieux. Il ne s’agit pas de croire en un déterminisme du milieu, celui-ci n’est jamais donné une fois pour toute, il se reconfigure en même temps que les humains en exaltent les spécificités. « En ce sens, l’habiter humain n’est autre que la médiance de l’écoumène. Ce que nous habitons en tant que proprement humains, c’est ce moment structurel qu’est le couplage des deux ‘moitiés’ de notre être : notre corps animal et notre corps médial. Moment d’autant plus puissant que, par la technique et par le symbole, notre corps médial étend toujours davantage notre être existentiel (ek-sistentiel, au-delà des limites de notre corps animal). » Cette « petite » conférence se révèle une « grande » pensée, questionnant, entre les lignes, celles et ceux qui abandonnent la notion de « nature », par exemple.
Augustin Berque, La Terre, notre milieu, présenté par Victor Petit, « Les classiques de l’écologie », PUF, 2025, 98 pages, 9 euros.