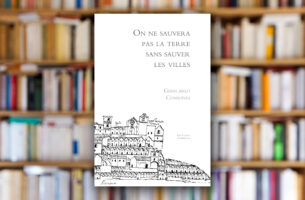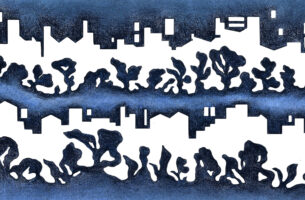Introduction
Mondialement célèbre, l’auteure du Printemps silencieux (1962), Rachel Carson (1907-1964), journaliste scientifique, a écrit de nombreux articles qui, regroupés, nous donnent de ses nouvelles. Les 16 textes de ce recueil s’échelonnent de 1920 à 1964, année de sa mort, suite à un cancer.
Fille d’un fermier, elle découvre la nature en explorant le domaine familial et ses à-côtés, étudiante en biologie marine, fonctionnaire de l’US Bureau of Fisheries, où elle rédige 52 épisodes d’une émission radiophonique de vulgarisation sur la vie aquatique, qui l’inciteront à écrire Under the Sea Wind, son premier succès de librairie, traduit en français, La Vie de l’océan (Amiot-Dumont, 1952), elle doit lutter contre le sexisme ambiant (un correspondant lui écrit « Cher Monsieur », n’acceptant pas qu’une femme soit une naturaliste...) et affronter les lobbies de l’industrie chimique, lorsqu’elle dénoncera les dégât causés par les insecticides et pesticides, dont le DDT.
Son incroyable sensibilité associée à une grande capacité à observer le vivant lui permettent d’évoquer les interrelations qui se manifestent entre les plantes, les animaux, leurs milieux, les humains. Ses lectures (Audubon, Thoreau, Emerson, Muir, etc.), ses recherches en laboratoire et surtout ses études in situ, lui révèlent l’interdépendance des divers « éléments » constitutifs d’une même écosystème : tout est lié sur Terre, pour le pire comme pour le meilleur.
Déjà à treize ans, en 1920, dans « Le combat pour la vie progresse » elle note : « Que le déclin de la faune soit lié, de manière inéluctable, aux destinées humaines est désormais un fait acquis chez nous, la préservation est donc primordiale. La faune, il convient de le rappeler, disparaît parce que son habitat a été détruit. Or l’habitat des animaux sauvages est aussi le nôtre. » Ce que la zoonose récente confirme... En 1949, dans « Les mondes perdus : l’enjeu des îles », elle s’inquiète de la disparition de nombreuses espèces végétales et animales : « Mais l’homme, écrit-elle, malheureusement, est responsable des dossiers les plus sombres en matière de destruction sur les îles océaniques. Il n’a presque jamais mis le pied sur une île sans y apporter des changements désastreux. Il a détruit les milieux en coupant, éclaircissant et brûlant ; c’est à cause de lui, même si c’est involontairement, que le dangereux rat y est arrivé ; et presque invariablement il a lâché dans la nature une arche de Noé constituée de chèvres, porcs, bétail, chiens, chats et autres animaux et plantes non indigènes. Sur les espèces insulaires, l’une après l’autre, le crépuscule sombre de l’extinction est tombé. » Dans « Le bord de mer », publié en 1953, elle alerte les lecteurs sur les effets du réchauffement climatique (déjà !) sur la faune et la flore, mais aussi sur le sable, les larves, la qualité de l’eau, et là encore constate que « personne ne vit pour soi-même ». Elle se promène, en 1956, avec son neveu dans la nature et s’extasie que celui-ci , qui a quatre ans, enregistre les noms de ce qu’il découvre et se satisfait de cette « école dehors »...
En 1963, elle complète son accusation de l’industrie chimique, responsable de nombreuses maladies environnementales et de dénaturation des milieux, et prononce un important discours « La pollution de notre environnement », qui est d’autant plus émouvant, qu’elle se sait condamnée... Elle connait la puissance du lobby et de ses alliées parmi les scientifiques qui vivent de ses subventions et mentent éloquemment (un directeur d’une institution agricole affirme que la pollution se dilue !) et sait à quel point tout combat nécessite énergie et vigilance pour que ses acquis se pérennisent... Elle espère, explique-t-elle à son public, que chacun acceptera, enfin, que « nous sommes liés à notre environnement ». Le dernier texte, datée de septembre 1963, est une lettre à son inestimable amie Dorothy Freeman, rencontrée en 1953, à qui elle confie : « Pour les Monarques, ce cycle se mesure à l’aune du mois. Pour nous-mêmes, le métré est d’une autre nature, et nous n’en connaissons pas la durée. Mais l’idée est la même : lorsque ce cycle intangible a suivi son cours, il est naturel, et ce n’est pas une chose triste, qu’une vie arrive à sa fin. »...
Rachel Carson, Le Sens de la merveille, traduit de l’américain par Bertrand Fillaudeau, collection « Biophilia », Paris, José Corti, 2021, 178 pages, 19 euros.