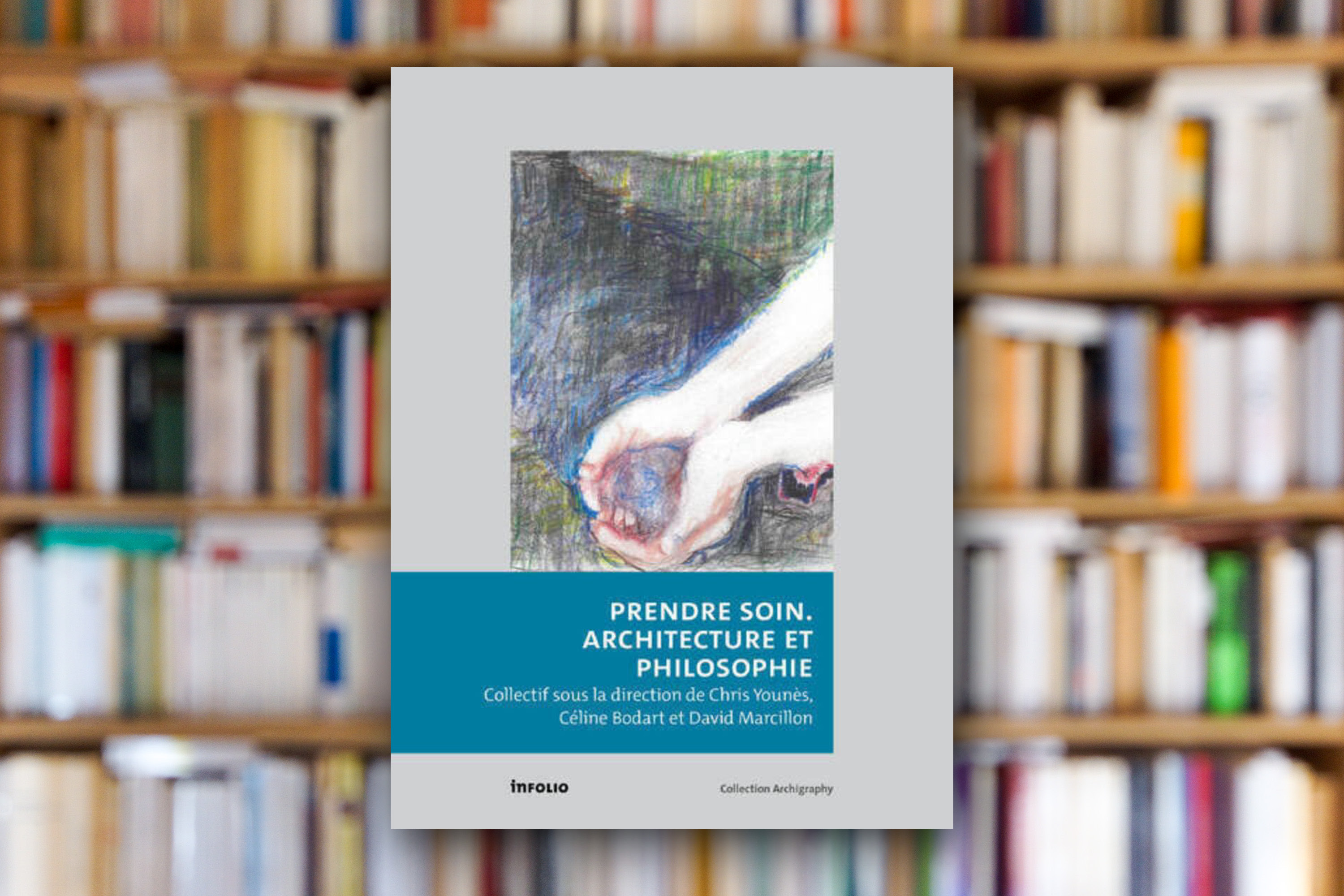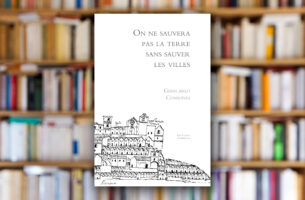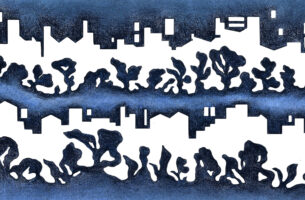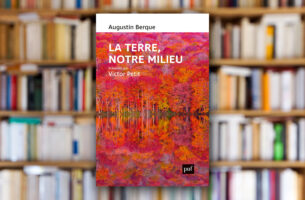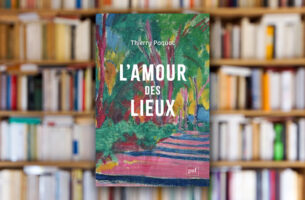Introduction
Prendre soin. Architecture et philosophie présente un puissant collectif partageant un même constat : « la mondialisation malheureuse » nous enferme « dans une crise qui a plusieurs facettes : sanitaire, économique, sociale, écologique et même civilisationnelle », crise de l’urbanité aussi comme le pose d’entrée Fabienne Brugère. Alors que « la “fabrique de la ville” obéit encore massivement aux méthodes et à l’idéologie de la seconde partie du vingtième siècle » (Frédéric Bonnet), il est indispensable d’« adapter le territoire à des combinaisons de crises, climatique, biodiversitaire, environnementale, énergétique, économique, sociale » (Philippe Villien). Une évidence irrigue le livre : l’inéluctable prise en compte de l’impact des précarités et bouleversements civilisationnels de l’anthropocène exige de nouvelles pratiques architecturales et urbanistiques participant d’une écosophie mutualiste de l’espace urbain.
Un fil rouge relie les différents textes : le « vivre avec le trouble », le « faire-avec » et le care dont les auteurs rappellent en ouverture la définition de Joan Tronto :« une activité générique qui comprend tout ce que nous faisons pour maintenir, perpétuer et réparer notre “monde”, de sorte que nous puissions y vivre aussi bien que possible. » Prenons au passage la précision de Thierry Paquot : « Le mot care ne vient pas du latin cura, mais du vieux haut allemand Kara, “souci, chagrin, peine”. Il décrit un état mental fait d’anxiété, que l’on retrouve dans le “souci” heideggérien, Sorge. Il désigne aussi l’anticipation d’un danger, afin de s’en prémunir. »
Audrey Courbebaisse et Chloé Salembier explorent un texte phare de Tronto – « Vers une architecture du ménagement » publié dans Topophile [1] – définissant le care comme processus itératif comprenant cinq phases : faire attention, prendre soin de, donner, recevoir et rendre. Appliqué à l’architecture : caring about, se soucier du contexte et des besoins en termes d’habitat ; taking care of, prendre en charge le processus de la construction à la livraison ; care giving, prêter attention à la manière dont un espace est censé offrir un refuge ; care recieving, assurer le suivi, l’entretien, les réparations ; caring with, fiabilité et continuité dans le temps avec boucle rétroactive (réciprocité). Comme le soulignent les autrices : « Tantôt l’espace peut être l’objet de care, d’attention et de soin, tantôt l’espace est générateur, propice au soin, à l’épanouissement des êtres. »
Chris Younès, Céline Bodart et David Marcillon précisent dans leur introduction qu’« il ne suffit pas de s’outiller conceptuellement et méthodologiquement, mais d’éveiller les sensibilités, les responsabilités, et d’améliorer les pratiques en interrogeant ce qui nous met en contact et nous touche. » Les multiples réalisations présentées tout au long de cet ouvrage collectif corroborent l’appréciation globale que formule Frédéric Bonnet : « Les exemples en ce sens dépassent désormais le stade de l’expérimentation, souvent portée par les politiques publiques volontaires des collectivités locales et de plus en plus encouragé par une demande citoyenne qui, souvent, dépasse l’offre politique. » On peut donc parler d’une montée en puissance du care-architectural tout en soulignant qu’il procède à une reformulation simultanée tant de la commande, que de la pratique, de l’enseignement et de la recherche ce dont le livre permet de prendre la mesure.
Nouant chaque fois le penser et l’agir, les quatre escales – accueillance, maintenance, portance et accordance – structurant Prendre soin proposent de multiples leviers pour élaborer les « conditions d’instauration des activités du prendre soin en architecture. » Non sans nous inviter comme le fait Philippe Madec à nous prémunir des effets de mode : « De nos jours tout est “résilience” et rien ne nous protège de l’emploi du Care comme ce fut le cas de la “Déconstruction” ou du pli ou du chaos. » Éric de Thoisy n’en pense pas moins lorsqu’il signale que « les concepts de soin et plus encore de care ont été rapidement récupérés, washés, détournés en outils au service d’une continuation de pratiques que, pourtant et précisément, ils devraient contribuer à dénoncer, pour les faire cesser. » D’où l’impératif de conserver le tranchant, la subversivité du care.
Escale
L’explosion des vulnérabilités oblige à accepter la fragilité, la mortalité, l’obsolescence de l’homme, et donc invite à « faire-avec » le trouble (Donna Haraway), d’où le renversement copernicien que propose de Thoisy : « Transformer le malaise en singularité, la faiblesse en exceptionnalité, la vulnérabilité en un irréductible, et un commun, c’est, immédiatement, faire de la dépendance à l’autre le fondement de tout le reste. » L’acceptation d’une telle vulnérabilité appelle à la création d’une espace urbain hospitalier « qui prend en charge, qui accompagne la vulnérabilité de l’homme plutôt que de la compenser. » Suivant le même filon, les quatre lectures architecturales du care proposées par Marie Tesson articulent une architecture libre des fausses alternatives entre art et profit ou entre style et pouvoir : « 1) une architecture spontanée, vernaculaire, 2) une architecture qui accueille la communauté, 3) une architecture qui diffuse la dignité, ou 4) une architecture basée sur l’écoute de chacun.e. »
La première escale consacrée à l’accueillance se termine par une contribution de Marie Troissat émancipant l’hospitalité des prismes du temporaire et de l’urgence. L’hôte devenant citoyen.ne, voisin.e, collègue, ami.e nécessite de toute évidence des espaces tout autre que des espaces d’accueil ou de soin. Dans cette perspective, elle examine des architectures non ordinaires, tel le Parc Maximilien ou le Petit-Château à Bruxelles, espaces ayant « en commun de déroger à l’attendu des lieux d’hospitalité, soit par leur forme, soit par les services qui n’y sont pas proposés, soit par l’usage qui en est fait, soit par la définition de l’hospitalité qu’ils offrent ou donnent. » Qu’elles soient autogérées, associatives ou institutionnelles, ces contre-architectures de l’hospitalité mettent en évidence la nécessité de « concevoir des espaces de grande capacité, ouverts, indéterminés et donc appropriables, comme cela signifie aussi défendre les architectures existantes de l’hospitalité, les ménager plutôt que les aménager. »
Maintenance
En ouverture de « Maintenance », le collectif SAGA témoigne de l’importance de construire du commun ensemble avec les usagers, « l’architecture est alors prétexte, c’est un outil pour ancrer cette initiative sur le terrain, lui donner une voix »et contribuer à la réalisation du projet. Justine Gloesener propose un regard dans le rétroviseur avec la présentation du centre médico-familial de la Cité de Droixhe à Liège [2]. Dans les années 2000, une importante partie des logements est démolie dans un plan de dédensification et la plupart des dispositifs spatiaux attentifs au care disparaissent. Regard vers le futur avec Philippe Villien qui analyse la trajectoire des sites hospitaliers. Forcément en première ligne pour résister aux chocs (transitions, crises, basculements, effondrements) à venir, les hôpitaux sont possiblement autant de lieux ressources du care permettant de tester et réaliser la résilience de nos territoires. Didier Rebois examine quant à lui la nécessaire résilience territoriale des littoraux. Face à l’obsolescence d’une approche défensive qui permettait la colonisation du littoral, le care et le repair proposent un narratif alternatif permettant de concevoir de nouvelles logiques de reliances spatiales. Les projets mentionnés par l’auteur auquel vient s’ajouter le projet Pirmil – Les Isles à Nantes, en chantier en 2025, et analysé plus loin par Frédéric Bonnet, témoignent d’une autre évolution de ces espaces partagés par la nature et l’humain.
Philippe Madec revient sur son parcours personnel pour rendre hommage à ses multiples compagnons de route et rappeler combien architecture et éthique sont indissociables : « l’éthique est engagée dans l’architecture, elle y est mise à l’œuvre ; elle y est mise à l’épreuve du temps et de l’espace. » Les propos se rapportant à l’excès de guerre de 1996 (Tchétchénie, Bosnie, Rwanda, Congo) méritent d’être rappelés à l’heure où Gaza est dévastée par une guerre de trop : « La guerre ravage, désole (de solus), délaisse, défait sans annonce de rétablissement. L’habitation allège les peines, console (cum solus), satisfait, apaise. L’habitation rend entier et la guerre rend seul. L’habitation rapproche le monde humain du monde matériel et les êtres entre eux ; la guerre les éloigne, invite le désert où se fait la solitude. » En écho aux textes de Madec et de Tronto (« Vers une architecture du ménagement »), la contribution de Thierry Paquot, publiée initialement dans Topophile [3], propose de remplacer le néologisme « urbanisme » par la notion de « ménagement urbain » dont il donne une interprétation ancrée dans la philosophie heideggérienne. Antidote à l’aménagement et aux environnements programmés, le « ménager » contribue à « écologiser nos manières de faire et de penser » de par une « attitude souple, ouverte, discrète, adaptable, efficace, soucieuse d’accroître l’autonomie des habitants, humains et non humains […] et le respect du déjà-là en privilégiant les interrelations entre les éléments constitutifs d’un même ensemble. »
Portance
Le ménagement urbain, le design social et le biorégionalisme comme autant d’électrochocs dont l’urbanisme a besoin comme le souligne en ouverture de la troisième escale, « Portance », Frédéric Bonnet qui présente plusieurs réalisations mettant en œuvre une alliance avec les milieux. Retenons ici la transformation (1993-2003) d’un promontoire aride en parc urbain adapté aux enjeux du réchauffement à Alicante. Conjuguant urbanisme, paysagisme, infrastructure, architecture et design, ce projet réalisé par l’agence Obras redéfinit les lignes de force l’architecture : « contenir, retenir, amender, rafraîchir, relier, certes, mais en magnifiant toutes les ressources de l’horizon, de la lumière et du sol. » Georges-Henry Laffont, tout autant pragmatique, explicite ce qu’exige une démarche de soin du territoire et de production partagée de connaissances : en deux mots, une intelligence de la situation, soit « participer, en situation, à proposer et rendre effective une autre conception de l’habitant, qui ne se trouve plus qualifié à la faveur d’un miroir déformant comme riverain ou usager, mais comme quelqu’un qui habite. » Une telle démarche permet l’émergence de « nouveaux imaginaires et de nouvelles valeurs individuelles et communautaires tournées vers le soin et l’attention au territoire » ainsi qu’une réappropriation du territoire et de ses nouveaux usages par ses habitants. De manière subtile et non sans malice, Olivier Perrier déplace l’expérience participative en milieu in/hospitalier. Tout d’abord dans une école d’architecture pour questionner la « culture » de la charrette, puis en amenant son groupe d’étudiants à la clinique psychiatrique de La Chesnaie (Loir-et-Cher) pour y découvrir les transformations réalisées dans les années 1970 par Chilpéric de Boiscuillé avec la participation de ses élèves en architectures et des patients [4]. Ce texte se lit comme un conte invitant l’institution, les écoles d’architecture donc, à prendre soin des futurs soignants des milieux.
La contribution de Perrier anticipe la question que soulève Stéphane Bonzani à un plan plus général : « Prendre soin des possibles, est-ce possible ? » Il se trouve qu’ici aussi les pratiques architecturales ne manquent pas. Anne Lacaton, Jean-Philippe Vassal, Sophie Delhay et Alejandro Aravena sont certainement les fers de lance d’une architecture ouverte qui, oui, « [dépasse] le cadre d’expérimentations marginales pour investir tout le champ de la conception architecturale et urbaine. » Les réflexions bergsoniennes évoquées sont pour le moins pertinentes : « les possibles ne précèdent pas le réel, au contraire, c’est le réel qui fait naître des possibles à mesure qu’il se réalise. » Ces possibles sont donc entre les mains des usagers, des habitants dont l’action ouvre des possibles que l’espace peut favoriser ou, pour le dire autrement avec les mots de l’auteur, il s’agit de ne pas rendre impossibles les transformations d’usages ou stratégies d’appropriation. Reprenant les réflexions de Hartmut Rosa – pour que les possibles se réalisent, « il faut que quelque chose résiste à la planification » –, Bonzani invite à « faire avec » et « faire durer » … pour que l’altération laisse advenir l’imprévisible.
Accordance
Dernière escale, la recherche de l’« Accordance » nous invite en compagnie de Claire Schorter à rompre avec la standardisation, combattre les modes de faire main stream : « pour concevoir des villes de manière plus attentionnée et solidaire, il faut paradoxalement faire preuve, à chaque instant, de conviction, de ténacité, voire de combativité. » Et pourtant les pratiques du projet urbain « sur mesure » de Claire Schorter semblent couler de source. La raison se trouve notamment dans un redimensionnement – des bâtiments plus minces, de petits ensembles habités d’une vingtaine de logements maximum – qui concerne non seulement le bâti mais également la gestion du projet : « Nous organisons, pour la même surface, cinq à six lots avec autant d’opérateurs et encore plus d’architectes. Cette division parcellaire permet de consulter de jeunes agences habituées à construire de plus petits programmes et d’autres promoteurs que les habituels “majors”. Nous observons ainsi un plus grand soin dans la conception des espaces. » Le succès des réalisations tant à Lille qu’à l’Île de Nantes résultent d’une vision pragmatique d’une fabrique écologique et bienveillante de la ville sur la base de projets sobres et résilients.
Bien des contributions de Prendre soin partagent les priorités de Claire Schorter : un art précis de la composition urbaine, la nécessité de développer des méthodes originales, la priorité faite aux usages, et le souci écologique des sols, de la biodiversité et de la nécessaire réparation des territoires. Pour exemple la contribution de Serge Joly qui s’inscrit dans ce même horizon. L’études des techniques traditionnelles de l’architecture parisienne sont convoquées pour la réalisation d’un bâti bas carbone. Le matériau détermine ainsi la conception d’une architecture vivante et pérenne ; la préfabrication en atelier permet d’envisager un processus économiquement faisable. L’accordance est ici déclinée entre systèmes constructifs passés et conditions de vie contemporaines.
Simon Teyssou complète le prendre soin souvent consacré à l’espace urbain pour s’intéresser au prendre soin des campagnes en présentant sa pratique dans le Massif Central compris comme biorégion. Face à l’obsolescence du modèle productiviste qui régit encore le monde agricole contemporain, il y urgence à développer le care dans les territoires ruraux, les petites centralités, les situations périurbaines et/ou de franges urbaines, au contact de l’agriculture et des espaces naturels en profitant des politiques publiques « Petites villes de demain » ou « Action cœur de ville ». Ce qui frappe dans le récit des projets menés que ce soit à Saint Illide, Saint Julien de Toursac, Chaliers ou encore à Mandailles est la grande simplicité des interventions pratiquées. Le plus souvent, une opération de soustraction suffit à elle-seule de transformer l’espace public : « soustraction de sols étanches, de mobiliers urbains désuets ou de haies mono-spécifiques, par exemple. Ces actions en creux suggèrent l’abandon des habitudes aménagistes qui saturent l’espace d’une profusion de dispositifs. » L’ensemble de la démarche ainsi que les réflexions l’accompagnant participent d’une écologie de la réconciliation telle que la formule Baptiste Morizot.
Le volume se termine par une réflexion de Daniel Payot portant sur la tension permanent entre autonomie et hétéronomie, tant dans l’art qu’en architecture ou encore dans nos existences. Plutôt que d’y voir une aporie, il faut y déceler la condition de possibilité de l’expérience. En référence au cours de 1958/1959 qu’Adorno consacre à l’esthétique et qui fait de l’art « une affaire sérieuse » [5], Payot suggère de faire de l’architecture une affaire tout autant sérieuse – et ce précisément par ce que le care nous y invite. Par-là, il synthétise de manière subtile l’ensemble de cet ouvrage collectif qui tient toutes ses promesses et contribue à redéfinir tant l’architecture que le ménagement urbain.
Chris Younès, Céline Bodart, David Marcillon (sous la direction), Prendre soin. Architecture et philosophie, « Archigraphy », Infolio, 2024, 368 pages, 30 euros.
Notes
[1] Joan Tronto, « Vers une architecture du ménagement », traduit en français par Joanne Massoubre et Martin Paquot, Topophile, le 18 janvier 2021 : https://topophile.net/savoir/vers-une-architecture-du-menagement
Publié initialement en anglais dans l’ouvrage de Angelika Fitz et Elke Krasky (Éds.), Critical Care, architecture and urbanism for a broken planet, MIT Press, 2019, p. 26-32 — cet ouvrage accompagnait une exposition qui s’est tenue d’avril à septembre 2019 au Centre d’Architecture de Vienne.
[2] Construit entre 1954 et 1979 par le Groupe d’architectes EGAU. En 1958, Droixhe accueille l’Exposition internationale d’urbanisme et d’habitation dans le cadre de l’Exposition universelle de Bruxelles.
[3] Thierry Paquot, « Ménager le ménagement », in Topophile, le 13 juin 2021 : https://topophile.net/savoir/menager-le-menagement/
[4] Il s’agit de salle de spectacle Le Boissier pour la clinique de la Chesnaie (1972) et de l’Orient Express Hôtel (Le train vert) – logement, restauration clinique de la Chesnaie (1978). Jean-François de Moncuit de Boiscuillé, qui signe ordinairement ses textes et projets sous le nom de Chilpéric de Boiscuillé. Formé à l’École polytechnique de Lausanne (1969), puis à l’Institut de l’environnement (1971), il a enseigné à l’École spéciale d’architecture (ESA) avant d’en devenir le directeur. Il a été par la suite directeur et fondateur de l’École Nationale Supérieure de la Nature et du Paysage (1993-2010) ainsi que de sarl Sativa Paysage (2010-2018).
[5] Le mot est de G. W. F. Hegel, La Phénoménologie de l’esprit, trad. Jean Hyppolite, Paris, Aubier Montaigne, 1939, tome 1, p. 57.