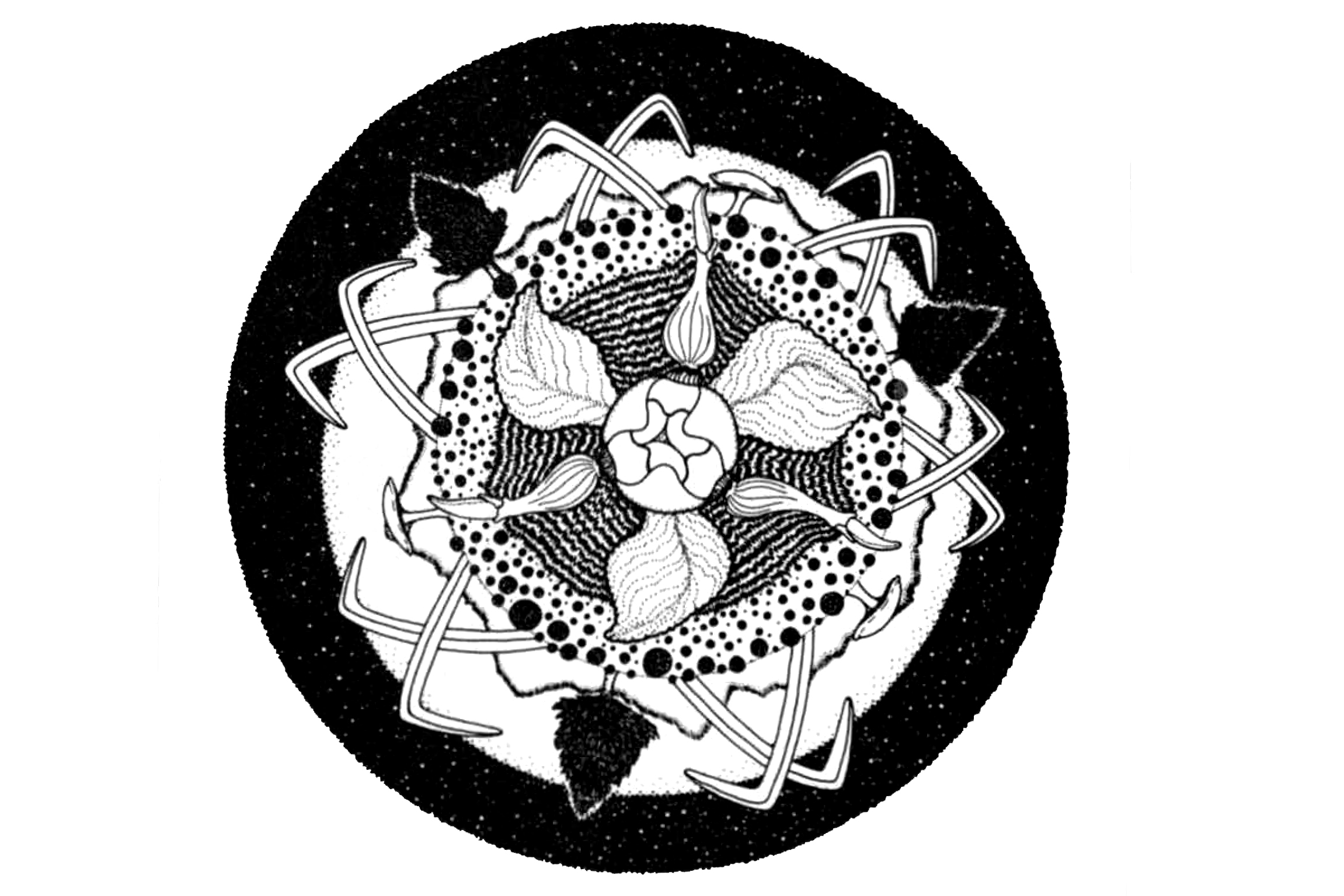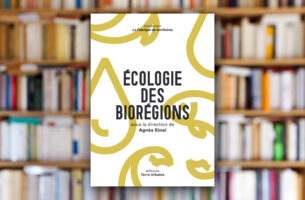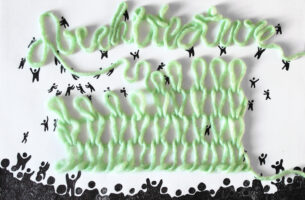Introduction
1978, le mouvement biorégionaliste se dote d’un de ses textes de référence. Enième version d’un texte commencé en 1976 par Peter Berg, fondateur de la Planet Drum Foundation, et remanié en 1977 par Raymond Dasmann, biologiste et conservationniste de renom – à qui on attribue l’expression biological diversity devenue par la suite biodiversité –, elle introduit deux notions et actions clés du biorégionalisme : vivre in situ et réhabiter. 40 ans plus tard, il est finalement traduit par Mathias Rollot. « Vivre in situ, écrivent-ils, signifie suivre les nécessités et les plaisirs de la vie telles qu’elles se présentent de façon singulière en un lieu particulier, et développer des moyens d’assurer une occupation durable de ce lieu. » « Réhabiter, poursuivent-ils, signifie apprendre à vivre in situ au sein d’une aire qui a précédemment été perturbée et endommagée par l’exploitation. […] Ce qui implique de demander à faire partie d’une communauté biotique et cesser de se considérer comme son exploitant. » Prenant l’exemple de la Californie, ils proposent de partir des bassins-versants « empreintes fondamentales de toute vie locale » et d’en devenir les responsables. Préserver plutôt qu’exploiter, respecter plutôt que profiter afin de se fondre dans toute la diversité et la réciprocité des relations avec le vivant et les processus naturels d’un lieu.
Quelque chose est en train de se passer en Californie. Le phénomène est difficile à qualifier ou à quantifier, pour autant que la plupart de ses acteurs ne souhaitent ni être répertoriés, ni être mis en avant. Mais la chose est claire : un peu partout se déploient des communautés de gens qui tentent de nouvelles manières de vivre sur et avec la Terre. Nous appelons ce phénomène réhabitation, un processus qui implique d’apprendre à « vivre in situ » (living-in-place).
Vivre in situ
Vivre in situ signifie suivre les nécessités et les plaisirs de la vie telles qu’elles se présentent de façon singulière en un lieu particulier, et développer des moyens d’assurer une occupation durable de ce lieu. Une société qui vit in situ s’applique à conserver des échanges équilibrés avec sa région d’accueil au travers de liens multiples entre les vies humaines, les autres entités vivantes et les processus naturels de la planète — saisons, climats, cycles de l’eau — tels qu’ils apparaissent en cet endroit précis. C’est l’antithèse d’une société qui se pense à court terme et « gagne sa vie » (makes a living) au moyen d’une exploitation destructrice de la terre et de la vie. Vivre in situ est une manière d’être immémoriale, qui a été en quelque sorte désintégrée un peu partout dans le monde, tout d’abord, il y a plusieurs millénaires de cela, par l’émergence d’une civilisation fondée sur l’exploitation et, plus profondément encore, durant les deux derniers siècles, par le développement de la civilisation industrielle. Ce concept de vie in situ, toutefois, ne s’oppose pas à l’idée de civilisation – au sens le plus humain du terme. C’est peut-être, tout au contraire, le seul moyen de concevoir une existence vraiment civilisée et durable à la fois.
« Vivre in situ signifie suivre les nécessités et les plaisirs de la vie telles qu’elles se présentent de façon singulière en un lieu particulier, et développer des moyens d’assurer une occupation durable de ce lieu. »
Au sein de presque toutes les régions de l’Amérique du Nord, dont la majorité de la Californie, les milieux et écosystèmes hébergeant la vie ont été largement affaiblis. La richesse originelle de la diversité biotique a été considérablement réduite et altérée au profit d’un panel étroit de semences et de ressources souvent non originaires des lieux. Un abus chronique a ruiné de larges surfaces d’exploitations agricoles, de forêts et de terres autrefois florissantes. Des déchets de zones industrielles concentrées à l’absurde ont rendu presque invivables un certain nombre de lieux. Mais, indépendamment du mythe du « territoire infini » et de la mentalité conquérante qui ont fini par prédominer sur le continent américain, détruisant les espèces et les peuples indigènes les uns après les autres pour que les envahisseurs puissent gagner leur vie, nous savons maintenant que la perpétuation de l’espèce humaine est intimement liée à la survie des autres formes de vie. Vivre in situ contribue à la possibilité d’une telle continuation. Sa mise en place est devenue une nécessité pour les peuples qui voudraient demeurer au sein d’une région sans la dégrader de façon plus désastreuse encore.
« Vivre in situ contribue à la possibilité d’une telle continuation. Sa mise en place est devenue une nécessité pour les peuples qui voudraient demeurer au sein d’une région sans la dégrader de façon plus désastreuse encore. »
Autrefois, toute la Californie était peuplée de gens qui savaient utiliser ses terres avec modération, de sorte à endommager le moins possible sa capacité à accueillir la vie. La plupart d’entre eux ne sont plus de ce monde. Mais si la destructivité de la société technologique peut être convertie de façon à accueillir et soutenir la vie, alors la terre pourra être réhabitée. Réhabiter signifie apprendre à vivre in situ au sein d’une aire qui a précédemment été perturbée et endommagée par l’exploitation. Cela signifie devenir originaire d’un lieu, devenir conscient des relations écologiques particulières qui opèrent au sein de ce milieu et autour de lui. Cela signifie entreprendre des activités et faire naître des comportements sociaux capables d’enrichir la vie de cet endroit, de restaurer ses systèmes d’accueil de la vie, et d’y établir un mode d’existence (pattern of existence) écologiquement et socialement durable. Dit en peu de mots, cela implique de devenir pleinement vivant, au sein d’un lieu et avec lui. Ce qui implique de demander à faire partie d’une communauté biotique et cesser de se considérer comme son exploitant.
« Réhabiter signifie apprendre à vivre in situ au sein d’une aire qui a précédemment été perturbée et endommagée par l’exploitation. [...] Dit en peu de mots, cela implique de devenir pleinement vivant, au sein d’un lieu et avec lui. Ce qui implique de demander à faire partie d’une communauté biotique et cesser de se considérer comme son exploitant. »
Des informations utiles aux réhabitants peuvent provenir d’une grande variété de sources. Sont utiles les études menées par les autochtones, en particulier les récits d’expérience de ceux qui ont vécu auparavant à cet endroit – aussi bien ceux qui y ont « gagné leur vie » que ceux qui ont vécu in situ. Les réhabitants peuvent se servir de ces informations à leur manière, en inventant de nouvelles façons de vivre et en établissant de nouvelles relations avec la Terre et la vie qui les entoure. Cela pourra aider à déterminer la nature de la biorégion au sein de laquelle ils réapprennent à vivre.
Le processus de réhabitation implique le développement d’une identité biorégionale, quelque chose que la plupart des Nord-Américains ont perdu, ou n’ont jamais eue. Nous définissons le concept de biorégion en un sens différent des provinces biotiques de Dasmann [1] et des provinces biogéographiques d’Udvardy [2]. Notre terme fait référence autant au contexte géographique qu’au contexte cognitif — autant à un lieu qu’aux idées qui ont été développées à propos des manières de vivre en ce lieu. Au sein d’une biorégion, on trouve une uniformité de conditions d’influence du vivant ; conditions qui à leur tour influencent l’occupation humaine.
Une biorégion peut initialement être déterminée par le biais de la climatologie, de la géomorphologie, de la géographie animale et végétale, de l’histoire naturelle et d’autres sciences naturelles encore. Cependant, ce sont les gens qui y vivent, avec leur capacité à reconnaître les réalités du vivre in situ qui s’y pratique, qui peuvent le mieux définir les limites d’une biorégion. Toute vie sur la Terre est interconnectée par un ensemble de moyens assez évidents pour certains, et largement inconnus pour beaucoup d’autres. Entre les êtres vivants et les facteurs qui les influencent, il existe toutefois une résonance particulière, spécifique à chaque endroit de la planète. Découvrir et relever cette résonance est un moyen de décrire une biorégion.
« Cependant, ce sont les gens qui y vivent, avec leur capacité à reconnaître les réalités du vivre in situ qui s’y pratique, qui peuvent le mieux définir les limites d’une biorégion. »
Les réalités d’une biorégion sont, dans l’ensemble, assez évidentes. Personne ne confondrait le désert des Mojaves avec la fertile Vallée Centrale de Californie, ou les terres semi-arides du Grand Bassin et la côte californienne. Entre les biorégions majeures, les différences sont suffisamment marquées pour que les peuples n’essayent pas de vivre sur les côtes de l’Oregon comme ils le feraient dans le désert de Sonora. Mais les gradations internes sont nombreuses. Le maquis (chaparral) des contreforts du sud de la Californie ne se distingue pas franchement de celui des chaînes côtières du nord de l’État. Les habitudes et comportements des habitants de ces deux régions ainsi que les grands centres urbains auxquels ils sont reliés (San Francisco et Los Angeles) sont toutefois différents, si bien que cela peut produire différentes manières de vivre sur ces terres.
La Californie septentrionale est entourée de montagnes au nord, à l’est et au sud, et s’étend sur une bonne distance le long de l’Océan Pacifique à l’ouest. Parce que les frontières biorégionales dépendent aussi en partie des comportements humains, elles ne peuvent pas être clairement cartographiées. Ces comportements, toutefois, persistent depuis des temps préhistoriques. La région est séparée de la Californie méridionale par la barrière que forment les Monts Tehachapi et leur extension au travers de la chaîne montagneuse des Transverse Ranges jusqu’au Point Conception côté mer. Et si, dans une certaine mesure, la faune et la flore changent de part et d’autre de cette frontière, ce sont surtout les comportements humains qui diffèrent. À l’est, la région est définie par la Sierra Nevada, chaîne montagneuse qui stoppe les pluies et donne à la biorégion sèche du Nevada son caractère. Au nord, la chaîne volcanique des Cascades et les anciennes formations géologiques des Monts Klamath séparent la biorégion de l’Oregon. Le long de la côte, les frontières sont plus floues, même s’il semble qu’une ligne se dessine à la limite nord de la forêt côtière de Redwood, sur le fleuve Chetco.
Du point de vue biologique, la province biotique californienne, qui forme le cœur de la biorégion, est non seulement unique mais aussi incroyablement riche – un véritable refuge pour nombre d’espèces cachées, rempli de formes animales et végétales endémiques. C’est une région au climat méditerranéen tout à fait unique en Amérique du Nord, à la fois un lieu où peuvent survivre des espèces autrefois omniprésentes et un territoire où ont évolué d’autres formes de vie distinctes. Du point de vue anthropologique, il s’agit aussi d’un cas unique, d’un refuge pour une grande variété de non-agriculteurs au sein d’un continent où l’agriculture est devenue prépondérante.
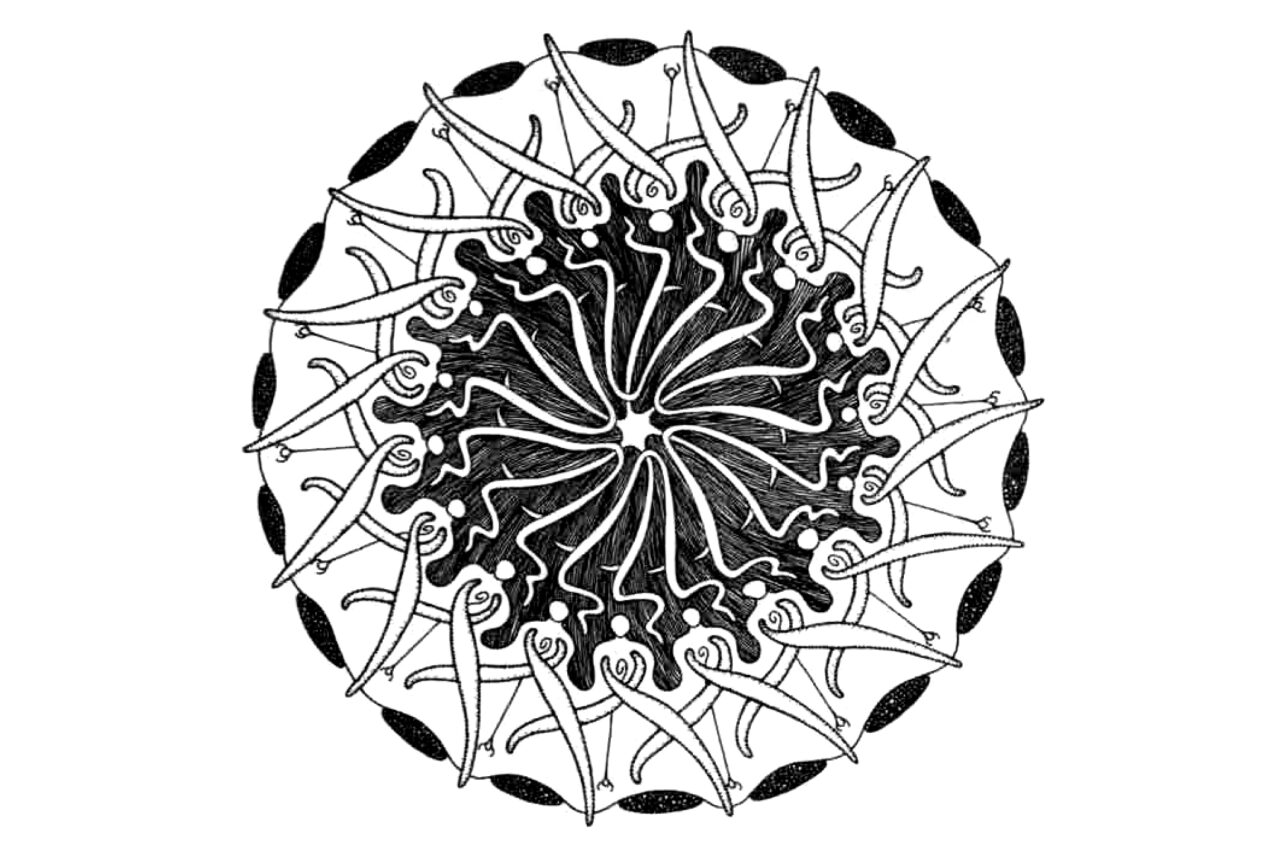
Durant le siècle et demi pendant lequel une société d’envahisseurs a occupé la Californie du Nord, les géomètres, à travers la division des terres qu’ils réalisèrent, ont donné un certain sens au lieu. Nous en savons plus à propos du cadastre qu’à propos de la vie qui se meut sur, sous et au travers des terres cadastrées. Les gens sont bombardés d’informations à propos du prix monétaire des choses, mais ils n’apprennent que rarement quoi que ce soit sur leur coût planétaire réel. On les encourage à mesurer la dimension des choses sans rien leur apprendre de leur place dans la continuité de la vie biorégionale.
Au sein de la biorégion se trouve un bassin-versant majeur, celui du système hydrologique du Sacramento-San Joaquin, qui draine les eaux de toute la Sierra Nevada, des chaînes montagneuses côtières des Cascades, pour s’écouler par les larges plaines de la Vallée Centrale. Sur les côtes, de plus petits bassins-versants sont significatifs : ceux des fleuves Salinas, Russian, Eel, Mad, Klamath et Smith. Le fleuve Klamath est atypique puisqu’il draine les eaux d’une aire géographique appartenant à une biorégion différente. C’est également le cas de la rivière Pit, qui rejoint le Sacramento. Ces exceptions mises à part, lire les différents systèmes hydrologiques aide à définir et caractériser la vie d’une même biorégion, de même que les caractéristiques des bassins-versants font apparaître les nécessités que ceux qui voudraient vivre in situ doivent s’employer à reconnaître.
Notre vraie « période de découverte » vient seulement de débuter. La biorégion est à peine reconnue dans les travaux sur les interrelations entre les systèmes de vie qui la composent. Savoir si nous pourrons continuer à vivre ici est toujours un mystère angoissant. Combien de personnes une biorégion peut-elle supporter sans s’auto-détruire encore plus ? Quels genres d’activité devraient être encouragés ? Lesquels sont trop désastreux pour être maintenus ? Comment les gens pourraient-ils s’approprier les critères biorégionaux de manière à ressentir ces derniers comme des règles existant pour le bien-être de tous plutôt que comme un ensemble contraignant de lois imposées ?
Les bassins-versants naturels pourraient être reconnus comme les éléments autour desquels les communautés s’organisent en premier lieu. Le réseau des sources, des ruisseaux et des rivières s’écoulant dans une zone spécifique exerce une influence de premier ordre sur toute vie non humaine à un endroit donné ; c’est l’empreinte la plus fondamentale de toute vie locale. Les inondations et les sécheresses de la Californie du Nord nous rappellent que les bassins-versants affectent la vie humaine elle aussi, mais leur influence globale est plus discrète et diffuse. Les communautés indigènes s’étaient installées à proximité des ressources, et les limites entre tribus étaient souvent définies par les limites des bassins-versants. Les campements des colons ont suivi le même modèle, expropriant souvent les groupes indigènes dans le but de protéger leur propre accès à l’eau.
« Le réseau des sources, des ruisseaux et des rivières s’écoulant dans une zone spécifique exerce une influence de premier ordre sur toute vie non humaine à un endroit donné ; c’est l’empreinte la plus fondamentale de toute vie locale. »
Ainsi, les communautés réhabitantes devraient prioritairement mener des actions pour bien définir les bassins-versants locaux, restreindre la croissance et le développement humain pour qu’il corresponde aux limites des ressources en eau, veiller à la conservation de ces réserves et à la restauration du libre cours des affluents qui ont été bloqués et au nettoyage de ceux qui ont été pollués, ou encore mener des recherches sur les interactions avec le système hydrologique plus large. En tout cela, les réhabitants pourraient à la fois se centrer sur les bassins-versants et en être les responsables.
De tout temps, les peuples ont été des membres à part entière de la vie biorégionale. La plupart du temps, ils avaient un effet positif sur les autres formes de vie qui partageaient ces lieux. En décrivant de quelle façon pas moins de 500 « républiques » tribales distinctes ont pu vivre côte à côte en Californie pendant plus de 15 000 ans, sans hostilité sérieuse ni perturbation des écosystèmes environnants, Jack Forbes mit à jour, en 1971, une différence majeure entre habitants et envahisseurs.
« Les peuples autochtones de Californie […] ne se considéraient pas vraiment comme des individus autonomes et indépendants. Ils s’envisageaient comme étant profondément liés avec d’autres gens (et avec les formes environnantes de vies non humaines) au sein d’un réseau vivant interconnecté et complexe, c’est-à-dire, une vraie communauté […]. Toutes les créatures et les choses étaient […] frères et sœurs. De cette idée provint le principe fondamental de non-exploitation, de respect et de révérence pour toutes les créatures, un principe extrêmement hostile au type de développement économique, mortifère pour les mœurs humaines, que conçoivent typiquement les sociétés modernes. (Je pense que c’est ce principe plus que tout autre qui permit de conserver la Californie dans son état naturel pendant plus de 15 000 ans ; et la violation de ce même principe qui, en un siècle et demi, a mené la Californie au seuil de la destruction.) » [3]
Les réhabitants sont aussi différents des envahisseurs que ceux-ci ne l’étaient des habitants originels. Ils veulent se fondre dans le lieu, ce qui requiert une préservation de celui-ci. Leurs objectifs les plus fondamentaux sont de restaurer et de conserver les bassins-versants, la couche arable de la terre et les espèces locales : des éléments absolument nécessaires à une existence in situ parce qu’ils déterminent les conditions essentielles en matière d’eau, de nourriture et de stabilité de la biodiversité. Leur but peut inclure le développement de cultures biorégionales contemporaines capables de célébrer la continuité de la vie où ils vivent, et de nouvelles formes de participations inter-régionales avec d’autres cultures basées sur notre appartenance mutuelle, en tant qu’espèce, à la biosphère. Transiter vers une société réhabitante, toutefois, requiert des changements fondamentaux dans la direction prise par les actuels systèmes économiques, politiques et sociaux.
« Les réhabitants veulent se fondre dans le lieu, ce qui requiert une préservation de celui-ci. Leurs objectifs les plus fondamentaux sont de restaurer et de conserver les bassins-versants, la couche arable de la terre et les espèces locales : des éléments absolument nécessaires à une existence in situ parce qu’ils déterminent les conditions essentielles en matière d’eau, de nourriture et de stabilité de la biodiversité. »
Économies
D’un point de vue biologique, la Californie du Nord est riche – peut-être la plus riche de toutes les biorégions nord-américaines. Son économie actuelle est globalement fondée sur l’exploitation de cette richesse dans le but de générer un maximum de profits à court terme. Les systèmes naturels qui créent les conditions d’abondance de la région existent à la fois sur le court et le long terme. Il y a de l’eau, et il en a à nouveau chaque année. Il y a des sols riches, mais il a fallu des milliers d’années pour qu’ils se forment. Il y a toujours de grandes forêts, mais elles ont eu besoin de centaines d’années pour pousser ; et aucune ne s’est vraiment remise des coupes rases qui ont eu lieu au cours des siècles.
Des processus économiques réhabitants rechercheraient le nécessaire plutôt que le profit. Ils pourraient être plus efficacement nommés processus écologiques, puisque leur objet est de maintenir une continuité dans les systèmes vivants naturels, tout en en profitant et en les utilisant pour vivre. La plupart des formes actuelles d’activités économiques qui dépendent des conditions biorégionales naturelles pourraient se poursuivre au sein d’une société réhabitante, mais elles devraient se transformer pour pouvoir prendre en compte les variations entre court et long terme au sein de leurs cycles.
« Des processus économiques réhabitants rechercheraient le nécessaire plutôt que le profit. Ils pourraient être plus efficacement nommés processus écologiques, puisque leur objet est de maintenir une continuité dans les systèmes vivants naturels, tout en en profitant et en les utilisant pour vivre. »
La Vallée Centrale californienne est devenue un des centres nourriciers de la planète. L’agriculture s’y développe aujourd’hui à une échelle gigantesque ; des milliers de km2 y sont cultivés en permanence pour produire plusieurs récoltes annuelles. Des équipements lourds, alimentés par les énergies fossiles, sont présents à toutes les étapes du processus, et de plus en plus d’engrais artificiels sont utilisés. C’est une région naturellement productive. La Californie du Nord possède un climat tempéré, un apport constant en eau et ses terres comptent parmi les plus riches de toute l’Amérique du Nord. Mais une agriculture à une telle échelle est intenable sur le long terme. Le prix des énergies fossiles et des engrais chimiques ne fera qu’augmenter, tandis que les sols s’épuiseront progressivement.
Nous avons besoin d’une redistribution massive des terres au profit d’exploitations agricoles plus petites. Celles-ci tableraient sur la valeur nutritionnelle des cultures et sur la préservation des sols, développant des alternatives aux énergies fossiles et des systèmes de distribution de plus petite échelle. Plus de gens seraient impliqués, créant de fait des emplois et allégeant ainsi la population à charge pour les villes.
Il faut permettre aux forêts de se reconstruire. La coupe rase ruine la capacité des forêts à se constituer comme des ressources renouvelables sur le long terme. Une reforestation organisée selon les bassins-versants ainsi que des projets de restauration des ruisseaux sont nécessaires partout où l’exploitation forestière moderne a été entreprise. La coupe des arbres telle que pratiquée aujourd’hui génère de nombreux déchets ; sommets, souches et branches sont laissés sur place, tandis que les troncs sont transportés pour être transformés et revendus dans la région. Les artisans capables d’utiliser toutes les parties de l’arbre devraient être employés pour faire un usage optimal des matières tout en favorisant l’emploi d’un plus grand nombre de personnes dans la région. Les pêcheries doivent être protégées avec précaution. Elles fournissent un support de vie à long terme riche en protéines si elles sont bien utilisées, mais peuvent épuiser rapidement ces « niches » biologiques si elles sont mal gérées. Pêcher du poisson et prendre soin des pêcheries sont à voir comme les deux faces d’une même pièce.
La conscience réhabitante peut multiplier les opportunités d’emplois au sein d’une biorégion. Les nouveaux voisinages réhabitants pourraient être fondés sur l’échange d’informations, le projet coopératif, la mise en place de réseaux de travail ou d’outils intra et inter-biorégionaux, et la constitution de médias axés sur la biorégion et ses bassins-versants plutôt que sur la ville et la consommation. Une telle configuration pourrait remplacer la centralisation actuelle par une multitude de décentralisations. L’objectif d’une restauration et d’une conservation des bassins-versants, des sols et des espèces originaires d’un lieu invite à la création de nombreux emplois, ne serait-ce que pour réparer les dégâts biorégionaux déjà perpétués par la société des envahisseurs.
Politiques
Depuis l’occupation espagnole, c’est toute une succession de super-identités aliénantes qui a progressivement obscurci la singularité de la vie biorégionale de la Californie du Nord. La spécificité du lieu dans lequel il était question de vivre n’était tout simplement pas perçue.
Premièrement, l’endroit fut considéré comme une région de la Nouvelle-Espagne : une dénomination qui ne dit rien de ce lieu précis et qui agglomérait une douzaine de biorégions tout autour des Caraïbes n’ayant que peu de rapport avec elle. Ensuite, « California », qui était le nom donné à une île dans une fiction écrite au 16e siècle par un écrivain espagnol, devint le nom que l’on colla un peu grossièrement à la biorégion quand elle fut rattachée à la partie océanique de la Nouvelle-Espagne. Le territoire de l’« Alta California » s’approcha alors approximativement de la biorégion, mais par accident uniquement : les Espagnols ne cherchaient qu’à témoigner de leur avancée au-delà la « Baja California ». Par la suite, vers le début du 19e siècle, le Mexique la posséda (comme la moitié de la partie ouest des États-Unis), mais, dès le milieu de ce siècle, presque toute la biorégion fut incluse dans la partie annexée aux territoires mexicains appelés « California ». Or, ceux-ci englobaient un ensemble de régions totalement étrangères les unes aux autres, dont le désert du Grand Bassin et d’autres zones sèches similaires au bas des Monts Tehachapi.
La biorégion qui existe au sein de ce qui est communément appelé Californie du Nord peut maintenant être considérée comme un tout séparé du reste et, dans une optique de réhabitation du lieu, devrait avoir sa propre identité politique. Il ne fait aucun doute que tant qu’elle appartiendra à un État plus grand, elle sera sujette aux revendications que la Californie du Sud avance sur des questions qui concernent son propre bassin-versant. Sa rivière coule déjà dans les canalisations de Los Angeles ; le contrôle des usages dans la Vallée Centrale est lui-même chapeauté par des réglementations qui servent les intérêts des monocultures du Sud. Or, d’un point de vue réhabitant, ces deux faits représentent des menaces mortelles pour la biorégion. Les élections de ces dernières décennies ont fait apparaître de grandes divergences d’opinion entre le Nord et le Sud de la Californie. Il y a fort à parier que cette différence s’accentuera avec les années, augmentant encore la pression des masses de population du Sud sur les problématiques biorégionales vitales du Nord.
« En tant qu’État distinct, la biorégion pourrait reconfigurer ses frontières politiques pour créer des gouvernements à la fois liés à des bassins-versants précis et en même temps appropriés au maintien des lieux de vie locaux. »
La biorégion ne peut pas être traitée au regard de ses propres processus de continuité de la vie tant qu’elle n’est qu’une partie d’un ensemble plus large qui l’administre et la gouverne. Elle doit devenir un État séparé. En tant qu’État distinct, la biorégion pourrait reconfigurer ses frontières politiques pour créer des gouvernements à la fois liés à des bassins-versants précis et en même temps appropriés au maintien des lieux de vie locaux. Les conflits entre les villes et le pays pourraient être résolus sur des bases biorégionales. Peut-être que le plus grand avantage d’un État séparé serait la possibilité de proclamer l’existence d’un lieu au sein duquel chacun serait considéré comme membre d’une espèce partageant la planète avec toutes les autres.
Commentaire sur la traduction
Quatre versions de ce texte existent. Historiquement, sa toute première version est signée de Peter Berg seul, et s’intitule : « Strategies for reinhabiting the Northern California bioregion ». Paru dans la jeune revue Seriatim. Journal of Ecotopia en 1976, ce texte « déconcertant » – selon la critique de l’époque –, comporte l’une des premières occurrences historiques du terme de « biorégion ». Il est aujourd’hui disponible dans un recueil des principaux écrits de Peter Berg [4]. C’est sur les conseils de Raymond Dasmann, qui entreprit une réécriture partielle du texte, et grâce à sa position reconnue dans le milieu scientifique, que ce premier article de Berg put paraître dans la revue à la renommée internationale The Ecologist dès l’année suivante [5].
Une version augmentée de plusieurs paragraphes et remaniée par endroits fut par la suite publiée dans le premier ouvrage édité par la Planet Drum Foundation de Peter Berg et Judy Goldhaft en 1978, Reinhabiting a separate country : A bioregional anthology of Northern California. Cette version, qui est ici traduite, peut être considérée comme le résultat le plus abouti de la collaboration entre Berg et Dasmann. Enfin, une dernière version plus courte, et encore différemment remaniée, parut tardivement dans plusieurs autres publications [6].
Le traducteur tient à remercier chaleureusement Judy Goldhaft pour son autorisation de traduire le texte et son implication dans ce projet ; Alice Weil pour son aide, sa relecture et ses corrections, et Ken Rabin pour ses précieux conseils de traduction.
Traduction et commentaire
Peter Berg, Raymond Dasmann (1978), « Réhabiter la Californie », traduit de l’anglais par Mathias Rollot, in EcoRev’, n°47 – 1/2019, pages 73 à 84.
Nous remercions Mathias Rollot et la revue EcoRev’ qui nous ont autorisés à reproduire ce texte.
Notes
[1] Raymond F. Dasmann, A system for defining and classifying natural regions for purposes of conservation, International Union for Conservation of Nature and Natural Resources (IUCN), n° 7, Morges (Suisse), 1973.
[2] Miklos D.F. Udvardy, A classification of the biogeographical provinces of the world, International Union for Conservation of Nature and Natural Resources (IUCN), n° 18, Morges (Suisse), 1975.
[3] Jack D. Forbes, « The native American experience in California history », California Historical Quarterly, L, 3, septembre 1971, p. 234-242,
[4] Peter Berg, The biosphere and the bioregion, Cheryll Glotfelty & Eve Quesnel (eds.), Londres, Routledge, 2015, p. 263-270.
[5] « Reinhabiting California », The Ecologist, VII, 10, décembre 1977.
[6] Dont Van Andruss et al. (eds.), HOME ! A bioregional reader, Philadelphie, New Society Publishers, 1990, p. 35-38 ; David Pepper, Environmentalism : Critical concepts, Londres, Routledge, vol. 2, 2003, p. 231-236.