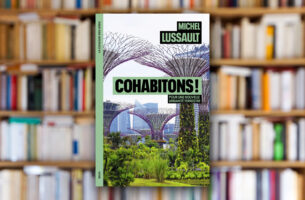Introduction
Alors que les risques anthropiques et industriels se multiplient, alors que « les humains rivalisent avec la nature en termes de destruction », nous interrogeons le géographe et documentaliste Alfonso Pinto à l’occasion de la publication de son ouvrage Anthropocène, âge du désastre : les catastrophes industrielles et leurs imaginaires (éditions deux-cent-cinq). Il nous explique « que certaines catastrophes industrielles n’ont pas d’après. Une fois déclenchées, elles s’installent dans notre quotidien pour des générations. La catastrophe assume une autre nature, non plus un phénomène ponctuel, mais une condition durable. »
Anthropie
Dans votre livre Anthropocène, âge du désastre, vous parlez autant de « risque », de « catastrophe » et de « désastre ». Quelles distinctions faîtes-vous entre ces termes ?
Alfonso Pinto | D’un point de vue technique, les catastrophes (ou désastres) constituent la concrétisation d’un risque. Ce dernier résulte de l’interaction entre les aléas – qu’ils soient naturels ou anthropiques –, les enjeux des sociétés humaines et les vulnérabilités des territoires et des contextes concernés. Dans mon livre, j’ai choisi en revanche de traiter une catégorie spécifique de risques : ceux liés aux domaines de l’industrie et de la production d’énergie. Ces derniers appartiennent à la catégorie plus générale des risques dits « technologiques ». En m’inspirant des travaux du sociologue allemand Ulrich Beck, j’ai choisi d’englober à l’intérieur de cette notion toutes les externalités négatives des sociétés industrielles. De ce point de vue, les catastrophes industrielles réalisent les risques que toute industrie porte en elle. Ce ne sont pas seulement des évènements « explosifs » (au sens tant littéral que métaphorique), violents et qui attirent l’attention, elles recouvrent également les pollutions lentes, silencieuses, reposent sur des temporalités parfois longues et qui, parfois font encore plus de victimes. Ces phénomènes sont devenus une sorte de « normalité » dans nos sociétés industrielles, pourtant, leurs effets sur la santé et sur l’environnement sont souvent bien plus graves que certains évènements « explosifs » qui ont marqué nos esprits.
À notre époque, une catastrophe peut-elle être uniquement « naturelle » ou « industrielle » ?
Il n’existe pas de catastrophe naturelle. Bien que cette expression soit largement employée, elle est très dangereuse. Souvent elle sert à dissimuler les véritables causes de certains évènements tragiques : « C’est la nature ! On n’y peut rien ! ». Même des phénomènes sur lesquels les Terriens n’ont aucun contrôle doivent être interprétés dans le cadre des interactions entre humanité et milieu. Il suffit de penser au tremblement de terre de Lisbonne de 1755 et à la fameuse querelle qui opposa Voltaire et Rousseau à propos des responsabilités humaines. Ce sont les hommes qui ont choisi d’urbaniser les pentes d’un volcan, ce sont les hommes qui ont choisi de construire une ville faite de « maisons les unes entassées sur les autres » comme le disait Rousseau. Certainement l’avènement de la société industrielle a produit des risques et des catastrophes dont l’origine entièrement anthropique ne fait plus de doute. Pourtant, encore aujourd’hui, il y a une tendance à déresponsabiliser les actions humaines en mettant en cause l’idée d’une nature imprévisible. En outre, des phénomènes tels que la crise climatique ou le développement du nucléaire ont scellé le fait que désormais, les humains rivalisent avec la nature en termes de destruction.

Progrès
Longue est la liste des dégâts provoqués par les « progrès », que cela concerne la machine à vapeur, l’industrie chimique, les mines, etc., faut-il en déduire que l’histoire industrielle est jalonnée de désastres ? Cela ne corrobore-t-il pas la conviction de Paul Virilio, selon laquelle, tout progrès génère son accident ?
C’est une question d’une complexité extrême. L’histoire des désastres industriels est marquée par une accablante continuité. Dans tous les domaines, malgré des avancées technologiques indéniable, les catastrophes sont un phénomène récurrent. Pourtant le sens commun continue de les considérer comme des phénomènes exceptionnels qui brisent une sorte de « normalité » dans laquelle tout va bien. Le vrai problème concerne en revanche l’idée même de progrès. Je conçois ce dernier comme une amélioration réelle et factuelle de la condition humaine. Je me considère malgré tout comme un héritier des Lumières. Je pense que c’est le capitalisme industriel au XIXe qui a perverti l’idée même de progrès en le transformant en un pur instrument technico-scientifique dont le but est avant tout le profit. De ce point de vue, je dois beaucoup aux travaux de l’École de Francfort. La raison est devenue « raison instrumentale ». D’une manière absolument paradoxale, la raison s’est transformée de principe-guide en instrument au service d’un projet qui, somme toute, repose sur des pulsions profondément irrationnelle (destruction, consommation, exploitation, mort en masse, etc.).
Bhopal & Tchernobyl
Dans votre livre, parmi toutes les catastrophes industrielles, vous analysez plus particulièrement Bhopal et Tchernobyl, pour quelles raisons ?
Ces deux évènements constituent la quintessence du désastre industriel. Ils sont « exemplaires » en termes de victimes, de dégâts produits, mais surtout ils permettent de saisir l’un des traits marquants de ce genre d’évènements : leur temporalité inédite. Comme l’affirmait Patrick Lagadec, théoricien du « Risque Technologique Majeur » en 1979, (avant même Bhopal en 1984 et Tchernobyl en 1986), au moment où ils surviennent, les catastrophes industrielles ne font que commencer. Leurs effets néfastes perdureront pour des générations en contaminant potentiellement des régions entières pour un temps souvent indéterminé. Ces deux exemples témoignent l’avènement de désastres « sans temps ». Le désastre devient un état perdurant reposant sur une altération radicale de l’environnement et de la biologie du vivant.
Mais il y a d’autres raisons. Bhopal est un exemple clair d’une logique industrielle qui met en avant le profit aux dépens de la vie. C’est la multinationale blanche, américaine, puissante qui, volens ou nolens, méprise la vie et la santé d’une population indienne, pauvre et dépourvue d’instruments de défense. Et cela, non pas au sein d’une vision manichéenne axée sur la dichotomie bons vs méchants, mais tout simplement en raison des impitoyables stratégies de survie d’un système fondé sur la concurrence et le marché libre.
De l’autre côté Tchernobyl scelle l’effondrement définitif de la mythologie d’un nucléaire au service de la paix. Cette catastrophe constitue, en outre, une occasion pour réfléchir sur la parabole du socialisme réel, au-delà des simplifications historiques et politiques qui ont marqué les interprétations occidentales de cette expérience commencée en 1917. Et encore, le désastre de 1986 a représenté une véritable rupture dans notre imaginaire. De tous les évènements de ce type, il a été le seul à produire une esthétique, un imaginaire richissime qui s’est manifesté dans des domaines tels que les arts, la culture, etc.
Pendant longtemps on a cru à la version officielle qui attribuait cette catastrophe aux seuls dysfonctionnements de la bureaucratie soviétique. Sans Fukushima (2011), on aurait pu croire à cette version de l’histoire dictée par les gigantesques intérêts qui se cachent derrière les enjeux du nucléaire. Tout comme Tchernobyl, les conséquences de l’« accident » de 2011 sont encore largement méconnues. Seul le temps nous le dira. Cependant on ne peut que remarquer un fait. Fukushima est une catastrophe survenue 25 ans après Tchernobyl. 25 ans d’avancées technologiques n’ont pas été suffisants. En outre, à la différence de l’Union Soviétique, le Japon est, du moins en théorie, un pays libre, démocratique et transparent. Pourtant… tout comme à Tchernobyl, le désastre de Fukushima a été caractérisé par des silences, des omissions criminelles, des retards et conduites criminelles qui ont privilégié les intérêts privés au détriment du principe de précaution. L’ampleur de certains enjeux est tel qu’il dépasse les différents systèmes économiques et politiques.
Après
Que se passe-t-il une fois la catastrophe produite ? Comment rendre compte de « cet après » ?
Le problème est que, souvent, on ne peut plus dire quand le « pendant » finit pour laisser la place à l’« après ». D’un point de vue strictement technique, les catastrophes technologiques sont toujours une occasion d’apprentissage. Mais ce processus de compréhension reste confiné souvent aux seuls domaines technico-scientifiques. Rares sont les moments dans lesquels, à partir d’une catastrophe, on remet en cause certaines structures de notre société. On vient de l’affirmer à propos de Tchernobyl. Cet évènement a eu un impact énorme. Gorbatchev est arrivé à affirmer que cela a provoqué l’implosion de l’URSS. Cependant Tchernobyl n’a pas réussi à remettre en cause la production nucléaire d’énergie. La vérité est que certaines catastrophes industrielles n’ont pas d’après. Une fois déclenchées, elles s’installent dans notre quotidien pour des générations. La catastrophe assume une autre nature, non plus un phénomène ponctuel, mais une condition durable.
Représentation
Pourquoi insister sur les représentations des catastrophes ? Pourquoi ces films n’incitent-ils pas les « décideurs » à interdire la vente de produits toxiques ou la construction d’usines dangereuses ?
Il serait naïf de penser qu’un film ou une série puisse avoir un tel impact politique. Les représentations des catastrophes peuvent, au mieux, nourrir notre réflexion et nous fournir des éléments ultérieurs à la compréhension d’un monde de plus en plus complexe et contradictoire. Bien avant les imaginaires, l’industrie est le terrain idéal pour comprendre comment il n’y a ni bons ni méchants dans le monde. Il y a des logiques qui nous ont été imposées et dont nous ne parvenons pas à nous débarrasser. À Bhopal, on produisait des pesticides. Aujourd’hui, on sait qu’ils sont toxiques, mais en même temps, il y a plus de 8 milliards de personnes à nourrir. Nous voulons préserver notre environnement, mais en même temps, nous ne voulons renoncer à aucun de nos privilèges. Les décideurs font les intérêts d’un système fondé sur le profit et sur l’exploitation.
« Transition », « green deal », « soutenabilité » sont des mots insensés. Ils ne sont rien d’autre qu’une énième occasion de profit qui renforce une illusion somme toute rassurante : notre monde, tel qu’il est, basculera doucement vers un système vertueux fondé sur le respect de l’environnement. C’est une illusion. La vérité est que pour défendre nos styles de vie on fait et on continuera de faire ce que nous faisons depuis deux siècles : nous confierons à ceux qui sont plus pauvres les coûts socio-environnementaux de notre illusion verte. Nous mangerons du bio, tandis que des millions de personnes chercheront désespérément des pesticides et des engrais chimiques pour éviter la famine. Nos villes seront végétalisées et parcourues par des engins électriques à zéro émission. Peu importe où et comment nous produirons les batteries et tous les autres composants. Peu importe où et comment nous nous alimenterons en énergie. Peu importe où et comment nous nous débarrasserons de nos scories nucléaires. Derrière l’écologie mainstream se cache une hypocrisie inacceptable qui alimente – volens ou nolens – un capitalisme toujours plus gourmand et impatient de tirer profit de nos illusions et de notre mauvaise conscience. La vérité est que la question environnementale n’est que l’énième facette d’une question sociale qui s’aggrave davantage. Dissocier ces deux éléments est en revanche un privilège que nous ne pouvons plus nous permettre.
En tant que documentariste, vous montrez ce qui est d’ordinaire dissimulé, faut-il voir pour y croire et réagir ?
Je me permets de citer Marco Armiero, historien de l’environnement et auteur, entre autres, de la théorie sur le wasteocène. « Il ne suffit pas de savoir qu’une usine pollue pour briser le chantage sur l’emploi ». Depuis 2019, je mène une recherche dans l’une des zones les plus polluées d’Europe : le pôle pétrochimique de Syracuse, en Sicile. Le chantage sur l’emploi est tellement fort que parfois, même les malades de cancer, même ceux qui ont perdu des proches à cause des pathologies liées à la pollution, s’obstinent à défendre les industries, considérées comme la seule source de revenus possibles dans ce territoire.
« Il vaut mieux mourir d’un cancer que de faim » dit un slogan atroce que certains activistes de la zone ont entendu à plusieurs reprises. Ce n’est pas facile d’aborder tout cela. D’un côté, je ne peux qu’être choqué. De l’autre, je pense au fait que j’ai eu la chance de naître dans un contexte qui ne m’a jamais confronté à ce genre de dilemme. Alors, j’essaie toujours de modérer mes jugements. Dans mon livre, je ne parle pas de ce territoire et de ces problèmes. Je l’ai fait dans le documentaire Toxicily que j’ai réalisé avec François Xavier Destors, et je le ferai à d’autres occasions. Cependant ma réflexion théorique sur les désastres industriels doit beaucoup également à cette exploration qui m’a conduit à connaître un territoire marqué par l’industrialisation et sa population qui en éprouve les conséquences jusque dans les méandres de leurs corps intoxiqués. À mes yeux, cette terre condense tous les enjeux d’une épopée humaine gigantesque… quelque chose qui, un peu comme l’Anthropocène, dépasse notre capacité d’entendement. Cette expérience « directe », non médiée par les paroles ou les images de quelqu’un d’autre, a inévitablement influencé ma démarche intellectuelle (et pas que !). Pour comprendre certains phénomènes, il est parfois nécessaire d’y mettre les pieds. Littéralement.
Questions
Martin Paquot & Thierry Paquot
Réponses & photographies
Alfonso Pinto
Alfonso Pinto, Anthropocène, âge du désastre. Les catastrophes industrielles et leurs imaginaires, « à partir de l’anthropocène », éditions deux-cent-cinq, 118 pages, 12,50 euros.