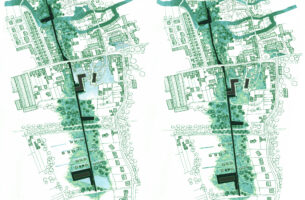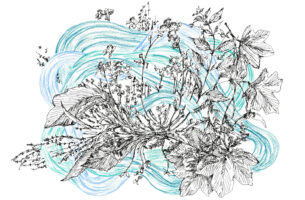Introduction
Les épisodes de crues et de sécheresses se multiplient, les premières de plus en plus violentes, les secondes de plus en plus longues. Lors d’un colloque pluridisciplinaire initié par Marin Schaffner et Mathias Rollot autour des « politiques du cycle de l’eau », le paysagiste et chercheur Frédéric Rossano explique que « mieux vivre avec les crues suppose de passer d’une culture de la lutte pour une sécurité absolue mais hors d’atteinte à une culture de l’attention et du soin qui assure l’habitabilité d’espaces hygrophiles reconnus comme fluctuants et vulnérables. »
L’histoire contemporaine de la gestion des crues est pour l’Occident une histoire de luttes, de défaites douloureuses, de lignes de front mouvantes que l’on tente de figer, de victoires que l’on pense finales, de colonisations que l’on espère définitives.
Les héros de ces batailles sont des empereurs, des rois, des ingénieurs, des géomètres. Citons pour la France Henry IV, puis Louis XIII et Louis XV qui encouragèrent l’assèchement des zones humides, puis Napoléon III, qui fit des inondations de 1856 le déclencheur d’une vaste entreprise de transformation du Rhône et de la Loire. Citons aussi Frédéric II, modèle de Napoléon Ier, que Voltaire louait pour ses grands travaux de drainage des marais de l’Oder (« Je vous bénis de mon village de ce que vous en avez tant bâti ; je vous bénis au bord de mon marais de ce que vous en avez tant desséché », lui écrivait-il, dithyrambique, en 1773[1]). Citons les ingénieurs : le badois Johann G. Tulla, formé en France et entraîné sur la correction de la Linth suisse, resté dans l’histoire comme « l’homme qui dompta le Rhin » ; Ignace Venetz qui a associé son nom à la canalisation du Rhône valaisan, resserré par un système d’épis transversaux ; Guillaume Comoy, qui donne son nom au système de digues déversoirs aménagées pour contrôler les crues de la Loire.
De cette époque de grands travaux, qui ne s’est achevée que dans les années 1970, nous héritons de plaines et de vallées déboisées et asséchées, des espaces littéralement « dénaturés » mais économiquement valorisées à l’extrême, grâce à des sols enrichis durant des millénaires, et grâce à des fleuves transformés en canaux navigables et en sources d’énergie. Nous reste également de cette grande auto-colonisation européenne un vocabulaire fondamentalement hygrophobe : on a chassé l’eau pour « assainir » et « viabiliser » les plaines, les rivières ont été « rectifiées », « corrigées », « soumises » et « domptées » ; avant l’œuvre de l’homme (on peut utiliser ici ce mot pour désigner l’humain, tant l’œuvre s’est voulu virile), les torrents étaient « rugissants », les marais « putrescents », leur air « mauvais » (d’où le nom de malaria donné au paludisme), les rivières « sauvages » et les crues « capricieuses » : il s’agissait de les soumettre et de les remettre dans leur lit, « comme les révolutions[2] » et les femmes insoumises[3].
« Ces crues en série ont révélé la faillibilité des aménagements qui avaient resserré les fleuves à l’extrême pour soutenir leur niveau et assurer leur navigabilité, et la vulnérabilité des anciens lits majeurs que l’on croyait définitivement asséchés, cultivables et urbanisables à merci. »
Frédéric Rossano
Si les grandes crues du milieu du XIXe ont eu pour effet d’accélérer les endiguements dans toute l’Europe occidentale, celles de la fin du XXe en ont montré les limites. En 1993, 1994 et 1995, les bassins du Rhin et du Rhône ont subi une série d’inondations dramatiques, suivis entre 1998 et 2002 par les bassins de l’Elbe et du Danube et, à nouveau, du Rhône. Ces crues en série ont révélé la faillibilité des aménagements qui avaient resserré les fleuves à l’extrême pour soutenir leur niveau et assurer leur navigabilité, et la vulnérabilité des anciens lits majeurs que l’on croyait définitivement asséchés, cultivables et urbanisables à merci. Ces inondations ont eu un effet paradoxal : en réaction aux dégâts considérables, elles ont favorisé la mise en œuvre de travaux longtemps repoussés d’entretien et de renforcement des digues ; par leur ampleur et leur durée, elles ont néanmoins causé une prise de conscience collective des limites de l’endiguement et de la nécessité de repenser le cours d’eau « à l’horizontale », dans l’ensemble de son bassin et de son espace d’expansion naturel. Ce changement de perspective impliquait logiquement de repenser l’aménagement du territoire pour faire de la place à l’eau plutôt que la contraindre toujours plus – et en envisageant le fleuve à nouveau comme un espace fluctuant, où toute occupation devrait tenir compte de la possibilité de son retour. C’est dans ce sens que les déclarations d’Arles et de Strasbourg (du 4 février et 30 mars 1995) furent signées par les ministres de cinq pays du bassin Rhin-Meuse, que fut adoptée la même année, en France, la loi dite Barnier imposant d’assurer « la conservation, la restauration ou l’extension des champs d’inondation », et que fut élaborée la directive inondation de l’Union européenne en 2007. C’est aussi dans ces décennies 1990-2020 que de vastes entreprises de reconfiguration des territoires fluviaux ont été engagées, avec les grands programmes de restauration d’espaces de crues : le programme « De l’espace pour la Rivière » à la confluence Rhin-Meuse aux Pays-Bas, achevé en 2016 ; le projet « Rhône III » en cours en Suisse ; de nouveaux « polders » le long du Rhin en Allemagne et en France ; le projet Isère Amont… pour ne citer que les plus vastes.
Cette chronologie du rapport occidental aux crues fluviales est bien sûr lacunaire et réductrice : des sociétés ont existé en Europe qui savaient cohabiter avec les crues et tirer parti des eaux en mouvement – douces, saumâtres ou salées. On trouve dans des espaces aussi éloignés que la basse vallée de la Loire, les plaines côtières de la mer du Nord et le delta du Rhône de semblables surélévations de terrain (werden, tertres ou recati), certaines datant d’avant l’ère chrétienne, qui offraient des refuges temporaires ou permanents à des populations parfaitement adaptées à leur territoire fluctuants, mi-terre mi-eau. L’histoire et les savoirs de ces autochtones des pays humides n’ont laissé malheureusement que peu de traces écrites, cartographiques ou physiques : espaces malléables par essence, les pays d’eau, de limon, de tourbe et de sable gardent peu de marques visibles de leurs états antérieurs. Les auteurs des « viabilisations » successives ont également pris soin d’effacer l’histoire des communautés hygrophiles, voire de dénigrer leurs modes de vie pour mieux vanter la nécessité de l’endiguement. À titre d’exemple, un rapport du Conseil des États helvétiques déplorait ainsi les « crétins » nombreux dans le Valais, affection causée selon les rapporteurs par l’humidité laissée par les crues du Rhône [4].
Pauvre, inculte et malade, l’habitant du fleuve était à plaindre, et c’était une mission à la fois charitable et progressiste que de contenir l’eau et de transformer les forêts alluviales en champs cultivés : « Il serait indigne d’un peuple civilisé de rester immobile devant les inondations presque périodiques qui viennent ravager ses terres les plus fertiles.[5] » Le vainqueur écrit l’histoire, et dans les guerres de l’eau, les bâtisseurs de digues ont gagné la bataille et effacé en quelques siècles des cultures adaptives ancestrales. « L’histoire des espaces humides reste en jachère[6] », mais l’archéologie des paysages se développe, notamment grâce à un intérêt renouvelé des scientifiques pour les interdépendances humain-environnement, et grâce à la finesse croissante des modèles numériques de terrain. Ces outils sont non seulement indispensables pour la compréhension et la gestion des crues et à l’établissement des PPRI, mais ils sont aussi précieux pour révéler les traces des passages passés des rivières et pour concevoir des projets situés dans l’espace et le temps de l’eau, et non seulement de l’ingénierie humaine.
Faire de la place à l’eau… mais où, comment et avec qui ?
Depuis le début du XXIe siècle, les pays européens se sont engagés dans une approche territoriale de la crue, et non plus seulement hydraulique. En France, la gestion des crues se décline à toutes les échelles, du PGRI (grands bassins hydrographiques) au PPRI (intercommunalité) en passant par le SLGRI (territoire à risque). Pour autant, si les outils de gouvernance s’étoffent et intègrent une vision plus spatiale, préventive et moins technocentrée, quelles cultures locales sont censées se développer pour les forger, les soutenir ou les mettre en œuvre ? Dans quels périmètres ? Ou pour reprendre la question des organisateurs de ce colloque : « qu’est-ce qu’une biorégion » pensée au prisme de l’eau ? Avec la liberté de ton permise à Cerisy, je me permettrais de proposer trois axes de réflexion :
1. (Ré) Inventer l’espace de l’eau
Marin Schaffner et Matthias Rollot rappelaient que 68 des 101 départements français portent un nom « aquatique »[7]. En Alsace d’où j’écris, comme dans de nombreux pays germanophones, la condition hydrographique est centrale dans l’identité des lieux au point d’être gravée dans leur nom : soixante noms de communes du Bas-Rhin comportent le suffixe -bach (ruisseau), -au (prairie humide) ou -bronn (source) ; et trente le suffixe -thal (vallon) ou -berg (colline). De nombreuses communes et quartiers strasbourgeois construits sur les anciennes zones humides en gardent ainsi la trace : Robertsau, Musau, Krutenau, Elsau, Eschau, Wantzenau… Si la fonction et la propriété des terrains peuvent changer, leur qualité hydro-géo-graphique est immuable et ces toponymes rappellent aux personnes qui l’entendent qu’elles vivent dans un espace emprunté à l’Ill et au Rhin, et qui reste exposé à leurs débordements potentiels ou aux remontées de nappe phréatique.
À l’inverse, force est de constater que l’espace français est réglementé non par sa réalité naturelle, mais par ce que l’humain y fait et en fait : le plan local d’urbanisme découpe et caractérise des « zones » selon des « fonctions » standardisées – résidentielles, industrielles, commerciales, agricoles ou naturelles (notion toute relative, cette dernière pouvant accueillir bâtiments publics, équipements de loisirs, sylviculture, arboriculture…) De ce jeu de distribution à la découpe qui s’ensuit ne subsiste rien ou peu de chose du socle naturel (eau, sol, relief, ensoleillement), qui conditionne pourtant la vie dans un site donné. Les plans de prévention des risques d’inondation (PPRI) entérinent la topographie héritée de siècles d’ingénierie, et des espaces situés au pied d’une digue, plusieurs mètres sous le niveau du Rhin, ne figurent ainsi pas en zone inondable – c’est le cas de la frange est de la métropole strasbourgeoise, bâtie dans l’ancien lit majeur du Rhin après son endiguement. Dans le PLU et le PPRI, aucune dénomination ou graphie ne caractérise l’espace de la rivière dans sa continuité, ses variations et son unicité : or c’est bien cet espace qui doit être habité de manière spécifique, par des populations a minima informées, de préférence sachantes et actives dans leur mode d’habiter un environnement aquatique, qu’il le soit en permanence ou épisodiquement.
« Dans le PLU et le PPRI, aucune dénomination ou graphie ne caractérise l’espace de la rivière dans sa continuité, ses variations et son unicité : or c’est bien cet espace qui doit être habité de manière spécifique »
Frédéric Rossano
Comment ramener cette essentialité dans un urbanisme fonctionnaliste et anthropocentré ? À l’amont, la loi Suisse a imposé aux cantons la définition de « l’espace nécessaire aux eaux superficielles [8] ». À l’aval, les Pays-Bas ont gravé dans la loi la différence fondamentale entre les espaces endigués (binnendijks) que l’état protège et assure, et les espaces hors digues (buitendijks) où toute activité et construction se font aux risques et périls des usagers [9]. Pourrait-on imaginer pour la France un supra-zonage paysager qui définisse de véritables zones « R » (comme « rivière ») pour le lit majeur des cours d’eau, et vienne former la première et principale couche du millefeuille réglementaire ?
2. Faire de la place à l’incertitude
« L’incertitude est indéracinable, et il y a tout lieu de l’approcher positivement, comme un fait inhérent à toute action sociale, et non comme une limite », affirmait Dirk Sijmons, paysagiste et l’un des superviseurs du grand programme néerlandais « De l’espace pour la rivière [10] ». Dans les espaces de l’eau, l’incertitude est une réalité permanente et multiple : elle est combinatoire (fonction d’aléas divers, fonte des neiges précoce ou tardive, pluie exceptionnellement longue ou intense, sols secs ou humides, nappes basses ou hautes…), et elle est multiscalaire dans l’espace (ruisseau, rivière, fleuve, bassin-versant…) et dans le temps (variation quotidienne, saisonnière, annuelle, climatique…) Tout aménagement dans l’espace de l’eau devrait ainsi logiquement tenir compte de plusieurs réalités : la multiplication d’épisodes de sécheresses et de pluies intenses impose de penser la durabilité, maître-mot de l’urbanisme des années 2000, non plus en termes de permanence mais en termes d’élasticité.
« En milieu rural comme urbain, l’enjeu est aujourd’hui non plus d’évacuer les crues au plus vite dans des réseaux toujours plus gros et plus coûteux, mais de savoir les ralentir et les diffuser dans des espaces multifonctionnels conçus pour cela, et de recharger au passage les sols en eaux en prévision des sécheresses à venir. »
Frédéric Rossano
En milieu rural comme urbain, l’enjeu est aujourd’hui non plus d’évacuer les crues au plus vite dans des réseaux toujours plus gros et plus coûteux, mais de savoir les ralentir et les diffuser dans des espaces multifonctionnels conçus pour cela, et de recharger au passage les sols en eaux en prévision des sécheresses à venir. Ce changement implique de penser un aménagement du territoire à plusieurs temps hydrologiques, comme le faisaient les hollandais qui, avant l’époque moderne, maintenaient des couloirs de passage pour les grandes crues de la Meuse et du Rhin, parfois nommées « rivières vertes ». Il implique aussi de penser les espaces urbains dans plusieurs états, secs, humides, détrempés, immergés, loin de la tradition stérilisatrice du « toujours propre » et du « zéro maintenance » : comme le soulignent les sociologues Heems et Koothuis, mieux vivre avec les crues suppose de passer d’une culture de la lutte pour une sécurité absolue mais hors d’atteinte à une culture de l’attention et du soin qui assure l’habitabilité d’espaces hygrophiles reconnus comme fluctuants et vulnérables [11].
3. Établir de nouvelles solidarités
L’eau occupe une position centrale dans l’organisation de nombreuses sociétés humaines. De par sa labilité et son mouvement, la crue est elle aussi un phénomène relationnel autant que physique : contrainte et repoussée vers la berge opposée ou vers l’aval, elle est un outil d’agression ; répartie et diffusée de part et d’autre et d’amont en aval, elle est un terrain de collaboration et de solidarités. La gestion des crues impose ainsi de choisir entre le conflit et l’interdépendance. Une gestion « intégrée », souhaitée par tous les gouvernements, suppose la mise en place de solidarités territoriales et au préalable, la reconnaissance d’appartenance à une communauté hydrologique (bassin, vallée, polder…), et plus souvent à plusieurs communautés hydrologiques emboîtées. Non sans raison, les grands projets de mitigation font appel à des dispositifs de déplacement des crues de zones considérées comme fragiles, critiques, ou de grande valeur vers des zones jugées plus résilientes, d’importance secondaire ou de moindre valeur. Typiquement, la crue est déplacée des zones urbaines vers les zones rurales, un déplacement qui fait l’objet d’âpres négociations entre urbains et ruraux pour définir les espaces concernés par cet échange de sécurité économique contre sécurité hydraulique, et pour en définir les modalités, la fréquence de mise en œuvre et les conditions de compensation des pertes de matériel et d’exploitation. Ces solidarités mises en place et contractualisées localement dans plusieurs vallées européennes, en plus d’augmenter la résilience globale des territoires, soulèvent deux questions subsidiaires : quelles activités sont encore possibles dans une zone désignée comme espace d’expansion des crues (un temps appelés « polders de calamité » par les agences de l’eau hollandaises, avant de trouver un nom moins repoussoir pour les communautés locales) ? Et quelle valeur attribuer au territoire pour définir les « zones à défendre » et les « zones à sacrifier » ?
« De par sa labilité et son mouvement, la crue est elle aussi un phénomène relationnel autant que physique : contrainte et repoussée vers la berge opposée ou vers l’aval, elle est un outil d’agression ; répartie et diffusée de part et d’autre et d’amont en aval, elle est un terrain de collaboration et de solidarités. »
Frédéric Rossano
Aux deux questions, les réponses binaires sont inopérantes. Il s’avère d’une part socialement et économiquement plus acceptable d’inventer et de développer des modes de vie et des cultures compatibles avec l’inondabilité que de vider de vastes pans de territoires de leur population humaine pour en protéger d’autres. D’autre part, une solidarité à sens unique, des espaces ruraux vers les espaces urbains, est moins évidente qu’il n’y paraît ; le monde rural est d’un côté rarement disposé à endosser seul le rôle de « parechoc » au bénéfice de villes qui ont allègrement bâti leurs zones inondables, et argumente à juste titre que l’alimentation est aussi vitale que la protection contre les crues. Les souhaits de conscientisation et de mobilisation des populations urbaines exposées aux crues supposent par ailleurs d’intégrer leur gestion au plus près des populations protégées, afin de rendre les fluctuations hydrographiques sensibles et visibles pour le plus grand nombre, et non pas cachées derrière une digue ou un lointain barrage de retenue. Les solidarités durables sont ainsi celles qui favorisent la proximité, l’échange et la collaboration – c’est la grande réussite du programme néerlandais « De l’espace pour la rivière » que d’avoir retissé des liens territoriaux réciproques, entre amont et aval et entre villes et champs.
Post-scriptum : Attention à la marche
A. Risques et avantages de la caricature
Dans le domaine hydraulique comme dans beaucoup d’autres, la sortie progressive d’une ère technocentriste et impérialiste donne lieu à nombre de révisions historiques nécessaires à une meilleure compréhension de notre environnement, et à une action qui ne soit pas aveuglée par des récits dépassés. Les figures invoquées au début de cet article de « rois ingénieurs » ou d’ingénieurs « dompteurs » sont des figures emblématiques d’une époque critiquable et critiquée, mais il me semble nécessaire de souligner que la personnalisation de la « lutte » contre l’eau et la « conquête » des zones humides et alluviales répondait à des aspirations diverses, agrégées habilement par les pouvoirs en place. On trouve ainsi dans la plupart des grands travaux de canalisation des motivations économiques (favoriser le commerce fluvial, accroître les surfaces agricoles), territoriales (sécuriser les ressources eau et agrandir l’espace exploitable), militaires (fixer les frontières nationales), politiques (asseoir l’autorité de l’état sur les provinces), hygiénistes (éradiquer les maladies que l’on pense issues des marais), religieuses et culturelles (exercer le rôle dominant que Dieu aurait donné à l’être humain, civiliser le sauvage)… Ces travaux ont ainsi fédéré des acteurs divers unis par des intérêts convergents, généré de vastes mobilisations, et souvent une fierté collective. « Dieu a créé le monde et les Néerlandais ont créé la Hollande » entendait-on souvent aux Pays-Bas, où nombre de toponymes portent le suffixe -dam (barrage), -dijk (digue) ou -polder. On retrouve cette même fierté dans les vallées alpines enrichies par le drainage, la maîtrise de la production hydro-électrique et l’industrialisation qu’elle a générée, conçus comme des éléments constitutifs d’une identité locale issue des efforts de plusieurs générations.
J’espère contribuer à une nécessaire relecture critique de l’époque moderne, tout en respectant les aspirations légitimes de populations dont les cultures ont été forgées par cette même époque. Durant mes investigations, j’ai constaté un rejet violent des discours simplistes incitant à « rendre la rivière à la nature » – restitution de terres « volées » à une nature qui serait par définition bienveillante et nourricière. « Ne blâmez pas les gens qui défendent leur subsistance [12] » : ce mot simple d’un partisan de la destruction du barrage de la rivière Elwha à propos de ses défenseurs, entendu dans le film Return of the River projeté durant le colloque, fait écho à cette préoccupation d’équilibre du regard, à mon sens nécessaire à toute transformation collective.
B. Construire patiemment pour agir vite
Une des remarques faites à l’issue de ma présentation concernait la temporalité des projets de restauration des cours d’eau et des espaces de crues, plus précisément le besoin de lenteur pour construire un consensus durable. La remarque me semble partiellement juste : les rapports complexes et paradoxaux qu’entretiennent les populations de l’espace fluvial avec leurs espaces de vie, la nécessité de construire des solidarités multiples, le besoin de (re)construire des cultures autochtones dans les pays d’eau (cf. points précédents) incitent à prendre le temps du dialogue et de la négociation. Dans mon livre La Part de l’eau [13], j’ai tenté de décrire les étapes de gestation des grands travaux de restauration des rivières, s’étendant sur des décennies, et je ne peux que souligner à quel point ces grandes transformations ont nécessité écoute, méthode et patience. La question est aujourd’hui néanmoins de savoir si nous avons effectivement le temps de prendre le temps. Le dérèglement climatique n’est plus une perspective : c’est une réalité qui s’accentue chaque année.
« Avec l’évolution des températures, c’est l’évolution des cycles de l’eau qui menace le plus l’environnement naturel et habité. »
Frédéric Rossano
Avec l’évolution des températures, c’est l’évolution des cycles de l’eau qui menace le plus l’environnement naturel et habité. La relative constance des grands fleuves européens, alimentés alternativement par les pluies des plaines et collines et par la fonte des neiges issues des grands massifs, va être fortement et durablement altérée par le réchauffement des Alpes et des Pyrénées, deux fois plus rapide que le reste du territoire. La merveilleuse mécanique d’alternance de crues nivales et de crues pluviales, qui alimente les prospères vallées européennes et assure la navigabilité de leurs fleuves, se dérègle, et ce dérèglement annonce des étiages et des crues plus fréquents et plus intenses. Face à ce constat continuellement mis à jour et à des perspectives alarmantes pour notre siècle, le temps d’action pour se prémunir de dégâts majeurs se raccourcit rapidement. Ici aussi, le programme néerlandais « de l’espace pour la rivière », magistralement conçu et mis en œuvre en une vingtaine d’années est un exemple à suivre…
C. L’ombre des nationalismes
L’ironie veut qu’aux jours où s’est déroulé le colloque, sous le soleil de Normandie, l’Eichel qui borde mon lieu de résidence, débordait de ses berges et inondait plusieurs villages. Autre collision, moins anecdotique, le colloque de Cerisy s’est tenu durant une période d’élection européenne puis française, qui ont vu une forte progression des partis nationalistes. En écho aux points précédents, il me semble utile de rappeler une évidence : les bassins hydrologiques et les cycles de l’eau se jouent des frontières des États-nations, et des ambitions d’autonomies souveraines.
« Revenir à des approches nationales pour lutter isolément contre les risques qui s’amoncellent, c’est retourner à des batailles stériles de l’écluse et du robinet. »
Frédéric Rossano
Revenir à des approches nationales pour lutter isolément contre les risques qui s’amoncellent, c’est retourner à des batailles stériles de l’écluse et du robinet. La nécessité d’une approche supranationale est particulièrement flagrante pour notre continent, dont les Alpes forment la source et le cœur qui alimente les « Veines de la Terre » d’Europe (pour faire écho à la métaphore proposée par Mathias Rollot et Marin Schaffner dans l’une de leurs précédentes publications). Ce cœur est comme le climat planétaire déréglé et en arythmie croissante. Accepter les communautés de destins hydrologiques multiples et emboîtées qui nous lient, locales, fluviales et continentales, c’est être en capacité d’anticiper efficacement les troubles de ce cœur et d’agir ensemble pour refaire de la place aux rivières et à leurs fluctuations.
Texte
Frédéric Rossano
Publication originale sous le titre « Du domptage au partage : vers de nouveaux accords humains-rivières pour vivre avec les crues », dans Marin Schaffner et Mathias Rollot (dir.), Vers des politiques des cycles de l’eau, Le Bord de l’Eau, 2025. Merci à l’auteur, aux directeurs du volume et à l’éditeur de leur accord pour cette republication.
Illustration
Laura Folmer
Notes
[1] Notice par Édouard De Pompéry, Correspondance de Voltaire avec le roi de Prusse, Librairie de la Bibliothèque Nationale, 1889, <https://www.gutenberg.org/files/25734/25734-h/25734-h.htm>.
[2] Napoléon III, cité dans Annie Méjean, « Utilisation politique d’une catastrophe : le voyage de Napoléon III en Provence durant la grande crue de 1856 », Revue historique, 1996, vol. 1, n° 597, p. 151.
[3] Napoléon III, cité dans Annie Méjean, « Utilisation politique d’une catastrophe : le voyage de Napoléon III en Provence durant la grande crue de 1856 », Revue historique, 1996, vol. 1, n° 597, p. 151.
[4] Schenk, et al., « Rapport de la Commission du Conseil des États sur la correction du Rhône », Feuille fédérale Suisse, 24 juin 1863, p. 33-65.
[5] Rapport Louvet, cité par Annie Méjean, 1856, op. cit.
[6] Jean-Michel Derex, « Pour une histoire des zones humides en France (XVII-XIXe siècle) », Histoire & Sociétés Rurales, 2001 / 1, vol. 15, p. 11-36.
[7] Collectif, Les veines de la Terre, Une anthologie des bassins-versants, Éditions Wildproject, 2021, p. 147.
[8] Loi fédérale 814.20 du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux, art. 36b en vigueur depuis le 1er janvier 2011.
[9] Les espaces hors digues étaient néanmoins cultivés et habités par environ 115 000 personnes en 2012. Brochure Waterveiligheid buitendijks, juillet 2012, tcm309-332427-1.
[10] Maarten Hajer, Fred Feddes et Dirk Sijmons (dir.), Een plan dat werkt. Ontwerp en politiek in de regionale planvorming, NAi Uitgevers, 2006, p. 37.
[11] Les discours utilisés jusqu’à présent dans le débat sur la sécurité contre les inondations (les discours de la lutte, de la victoire et de la menace) sont tous trois fondés sur le contrôle des risques. Le discours de l’attention et du soin [care], en revanche, est fondé sur l’acceptation de la vulnérabilité. » Geertruida Heems et Baukje Kothuis, Flood safety : Managing vulnerability beyond the myth of dry feet. A socio-cultural perspective on how the Dutch cope with the threat of flooding, Thèse (résumé en anglais), université de Maastricht, 2012.
[12] « Don’t blame people for trying to protect their livelihood », in : Return of the River, film documentaire, Jessica Plumb, John Gussman (dir.), 2014, États-Unis.
[13] Frédéric Rossano, La Part de l’eau, La Villette, 2021.