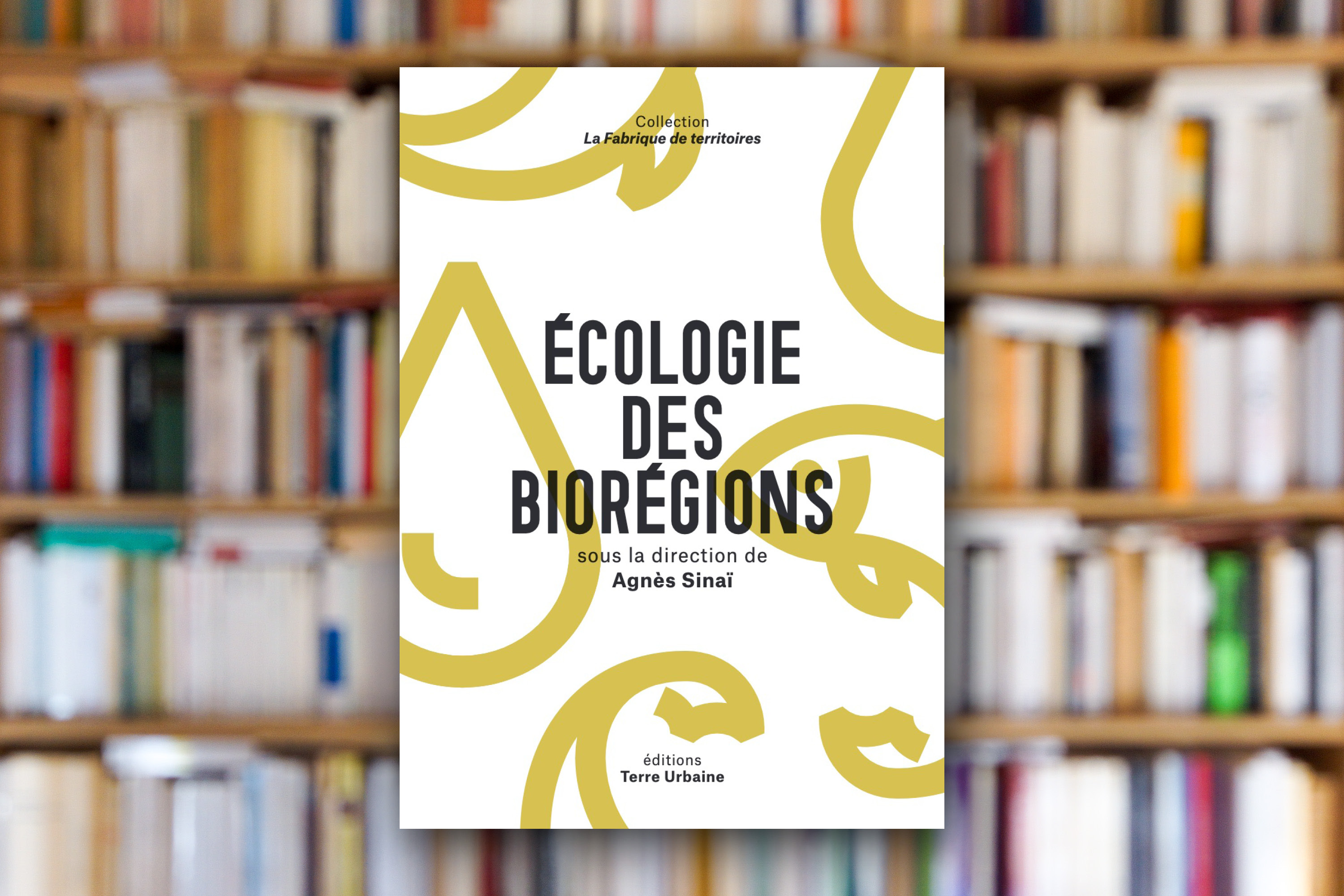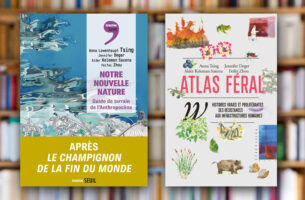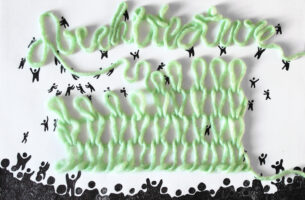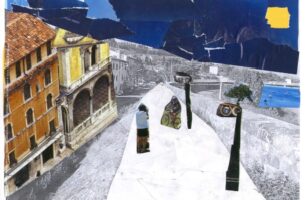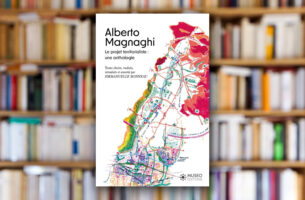Introduction
Publié sous la direction d’Agnès Sinaï, Écologie des biorégions présente des textes inédits résultant des Rencontres biorégionales organisées en 2024 [1]. Cet ouvrage collectif inspiré déplie les perspectives de l’« espérance biorégionale » [2], discute et actualise son dispositif conceptuel et démontre les vertus d’une approche intégrant l’écologie du paysage, le soin (care) du territoire, la dimension patrimoniale, et l’écologie de la résurgence. Cette diversité n’est pas seulement présente dans les manuels d’introduction et ouvrages théoriques [3], elle se manifeste aussitôt que le biorégionalisme est mis à l’épreuve du terrain.
L’imbrication des référentiels et la mutualisation des pratiques ne doit cependant pas édulcorer un biorégionalisme riche en possibles. Soucieux de nouvelles exigences, l’Écologie des biorégions permet de prendre la mesure de la diffusion du biorégionalisme et de la nécessité de certains recadrages afin de gagner en cohérence. Agnès Sinaï propose ainsi dans son introduction d’envisager « la biorégion comme le lieu décolonial et hospitalier d’une recomposition des mondes […] dans une perspective dépassant le manichéisme ville-campagne, métropoles-ruralités, Nord-Sud. »
Les fondamentaux
Matthias Rollot aborde dans le premier chapitre les questions de « qui pour vivre in situ » et « où devenir autre » . La vision « plurivers, biorégionale-décoloniale » qu’il formule a pour exigence une conscience à la fois écologique, éthique et politique, et nécessite des lieux où devenir autre pour « déconstruire avec d’autres nos modes de vie et nos systèmes de valeurs ». Dans le chapitre suivant, Marin Schaffner inscrit la vision biorégionale dans « l’horizon postcolonial d’une société pluriverselle ». Il ajoute aux concepts traditionnels du biorégionalisme la notion de féralité qui renvoie à « une situation dans laquelle une entité, soutenue et transformée par un projet d’infrastructure fabriqué par l’humain, adopte une trajectoire hors de tout contrôle humain [4]. » Si la féralité n’est en soi pas négative, elle a de toute évidence souvent mal tourné au point de remettre en question l’habitabilité plus qu’humaine de la Terre. D’où la nécessité de démanteler, en clair : « organiser la descente énergétique, la déprise infrastructurelle et le ralentissement massif. »
Alberto Magnaghi (1941-2023) rappelle dans sa contribution les termes de son « principe territorial » faisant de la biorégion urbaine [5] un outil permettant de « reterritorialiser la question écologique, développer l’autosuffisance du local, rouvrir les processus co-évolutifs. » L’enjeu central est de produire des modèles socioterritoriaux alternatifs favorisant une autonomie locale et de nouvelles formes de démocratie communautaire. Il ne s’agit pas seulement de prendre soin du territoire et des résurgences, il importe de répondre aussi à la crise de la démocratie par l’émergence de nouveaux dispositifs et pratiques politiques. L’auteur ne se contente pas de ruptures imaginaires, son approche peut se prévaloir de mises en œuvre dans différentes régions italiennes dont Anna Marson et Francesca Ulivi se font l’écho dans leur chapitre proposant de se défaire d’un modèle de la transition écologique par trop abstrait pour lui préférer une transition cohérente en adéquation avec les spécificités territoriales.
Sur le terrain
En ouverture de la seconde partie explorant les possibles de demain, Agnès Sinaï restitue l’essentiel d’une étude prospective centrée sur l’émergence à horizon 2050 de huit biorégions franciliennes. Les ressources du Grand Paris permettent d’envisager une organisation post-métropolitaine fondée sur « la sobriété, la décroissance, l’effacement des inégalités socio-spatiales et le dépassement de la césure société-nature. » Après l’enquête exploratoire susmentionnée centrée sur la reconnaissance du patrimoine territorial en Toscane, un collectif d’auteur.es restitue une démarche collective menant une analyse du bassin-versant de l’Aa (Haut-de-France) au moyen de la cartographie participative. Cette recherche-action pose le problème de la frontière d’une possible biorégion (jusqu’à quel sous-bassin versant doit-on remonter ? faut-il ou non s’arrêter au trait de côte et inclure la mer ?) et, d’une manière plus générale, de l’opérationnalité de la biorégion notamment quant à son design administratif. Comme on le font remarquer les auteur.es, l’atterrissage institutionnel de la pensée biorégionale n’est pas un long fleuve tranquille et pose la question des futurs biorégionaux abordés dans la dernière partie de l’ouvrage.
Futurs biorégionaux
Dans le cadre d’une approche paysagère de la santé, Camille Besombes mobilise la biorégion pour étudier les patterns éco-épidémiologiques spécifiques de différents écosystèmes ce qui l’amène à envisager des mesures de santé biorégionale, soit « de prévenir et soigner à partir des paysages et des pratiques et usages des lieux et des milieux, en inventant une médecine du territoire » et un réensauvagement en santé. Dans une telle perspective, la biorégion s’impose l’échelle pertinente pour des communs interspécifiques latents, pour un nouveau contrat social et naturel. La notion de paysage [6], centrale pour Camille Besombes, est aussi au cœur de l’essai de Clémence Mathieu qui l’envisage d’un point de vue biorégional. Un subtil assemblage mêlant notion de biorégion, projets de paysage et mises en fiction d’un territoire ouvre à d’autres modes de vivre et de faire, et invite à faire biorégion. Tel est l’enjeu du chapitre conclusif rédigé par la coopérative AMBRE qui sert à la fois de résumé, de manifeste et d’invite aux topophiles à s’engager pour que « la biorégion s’impose comme un projet qui saura opérer un changement de paradigme historique entre pratiques de l’époque moderne et pratiques d’avenir. »
Agnès Sinaï (sous la direction), Écologie des biorégions, avec les contributions de Camille Besombes, Bertrand Bocquet, la Coopérative AMBRE, Christelle Hinnewinkel, Éric Leclerc, Olivier Loubès, Alberto Magnaghi, Anna Marson, Clémence Mathieu, Mathias Rollot, Pierre-Gil Salvador, Marin Schaffner, Agnès Sinaï, Francesca Ulivi, « La fabrique des territoires », éditions Terre Urbaine, 2025, 220 pages, 20 euros.
Notes
[1] Colloque organisé à l’initiative de la revue Topophile, de l’Institut Momentum, du collectif Hydromondes et de la Counterculture History Coalition
[2] Thierry Paquot en explore les racines épistémologiques et les frondaisons politiques dans son texte : « L’espérance biorégionale », in Topophile, le 22 févier 2022 : https://topophile.net/savoir/lesperance-bioregionale/
[3] Lire Mathias Rollot et Marin Schaffner, Qu’est-ce qu’une biorégion ?, Marseille, Wildproject, 2024 [2021].
[4] Anna L. Tsing, Jennifer Deger, Alder Keleman Saxena et Feifei Zhou, Atlas féral. Histoires vraies et proliférantes des résistances aux infrastructures humaines, Marseille, Wildproject, 2025, p. 51.
[5] Signalons une nouvelle édition de son traité sur le territoire comme bien commun : Biorégion urbaine, Paris, Eterotopia France, 2026 avec une préface de Tiziana Villani et Anna Marson.
[6] Lire la nouvelle édition du livre de Thierry Paquot, Le Paysage, Paris, La Découverte, 2025 [2016].