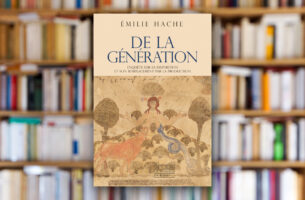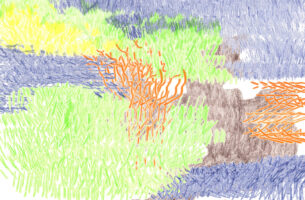Introduction
Ils sont partout, mais pourquoi ? Avec Géographie zombie, les ruines du capitalisme, le géographe et critique de cinéma, fondateur du blog Géographie et cinéma, Manouk Borzakian décortique ce que les morts-vivants peuvent bien dire de notre rapport aux autres et au monde.
À défaut d’une invasion réelle, les zombies ont depuis plusieurs années envahi nos écrans, nos livres et nos déguisements. C’est la figure imaginaire de ce début du XXIe siècle. Ou, pour le dire avec les mots de Manouk Borzakian:
« La métaphore zombie raconte notre monde et participe à le structurer. Par son cannibalisme, sa violence inexplicable et son pouvoir de contagion, la créature traduit des angoisses du moment. »
Mais que peuvent bien dire de nous ces mangeurs de chair humaine ni morts ni vivants ? À travers la riche étude d’un corpus cinématographique, allant des années 1930 aux dernières productions, Géographie zombie, les ruines du capitalisme, nouvel essai de Borzakian, propose quelques pistes de réponse.
L’auteur pose d’emblée un axiome : le zombie, c’est la figure de l’Autre. Exotique à ses débuts par sa filiation avec le vaudou haïtien, elle vire à la menace intérieure à partir des films de George Romero. Hordes consuméristes hantant les centres commerciaux (Zombie, George Romero, 1978) ou masses migratoires franchissant les murs les plus hauts (World War Z, Marc Foster, 2013), les zombies incarnent toujours un repoussoir. Dès lors, se pose la question de la relation sociale, mais surtout géographique qu’on souhaite entretenir à leur égard.
Les pages les plus intéressantes de l’ouvrage concernent en effet l’aménagement spatial du monde en temps d’épidémie zombie. Pour le géographe, face à la menace qui pèse sur un « ‘nous’ pur qu’il faut préserver de toute contamination », les humains survivants – souvent des blancs dans les productions états-uniennes – sont motivés par un « désir d’ici », qu’il soit localiste ou nationaliste, à savoir l’enracinement géographique, social et ethnique au sein d’un territoire. Et pour s’approprier ce dernier, quelle meilleure manière que d’y dresser des fortifications ? Celles-ci vont de l’appartement barricadé par des caddies de supermarché (28 jours plus tard, Danny Boyle, 2002) à une Pittsburgh post-apocalyptique, ceinte de murailles de bric et de broc (Le Territoire des morts, George Romero, 2005), en passant par la forteresse en miniature qu’est le Hummer que les héros de Bienvenue à Zombieland (Ruben Fleischer, 2009) érigent en machine de guerre.
Alors qu’en pleine mondialisation libérale, l’idée de frontière a perdu de sa consistance, elle retrouve dans les films de zombies une aura quasi-sacrée et s’incarne tout particulièrement dans les innombrables barricades et forteresses de fortune que montent ceux qui se vivent comme assiégés. Comme le dit Borzakian, « les personnages font de la géographie en actes : ils transforment leur environnement, […] conçoivent, fabriquent et renforcent des limites. C’est-à-dire qu’ils découpent l’espace, principale occupation géographique de l’humanité, et plus encore des sociétés occidentales, avides de frontières de toutes sortes. »
Ce faisant, les survivants – plus que les zombies – exemplifient à merveille le processus de privatisation, voire de militarisation, à l’œuvre dans bien des villes actuelles, afin de toujours mieux maintenir l’Autre à distance.
Mais si les humains désirent autant se fabriquer un chez eux, c’est surtout qu’ils n’en ont plus. À leur façon, les zombies matérialisent ce que l’auteur nomme le « reflux de la civilisation », c’est-à-dire « la disparition de l’espace public » des cités post-modernes, vides et épurées de toutes interactions sociales autres que celles strictement utilitaires à court-terme, à l’image de Fort Myers, station balnéaire de Floride désertée par ses habitants dans Le Jour des morts-vivants (George Romero, 1985). Les zombies d’aujourd’hui sont l’image vivante des angoisses métropolitaines : l’extérieur et son lot de rencontres inconnues, si ce n’est indésirables, est un espace qu’il faut fuir au plus vite. D’où le repli sur des lieux clos et fortifiés, qu’on estime parfaitement maîtrisés.
De ce point de vue, les westerns offrent un parfait contraste aux films de zombies. Alors que les premiers chantent la transformation – par la force et la colonisation – d’une étendue sauvage en un territoire peuplé et borné de symboles, les seconds désespèrent de la perte de sens du monde. Même les lieux qu’on croyait connus nous deviennent étrangers : dans Je suis une légende (Francis Lawrence, 2007), Robert Neville traque les troupeaux de cerfs dans les rues de New York, abandonnées par les hommes, avant de se faire damer le pion par une lionne échappée du zoo. Le territoire qu’on croyait posséder redevient une immense étendue sur laquelle les survivants n’ont aucune prise et dans laquelle ils refusent de s’aventurer.
Difficile pour les survivants d’envisager de « refaire monde » à partir des ruines de notre présent dans lesquelles ils se terrent désormais. Manouk Borzakian conclut :
« En somme, le ‘désir d’ici’ apporte une réponse à un déficit de lieux. Les films de zombies racontent la disparition en cours d’un espace auparavant organisé en lieux, c’est-à-dire en portions avec leurs significations propres ».
Reste à savoir s’il est possible de refaire société sans verser dans le chauvinisme et l’exclusion de l’Autre. Il existe bien quelques pistes du côté du cinéma indépendant, telles la fin douce-amère de The Last Girl : celle qui a tous les dons (Colm McCarthy, 2016) ou celle comique de Shaun of the Dead (Edgar Wright, 2004) qui mettent en scène des cohabitations compliquées entre humains et zombies, fruits d’un bricolage interpersonnel. Mais jusqu’ici, impossible d’en tirer un exemple de mode de vie alternatif généralisable à l’espèce humaine.
Manouk Borzakian, Géographie zombie, les ruines du capitalisme, Playlist Society, 2019, 128 pages, 14 euros.