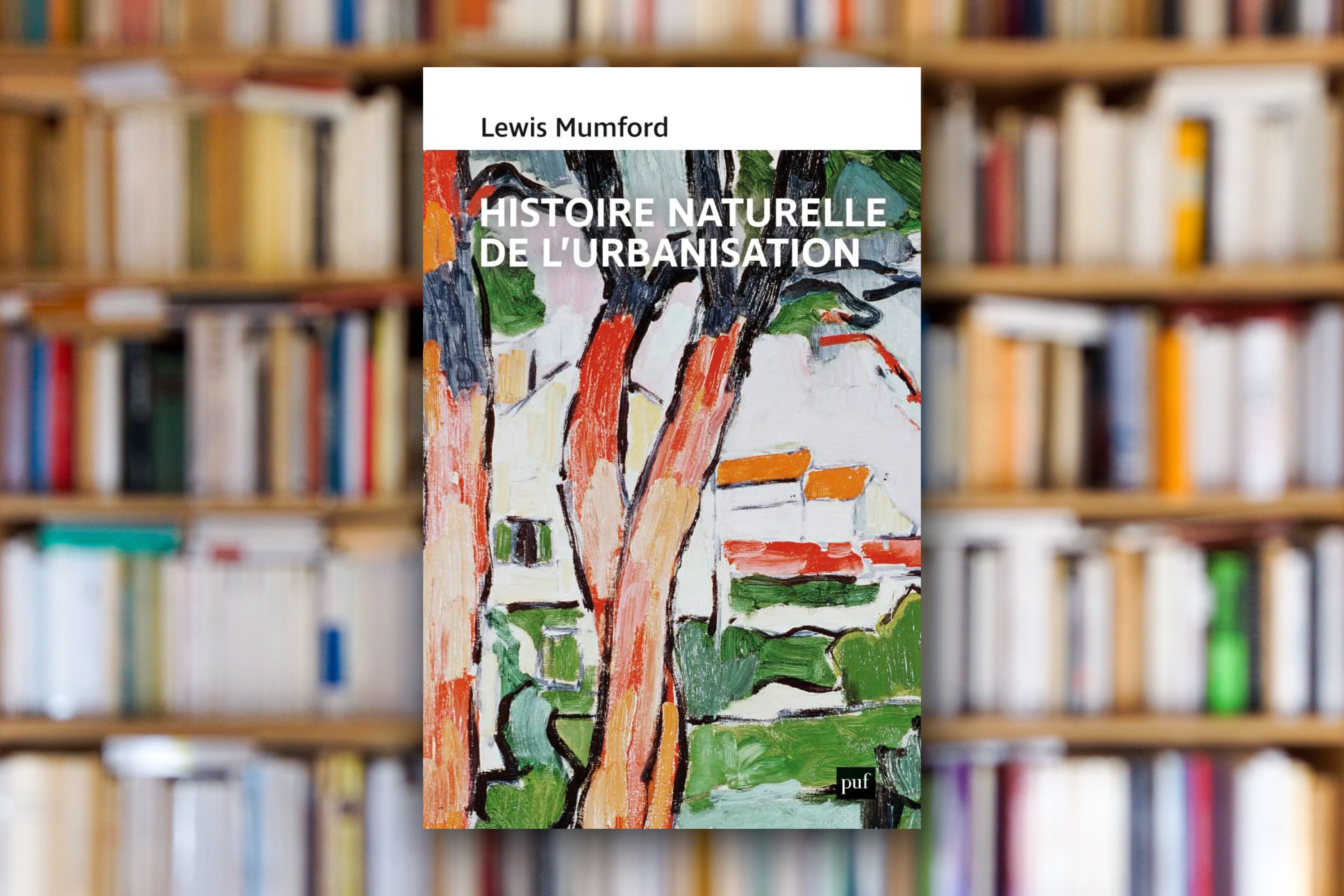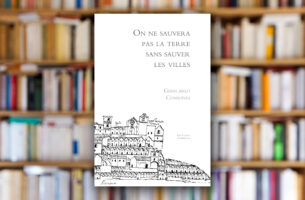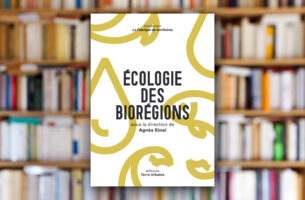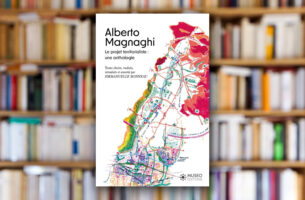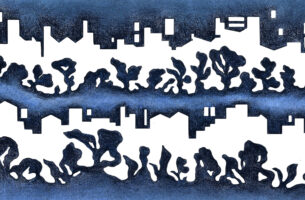Introduction
Villes et subsistance, l’histoire d’une dissociation
Dans cet essai panoramique et inédit daté de 1956, le grand historien des techniques et des villes, Lewis Mumford (1895-1990) retrace en moins d’une centaine de pages l’histoire de la ville au prisme de son emprise croissante sur la nature et les ressources.
C’est du point de vue de sa morphologie que Mumford décrit le phénomène urbain, qui, dans ses premières formes, est en relation symbiotique avec les terres alentour. Ruches et terriers sont des préfigurations pré-humaines du village et de la ville. Chez l’humain, l’habitude de s’abriter dans des cavernes remonte au Paléolithique, mais le village permanent apparaît au Néolithique. L’émergence de la ville à partir du village est rendue possible grâce à des améliorations apparues au Néolithique dans la culture des plantes et l’élevage du bétail, en particulier la culture des graines dures produites en abondance et conservées des années sans pourrir. Si ces premiers villages concentrent la population, ils ne causent pas de perturbations majeures dans l’environnement. Ils enrichissent même les sols et accroissent leur productivité naturelle, selon une économie circulaire avant la lettre. Ce sont des villes à blé, à seigle, à maïs.
Avatars de l’overshoot urbain
Ces premières villes demeurent fondamentalement des bourgs agricoles, limités par leur approvisionnement local en eau et en nourriture. La croissance urbaine, pendant des millénaires, est régulée par la production alimentaire, jusqu’à une époque somme toute récente. La croissance initiale de la population urbaine en Mésopotamie n’a pas grandement altéré les relations symbiotiques entre villages et terres. Champs et établissements humains sont en équilibre. Quatre millénaires plus tard, au XVIe siècle, la population moyenne d’une ville de l’Europe de l’Ouest était comprise entre 2000 et 20 000 personnes. Ce n’est qu’au XVIIe siècle que des villes de plus de 100 000 habitants ont commencé à se multiplier, à la faveur d’un approvisionnement alimentaire démultiplié par les cultures du Nouveau Monde.
Le deuxième âge de l’urbanisation est catalysé par l’apparition de routes carrossables pour les charrettes et par le transport fluvial et maritime, qui permettent à la ville de se fournir au-delà de ses frontières immédiates. La Rome antique en fournit un exemple, qui exproprie les territoires voisins des Etrusques, puis colonise les confins pour subvenir à la population croissante. Le cycle symbiotique s’interrompt : plus l’urbanisation est totale, plus le dépassement des limites naturelles est définitif. D’eopolis (ville-village), la cité devient metropolis. Pour autant, dans ce deuxième âge, la domination urbaine coexiste encore avec un cadre majoritairement agricole. Dans le premier comme dans le deuxième âge, l’économie repose sur une main d’œuvre dédiée à la culture de la terre.
Le troisième âge de l’urbanisation n’apparaît pas avant le XIXe siècle. A partir de ce moment-là, les quatre limites de l’overshoot contemporain sont franchies et posent le décor du nouvel espace-temps de l’Anthropocène dont Mumford a l’intuition : la limite nutritionnelle d’une échelle d’approvisionnement en eau et en nourriture ; la limite militaire de murs et fortifications protectrices ; la limite du transport actionné par des véhicules lents au rythme des barges et des canaux ; et la limite énergétique des moulins à eau et à vent et d’autres forces motrices comme les chevaux. Par ses usines, ses mines et ses locomotives, la ville se mécanise, y compris dans sa topographie nouvelle de conurbation, terme forgé par Patrick Geddes (1854-1932), biologiste et sociologue écossais qui inspire Mumford. La conurbation industrielle crée un environnement anti-organique et oblitère le vivant. Au point que la ville déborde vers ses banlieues, dans un mouvement de trop plein, caractéristique de l’overshoot contemporain.
La cité-jardin comme antidote
Dès lors, Mumford en appelle à restaurer un équilibre urbain-rural. Il invoque la cité-jardin d’Ebenezer Howard, qui, dans Garden Cities for Tomorrow (1902), propose de marier ville et campagne à l’échelle de collectivités relativement autonomes et équilibrées, épaulées par une industrie locale, sur un territoire dédié à l’agriculture. La ceinture agricole s’intègre pleinement à la ville et sert de tampon à l’étalement urbain, la cité-jardin se caractérise par une faible densité résidentielle. A rebours de la ville-machine, la cité-jardin se veut organique. Cette vision équilibrée inspire à l’urbaniste new-yorkais Clarence Stein, à Mumford et à d’autres l’idée d’une ville régionale démographiquement stable, en équilibre avec les ressources environnantes.
Visionnaire, ce texte préfigure la conscience globale du rôle de l’Homme dans la modification irréversible du visage de la Terre. Avec la bombe atomique, l’urbanisation du monde en est l’un des principaux ressorts. Le commentaire de Thierry Paquot qui l’accompagne met en lumière la portée de cet essai, contemporain de L’Obsolescence de l’Homme de Günther Anders, et sa poignante actualité. La traduction qu’en livre l’architecte Martin Paquot met cette parabole à la portée des lecteurs francophones, qui découvrent ici la pensée en forme de fresque de Mumford, encore méconnu en France.
Lewis Mumford (1956), Histoire naturelle de l’urbanisation, Introduction et commentaires par Thierry Paquot, traduction de l’anglais (Etats-Unis) par Martin Paquot, « Classiques de l’écologie », PUF, 2023, 128 pages, 9 euros.