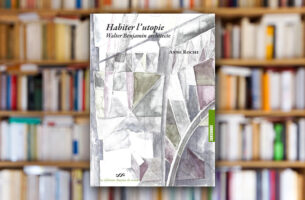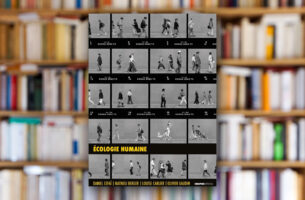Introduction
Les villes sont-elles saines ? L’urbanisme vise-t-il au bien-être des populations et organise-t-il les territoires urbanisés dans ce sens ? Les habitants sont-ils en meilleure santé en ville que dans les villages ? Aborder un tel sujet exige de bien le circonscrire afin d’élaborer une géohistoire se gardant de tout anachronisme puisqu’elle expose non pas un déroulé chronologique continu, itératif, progressif, reposant sur une explicitation a posteriori mais cherche à saisir une « climatique » propre à une période, en pointant les discontinuités, arrêts, sauts, retours en arrière, hybridations, qui la rythment. Toutes les sociétés ne se préoccupent pas pareillement de la santé de chacun, il convient donc d’entremêler plusieurs géohistoires, celle des regroupements humains, celle de la médecine, des médecins et des remèdes, celle des représentations de la maladie, celle des cinq sens et du corps, etc., en essayant d’établir une corrélation entre la typo-morphologie urbaine et les pathologies, la configuration de la ville et son habitabilité. La zoonose actuelle nous rappelle à quel point les humains appartiennent à la nature qu’ils environnent de leurs déploiements techniques bien souvent inconsidérés, au point de perturber profondément les équilibres écosystémiques. Elle nous montre également ce que nous ne savons pas. Enfin, elle confirme que la santé des humains est solidaire de la santé de la Terre et du monde vivant. Aussi, emploierai-je l’écologie comme méthode, au sens grec de hodos, la « voie », le « chemin du connaître ». Celle-ci entremêle le processus (avec la généalogie intranquille), la transversalité (avec la transedisciplinarité) et l’interrelationnalité (sans hiérarchie entre les éléments constitutifs d’un même ensemble qui rhizoment entre eux plus qu’ils ne dualisent...).
Hippocrate et ses disciples
Nous savons peu de chose de la vie d’Hippocrate, né à Cos vers 460 avant J.-C. et mort entre 375 et 351. Issu d’une lignée de médecins – je précise qu’il n’y a alors pas d’études de médecine et de diplôme, c’est la renommée qui vous conforte dans votre métier –, il part avec ses deux fils, également médecins, en Grèce du Nord, comme thérapeute itinérant. Il serait l’auteur d’une soixantaine de traités rédigés en ionien, vraisemblablement œuvre collective, constituant le corpus de la médecine hippocratique. Celle-ci repose sur le questionnement du patient, la compréhension de sa situation personnelle (sa vie de famille, son alimentation, son occupation...), l’étude de son milieu géographique et du climat qui y règne. La maladie est comprise comme un déséquilibre des quatre humeurs présentes dans le corps (le sang, le phlegme, les biles jaune et noire) qui ne sont plus en de « bonnes » proportions (aussi bien en excès qu’en manque), modifiant les qualités élémentaires (chaud, froid, humide, sec) qui interfèrent avec les quatre éléments (air, eau, terre et feu) et les saisons. Cette médecine « empirique », « raisonnée », ne considère pas la maladie comme la manifestation du mécontentement divin aussi ne prescrit-elle aucun rituel religieux ou magique pour la guérir. Elle méconnaît bien des domaines comme l’anatomie, la chirurgie, l’imagerie médicale, les sciences cognitives et surtout n’élabore pas une quelconque santé publique. Hippocrate dans son traité Des Airs, de l’eau et des Lieux écrit : « Les villes exposées au Levant sont naturellement plus salubres que celles qui sont tournées vers le nord ou vers le midi (...) Les habitants y ont le teint meilleur et plus fleuri ; ils ont un caractère plus vif, des sentiments et un esprit supérieurà ceux des gens exposés au Nord (...) Les maladies y sont moins nombreuses. » Oribase, à sa suite, constate que « les vents, quand rien ne les arrête, ne se font point sentir ; pourtant, ils ne sont pas sans action sur la ville : ils purifient le site, balayent les fumées, les poussières et les miasmes. » Quant à Platon et Aristote, ils s’accordent sur l’importance du site, aussi bien pour l’âme des habitants que pour leur approvisionnement et les conditions générales d’hygiène. Plus tard, le Romain Vitruve s’inquiétera également du choix de la localisation de la ville afin qu’elle soit salubre. Cet intérêt pour la qualité du lieu n’a pas empêché les épidémies, de peste en particulier, de décimer, à plusieurs reprises, les habitants des cités grecques ou de l’empire romain... Adrien-Louis-Joseph Carré dans sa thèse de médecine sur L’Hygiène et la santé dans la Rome Antique énumère les maladies connues (fièvres, dont la malaria ou paludisme, la peste, le choléra, la pneumonie, les oreillons, la tuberculose...), les thérapies préconisées (le grand air, le soleil, le lait, le vin, l’opium, le miel, le soufre, la diététique...), mais nulle trace d’une politique sanitaire à l’échelle d’une ville, par exemple. Ce qui n’empêchent pas les édiles d’être attentifs à la propreté des rues (pavage, réseau d’égouts, élargissement des voies, construction de places...), à la protection des parcs, à la qualité de l’eau (aqueducs, fontaines...), sans toutefois réussir à édifier une ville saine. Léon Homo écrit, à propos de Rome : « Mais si, pour l’ensemble de la ville, des résultats précis ont été obtenus – bien que l’entretien des rues ne semble jamais avoir, en pratique, atteint le niveau souhaitable –, la carence, en ce qui concerne la police sanitaire de l’habitation et l’hygiène de ses habitants, est à peu près complète : pas de mesures prises pour remédier à l’accumulation exagérée de la population, pas de mesures pour assurer aux habitants de la maison l’air et la lumière indispensables au bon état de l’organisme, pas de prophylaxie contre les épidémies collectives, pas de service médical public, ni d’hôpitaux avant le IVe siècle après J.-C. »
Le paradigme hippocratique revu et corrigé par Pline, puis Galien, va perdurer plusieurs siècles en Occident, bénéficiant d’heureux compléments apportés par la médecine arabe. Le mot « hygiène » est utilisé, certainement pour la première fois en français, par Ambroise Paré, au XVIe siècle, et vient du grec to hugieinon, « santé », neutre de l’adjectif hugieinos, « sain ». L’hygiène de vie maintient bien portant celui qui en respecte les principes, ceux-ci variant d’une période à une autre. Les villes n’ont jamais pu stopper les épidémies, au mieux elles construisaient des lazarets ou des maladreries pour isoler les voyageurs contaminés, durant quarante jours, comme à Venise, ou pour y héberger les lépreux. Comme le rappelle Ivan Illich dans H20. Les eaux de l’oubli, la découverte par Harvey de la double circulation du sang en 1628 se traduira, métaphoriquement, par la nécessité de faire circuler l’eau dans cet autre organisme qu’est la ville. La notion de « circulation » se généralise, la ville n’est plus considérée comme le lieu du stockage (des religieux dans une cité épiscopale, d’étudiants et de professeurs dans une ville universitaire, de militaires dans une ville de garnison, de marchandises dans un marché, je caricature quelque peu, etc.) mais celui de tous les flux (eau, plus tard gaz, électricité, pneumatiques, marchandises, rumeurs, capitaux, personnes, sexualité, etc.). Comme les microbes et les virus circulent aussi, il convient de les canaliser (confinement) et de les neutraliser (vaccin), cela demandera du temps…

Choléra, tuberculose et microbes
Le choléra de 1832 tue 18 602 personnes à Paris en six mois et environ 100 000 en France, aussi les pouvoirs publics vont essayer de comprendre le pourquoi de cette épidémie et promouvoir des actions prophylactiques. Il faudra le retour du choléra en 1849 pour que des décisions soient prises et la loi de salubrité publique votée en 1850, relative à l’assainissement des logements insalubres, sans vraiment prendre le taureau par les cornes. L’établissement, impulsé par le préfet Rambuteau, de trottoirs avec des caniveaux a permis l’évacuation des eaux qui stagnaient au milieu de la rue, la construction laborieuse du réseau de tout-à-l’égout à la fin du XIXe siècle, puis l’installation de cabinets d’aisance et de salles de bains dans chaque appartement – ce qui a réclamé plus de cinquante ans à Paris ! –, la généralisation des poubelles, tout cela améliore indéniablement l’état sanitaire de la ville, sans penser l’évolution des villes à l’aune de la santé. D’autant que la plupart de ces initiatives ont le hoquet, elles se font par à-coups, sans véritable conviction, avec des décideurs en désaccord et des représentants médicaux et scientifiques en guerre.
« À partir du mois de mai 1847, Semmelweis impose donc les premiers ‘gestes barrières’ de l’histoire de la médecine, écrit l’historien Pierre Darmon. Il interdit aux étudiants et aux médecins de quitter les salles de dissection sans s’être lavé les mains avec de la solution de chlore avant de se rendre au chevet des femmes au travail, de changer de tenue d’un service à l’autre, d’utiliser les instruments de dissection à d’autres fins. Aussitôt la mortalité s’effondre de 12,24 % à 3,04 %. Mais après avoir examiné une femme atteinte d’un cancer utérin, des étudiants ont pratiqué le toucher vaginal chez 11 femmes qui ont toutes décédées. » Par une simple observation de l’hygiène, à nos yeux, élémentaire, Semmelweis préconise des règles simples qui viennent à bout de la fièvre puerpérale, or ses collègues bloquent sa carrière et dénigrent ses travaux l’obligeant à quitter Vienne pour sa ville natale de Bude, en Hongrie. Là, il veille scrupuleusement à la propreté des lieux et du personnel, aussi sur 993 accouchées, 8 seulement décèdent. Un tel résultat ne lui ouvre aucune porte des Académies ou des Universités, l’aveuglément de ses pairs retarde de plus de vingt ans le recul de cette fièvre meurtrière…
Il en sera de même pour Louis Pasteur, chimiste, qui peine à convaincre les médecins de la justesse de ses expériences faites en laboratoire, ceux-ci continuent à croire en la « génération spontanée » et à récuser la dissémination aérienne des micro-organismes pathogènes, que l’on nommera « microbes » lorsque le mot entrera dans le vocabulaire médical, en 1878. L’anglais Tyndal publie en 1870, dans la Revue des cours scientifiques, « Poussières et maladies », où il explique que l’air est saturé de poussières organiques malsaines et préconise le port d’un « respirateur de coton » ou masque. Il s’indigne du manque d’hygiène dans les hôpitaux où rien n’est systématiquement nettoyé et où, selon Darmon, « l’érysipèle, les escarres, la gangrène, la pourriture d’hôpital et la septicémie opèrent des ravages plus considérables que la maladie elle-même. »
Joseph Lister s’évertue à lutter contre l’infection avec des « gestes barrières », comme des pulvérisations d’acide phénique, le fait d’isoler la plaie de l’air ambiant ou encore de conserver les instruments et la literie en une irréprochable propreté. Mais la force des habitudes et l’ignorance de la hiérarchie sont si puissants que Lister, tout comme Semmelweis avant lui, n’est guère suivi ou encore Ernest Duchesne, qui en 1897 découvre les vertus préventives du champignon, Penicillium glaucum, sans aboutir à un médicament. Alexander Fleming, à Londres, redécouvrira les mérites de ce champignon en 1928, se contentant de guérir des plaies superficielles. Il faudra attendre René Dubos, pour que les antibiotiques, en 1938, obtiennent leurs lettres de noblesse et surtout empêchent des morts en série…
La tuberculose frappe durement les quartiers populaires des agglomérations occidentales. C’est en 1882 que Robert Koch isole le bacille et fonde la bactériologie. Contre la tuberculose des mesures d’hygiène s’imposent : aérer les logements, les ouvrir à la lumière et au soleil, planter des arbres à proximité des habitations... L’on a mis longtemps à établir un lien entre certaines pathologies et certains animaux porteurs (le rat, la mouche...), il en fut de même pour accepter l’idée que l’homme lui-même pouvait être contaminant. La contagion buccale ne connait pas de limite et n’échappe pas au test de la numération microbienne : le timbre postal, le ticket de tramway, l’embouchure des instruments de musique, le mégot, le téléphone – qui vient de naître –, les reliques dans les églises comme le bénitier, la vaisselle des restaurants, les verres des cafetiers, etc. On le voit, plus un lieu est peuplé, plus la contamination s’active ! La machine à laver la vaisselle de la maison Steimetz à Cologne est en vente en 1904, elle évite de la tremper dans des bacs infestés de microbes et manipulée par des mains guère propres... Tout comme, en 1902, à Londres, Cecil Booth, invente le vacuum cleaner, un appareil aspirant les poussières, qui pullulent de microbes. Parquets, tapis, fauteuils, tentures, tapisseries, feront l’objet d’un nettoyage régulier par des aspirateurs de plus en plus efficaces, pour la grande satisfaction posthume de Jules Verne qui dans Les Cinq cents millions de la bégum publié en 1879 dénonçait « deux véritables nids à miasmes et laboratoires de poison (...) les tapis et les papiers peints » !
Des villes hygiéniques
En 1875, Benjamin Ward Richardson prononce un discours au congrès de la Social Science Association, à Brighton, qui deviendra un petit ouvrage, Hygeia. A City Health. Il décrit une ville-clinique où tout est conçu pour traiter les pollutions habituelles qui transmettent les microbes... Plan géométrique pour ventiler au mieux les voies de circulation, plantation d’arbres le long des boulevards, jardin autour de chaque bâtiment, asphalte sur le sol pour emprisonner les poussières, tramway souterrain, toits-terrasses jardinés, vide-ordures dans chaque cuisine pour évacuer les déchets organiques dans des poubelles installées dans le sous-sol, matériaux de construction imputrescibles, air « purifié et ozonisé ». Personne ne fume, ne boit d’alcool (il n’y a pas de bar), les rues sont silencieuses car les usines sont à l’extérieur de la ville. Chaque quartier possède un hôpital où chaque chambre est aseptisée dans des unités de soins à « taille humaine » dispersées dans un jardin. Des établissements accueillent les « impotents et les vieillards » et d’autres « les indigents », avec « respect et affection ». Les exercices corporels sont prescrits dès l’école élémentaire... Cette ville saine, et ô combien contrôlée, ne pourra pas éliminer toutes les maladies, le docteur Richardson en convient, mais supprimera la mortalité infantile et augmentera l’espérance de vie en bonne santé. Sa ville-clinique ressemble à un régime alimentaire strict qui oublie le plaisir gustatif, elle évoque davantage une caserne que l’abbaye de Thélème, imaginée par un autre médecin, le sieur Rabelais...
Déjà André Godin avec son « Familistère », à Guise, était soucieux des conditions d’hygiène des habitants, aussi avait-il installé des salles de bains et des toilettes à chaque étage tout comme un système de ventilation naturelle pour la cour centrale surmontée d’une verrière. Pourtant, en 1891, un rapport dénonce « la promiscuité des lieux d’aisance, leur situation dans les escaliers placés aux angles des bâtiments (...) causes d’insalubrité évidentes. » Le fabricant des célèbres poêles a dû se retourner dans sa tombe, lui qui avait veillé à l’habitabilité de son Familistère doté d’une piscine... Ebenezer Howard avec sa garden-city contribue dès 1898 non seulement à penser le couple « santé/ville » mais à réaliser une ville pour 30-35 000 habitants, dont 2 000 agriculteurs, avec des pâturages, des bois, des jardins, des maraîchers, vergers et potagers, pour une vie citadine à la campagne en quelque sorte. Dans les villes allemandes, puis françaises et suisses se développe au cours de la seconde partie du XIXe siècle, le « jardin ouvrier », dorénavant associé à l’abbé Lemire – maire d’Hazebrouck, qui votera en 1905 la séparation de l’Église et de l’État – qui fonde la Ligue Française du Coin de la Terre et du Foyer en 1896. Il s’agit de favoriser une activité de plein air qui éloigne l’ouvrier du cabaret et complète l’assiette familiale. La bonne santé en résulte... Mais là encore, pas de politique d’ensemble de santé publique à l’échelle urbaine.
Urbanisme et santé : quelles relations ?
C’est un médecin-hygiéniste, Robert-Henri Hazeman, militant communiste, qui ouvre en banlieue parisienne, à Vitry, puis à Ivry, avec le soutien des élus, un « bureau d’hygiène », véritable dispensaire, avec assistantes sociales, laboratoire d’analyses médicales et bactériologiques, école de plein-air, etc., qui prend en charge toutes les pathologies et joue un rôle préventif essentiel. Henri Sellier, introducteur de la cité-jardin en France, maire de Suresnes, co-fondateur de l’École des Hautes Études Urbaines en 1919, qui devient l’Institut Universitaire d’Urbanisme de Paris en 1924, le repère et l’associe à ses actions. Ainsi, on le retrouve secrétaire général de l’office public d’hygiène de la Seine, professeur à l’Institut d’urbanisme jusqu’en 1968 et membre du cabinet de Sellier, lorsque celui-ci est ministre de la santé sous le Front populaire. Partant à la retraite, il ne sera pas remplacé, comme si l’« hygiénisme », terme qui entre dans le dictionnaire au cours du XXe siècle, était déjà vieillot, dépassé ou comme si ce qu’il désignait n’avait plus cours, grâce aux traitements médicaux et à l’idéologie médicale triomphante.
Ainsi les antibiotiques, au lendemain de la seconde guerre mondiale, remplacent les baies vitrées, les espaces verts, les appartements traversants et rend la préoccupation hygiénique secondaire. Les villes s’affichent invincibles, alors même que d’autres maux les menaces sans que leurs habitants ne s’en inquiètent, le tabagisme, l’automobilisation généralisée de la planète, le travail sédentaire, etc. Comme l’écrit Pierre Darmon : « Après chaque guerre, on travaille à la façon de reconstruire un monde à l’abri de tout nouveau conflit. Après l’épreuve de la Covid-19, il faudra songer au coronavirus du chameau ou au virus variolique qui attendent peut-être leur heure à l’ombre du réservoir animal. Et surtout il faudra songer à la restauration de notre environnement naturel. C’est ici que le problème de la pollution industrielle rejoint celui de la pollution microbienne. On ne peut plus lutter contre l’une sans lutter contre l’autre. Le saccage de la planète et le mépris de la biodiversité font de l’homme une cible unique et privilégiée. » Cible ? Mais aussi, ô combien, responsable de ces désastres annoncés...
Maximilien Sorre, auteur d’une somme intitulée Les Fondements de la géographie humaine en trois tomes publiés entre 1943 et 1952, s’attarde sur la santé, le climat, l’eau, l’air, l’alimentation, etc., mais paraît bien seul parmi les géographes. Son approche écologique de la géographie reste isolée, aussi ses observations sur les conditions de diffusion des pandémies et de leur traitement, par exemple, sont ignorées. Henri Laborit, médecin et biologiste, est sollicité par le tout jeune département d’urbanisme de l’université expérimentale de Vincennes, en juin 1968, pour venir parler de « biologie et urbanisme ». L’Homme et la ville qu’il publie en 1971 rend compte de son enseignement sur trois ans. Il combine subtilement la cybernétique, la biologie et l’écologie pour mieux analyser la ville, entendue comme « niche environnementale ». À le relire récemment, je suis admiratif de l’acuité de ses remarques. Même si nos connaissances en biologie et en écologie se sont considérablement enrichies et si l’univers de la cybernétique s’est profondément transformé avec l’ordinateur portable et le numérique, remplaçant la machine à cartes perforées, et le déploiement des « Nouvelles Technologies de l’Information et de la Communication », le gros de sa réflexion tient la route. La ville, pour lui, n’est pas un organisme, mais « représente un des moyens utilisés par un organisme social pour contrôler et reproduire sa structure. » La ville ne sert qu’à des groupes humains dominants à le rester. Pour expliciter ce constat, Henri Laborit expose l’étude biologique des comportements et donc la structuration du cerveau, celle du système nerveux central avec le cortex, le néocortex et l’hypothalamus, pour simplifier. Il explique que l’urbanisation provoque le confinement – c’est le mot qu’il emploie –, qui assure à chacun son alimentation sans qu’il aille la chercher en chassant, par exemple. Du coup, son agressivité est détournée en d’autres tensions envers d’autres citadins, le fonctionnement de l’hypothalamus, ou cerveau reptilien, siège du comportement instinctif chargé de l’approvisionnement, n’ayant plus cette fonction. Il n’aborde pas la question des pathologies dans un lieu dense, la ville, mais s’attarde sur l’étude des comportements humains et de leurs conditionnements et autres automatismes sociaux. Pour lui, les informations que les habitants d’une ville produisent en interagissant sont utilisées par ceux qui les captent et manipulent afin de maintenir en place la structure existante. Qu’aurait-il dit des data et de la smart city si ce n’est qu’elles représentent ce qu’il craignait, à savoir Le Meilleur des mondes possibles qui conduit à une servitude volontaire envers les données ! Il écrit : « toute information porteuse de structures nouvelles ne pourra pas, si sa force déstructurante est évidente, bénéficier des multiples canaux par lesquels se diffusent aujourd’hui les ‘nouvelles’ ». Il pointe là une autre maladie, la pathologie informationnelle addictive... Ce qui m’étonne le plus, en le relisant, c’est qu’il explique que la combustion des sources d’énergies fossiles (charbon et pétrole) accroît la concentration de CO2 dans l’atmosphère, ce qui à terme « va altérer le climat global de la planète au cours même du XXIe siècle » et qu’il convient de s’en préoccuper, car les conséquences de ce dérèglement climatique sur le milieu urbain seront inédites et critiques. Cinquante ans plus tard nous y sommes.
Alexander Mitscherlich, médecin, directeur de l’Institut Sigmund Freud de Francfort, est sollicité par la municipalité de Heidelberg, en 1968, pour l’aider à imaginer un nouveau quartier. Il est vrai qu’il a publié en 1965, Psychanalyse et urbanisme, dans lequel il s’insurge sur l’appauvrissement architectural et urbanistique de la reconstruction allemande, obnubilée par la spéculation. Il regrette que le sol ne soit pas la propriété des villes, laissant aux habitants celle de leur logement. Il observe un repli sur soi d’un côté et une massification de l’autre qui brident la socialisation de chacun et accroît son inadaptation à la vie sociale. D’où, note-t-il un état névrotique grandissant chez les « urbanisés ». Il regrette que les enfants ne soient pas davantage pris en considération, éloignés des traces de nature, enfermés dans des logements exigus qui donnent sur un décor monotone aux imprévus communicationnels de plus en plus rares... Il constate que la forme de la ville fonctionnelle, ses matériaux et ses couleurs, expriment parfaitement l’ordre social et économique, et s’en inquiète, car elle semble générer une infantilisation des habitants dans un cadre inhospitalier. La recension de son livre dans le quotidien Combat, lors de sa parution en français en 1970 est titrée : « le virus urbain », no comment...
De l’écologie sociale à l’écologie existentielle
Murray Bookchin signe, en 1962, sous le pseudonyme de Lewis Herber, Notre environnement synthétique, vaste enquête remarquablement documentée sur les maladies spécifiques à l’environnement. Son approche écologique de la santé est alors unique et, de fait, s’attaque à la fois à un mode de vie dicté par la consommation de produits finalement nocifs à la bonne santé et aux dérèglements environnementaux provoqués par les activités humaines productivistes. Ainsi l’agriculture intensive abusant de pesticides et d’insecticides altère profondément la qualité du sol et les divers écosystèmes, au point même de les saccager. Les biens alimentaires ainsi cultivés sont ensuite manipulés chimiquement pour être commercialisés ; plus de 3 000 produits chimiques, remarque-t-il, entrent dans la préparation des aliments conditionnés industriellement, dont les effets biochimiques sur les organismes humains ne sont pas toujours connus. Il consacre un chapitre à « Vie urbaine et santé » et mobilise de nombreux rapports officiels pour décrire les principales pathologies générées par la concentration d’habitants en un même lieu : stress, cancers, coronopathies, maladies respiratoires dont l’emphysème, mal-être, etc. Il conclut : « Peu de médicaments sont aussi efficaces qu’une résistance biologique aux maladies. Aucun système technique n’est susceptible de libérer l’homme de sa dépendance de la terre, des plantes, des animaux. Les deux sphères, la naturelle et la synthétique, doivent nouer des relations complémentaires reposant sur une claire compréhension des besoins de l’homme comme organisme humain et des effets de son comportement sur le monde naturel. Une étude de l’interaction entre l’homme et la nature peut être appelée écologie humaine. »
Voilà, hâtivement brossé, le tableau des liens entre « ville et santé », individuelle et collective. La conclusion s’impose : les villes se sont constituées sans jamais rechercher la bonne santé de leurs habitants. Celle-ci a toujours été considérée comme une affaire personnelle ou familiale. La « société » n’a pas à intervenir, sauf pour, comme actuellement, tenter de freiner une pandémie. Dorénavant, la santé devient une préoccupation des architectes, urbanistes, paysagistes, designers, élu-e-s, citoyen-ne-s. Que peuvent-ils faire ? Écologiser leur esprit et expérimenter, à toutes les échelles, et dans tous les domaines en même temps (les matériaux, les plantations, la volumétrie, les architectures, le ménagement des lieux, la place des enfants, la chronotopie, les mobilités, l’agriculture bio et raisonnée, les forêts urbaines, etc.), car tout est lié, ce qui relèverait d’une écologie existentielle, cette articulation des temporalités et des territorialités, du vivant, dont les humains.
Que nous disent la « philosophie de la santé » et la « philosophie de l’urbain », qui pourraient s’associer dorénavant en une écosophie ? La santé est trop souvent limitée à la médecine, du reste les médecins qui publient, souvent en direction du grand public, ne la définissent que rarement, comme si cela allait de soi et que leur pratique l’enveloppait. L’Organisation Mondiale de la Santé se doit d’en proposer une définition : « la santé est un état de complet bien-être physique, mental et social, et ne consiste pas seulement en une absence de maladie ou d’infirmité. » On voit alors que la santé ne peut se limiter à la maladie, son diagnostic et son traitement, elle est politique et réclame une décision locale, nationale ou internationale. Je pense que la compréhension de la santé englobe l’étude des systèmes nosologiques et étiologiques des sociétés humaines, de leurs représentations et de leurs symbolisations. La philosophie de la santé, à la suite de Georges Canguilhem, qui distingue le « normal » du « pathologique », s’interroge sur ce que la société apprécie comme un au-delà de la maladie qui assurerait à chacune et chacun une bonne santé. La philosophie de l’urbain, quant à elle, privilégie le « ménagement », du verbe « ménager » qui signifie « prendre soin ». « Prendre soin » de quoi ? Des gens, des lieux, des choses et du vivant. En cela la philosophie de l’urbain ne se limite pas à l’« urbanisme », cette manière occidentale et masculine de fabriquer la ville productiviste, mais à la construction des territoires les plus habitables possibles, sachant qu’habiter revient à « être-présent-au-monde-et-à-autrui »....
Texte issu d’une conférence prononcée le 27 janvier 2021 à l’institut Palladio.
Lectures
Bookchin Murray (1962), Notre environnement synthétique. La naissance de l’écologie politique, traduction et préface de Denis Bayon, Lyon, Atelier de création libertaire, 2017.
Bourdelais Patrice (1987), Une Peur bleue. Histoire du choléra en France, 1832-1854 (Médecine et sociétés), Paris, Payot.
Carré Adrien-Louis-Joseph (1932), L’Hygiène et la Santé dans la Rome Antique, Bordeaux, Imprimerie-Librairie de l’Université
Corbin Alain (1982), Le miasme et la jonquille. L’odorat et l’imaginaire social, XVIII-XIXe siècles, Paris, Aubier-Montaigne.
Darmon Pierre (2020), Défense de cracher ! Pollution, environnement et santé à la Belle Époque, Paris, Le Pommier.
Delumeau Jean, Lequin Yves (dir) (1987), Les Malheurs des temps. Histoire des fléaux et des calamités en France, Paris, Larousse.
Frioux Stéphane (2013), Les Batailles de l’hygiène. Villes et environnement de Pasteur aux Trente Glorieuses, Paris, PUF.
Grellet Isabelle, Kruse Caroline (1983), Histoires de la tuberculose. Les fièvres de l’âme, Paris, Ramsay.
Guerrand Roger-Henri (2001), Hygiène, Paris, Éditions de la Villette.
Homo Léon (1951), Rome impériale et l’urbanisme dans l’Antiquité, Paris, Albin Michel.
Illich Ivan (1985), H2O, les eaux de l’oubli, traduit de l’anglais par Maud Sissung, Paris, Lieu Commun, nouvelle édition, préface de Thierry Paquot, Saint-Mandé, éditions Terre Urbaine, 2020.
Jorland Gérard (2010), Une Société à soigner. Hygiène et salubrité publiques en France au XIXe siècle, Paris, Gallimard.
Laborit Henri, L’Homme et la ville, Paris, Flammarion, 1971.
Martin Roland (1956), L’Urbanisme dans la Grèce antique, Paris, Picard.
Mitscherlich Alexander (1965), Psychanalyse et urbanisme. Réponses aux planificateurs, traduit de l’allemand par Maurice Jacob, Paris, Gallimard, 1970.
Murard Lion, Zylberman Patrick (1996), L’Hygiène dans la république. La santé publique en France ou l’utopie contrariée 1870-1918, Paris, Fayard.
Paquot Thierry (2019), Désastres urbains. Les villes meurent aussi, Paris, La Découverte.
Paquot Thierry (2020), Mesure et démesure des villes, Paris, CNRS-éditions.
Paquot Thierry (dir) (2021), Écologie des territoires, Saint-Mandé, éditions Terre Urbaine.
Quetel Claude (1981), Le Mal de Naples. Histoire de la syphilis, Paris, Seghers.
Ragon Michel (1986), Histoire de l’architecture et de l’urbanisme modernes, tome 3, Paris, Casterman, réédition et actualisation, collection « Points », Paris, Seuil, 1991.
Richardson Benjamin Ward (1875), Hygeia. Une Cité de la santé, Préface de Michelle Perrot, présentation et traduction de Frédérique Lab, Paris, Éditions de la Villette, 2006.