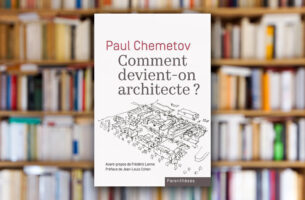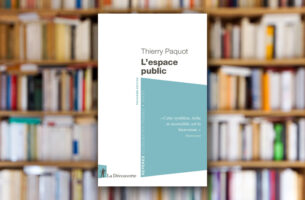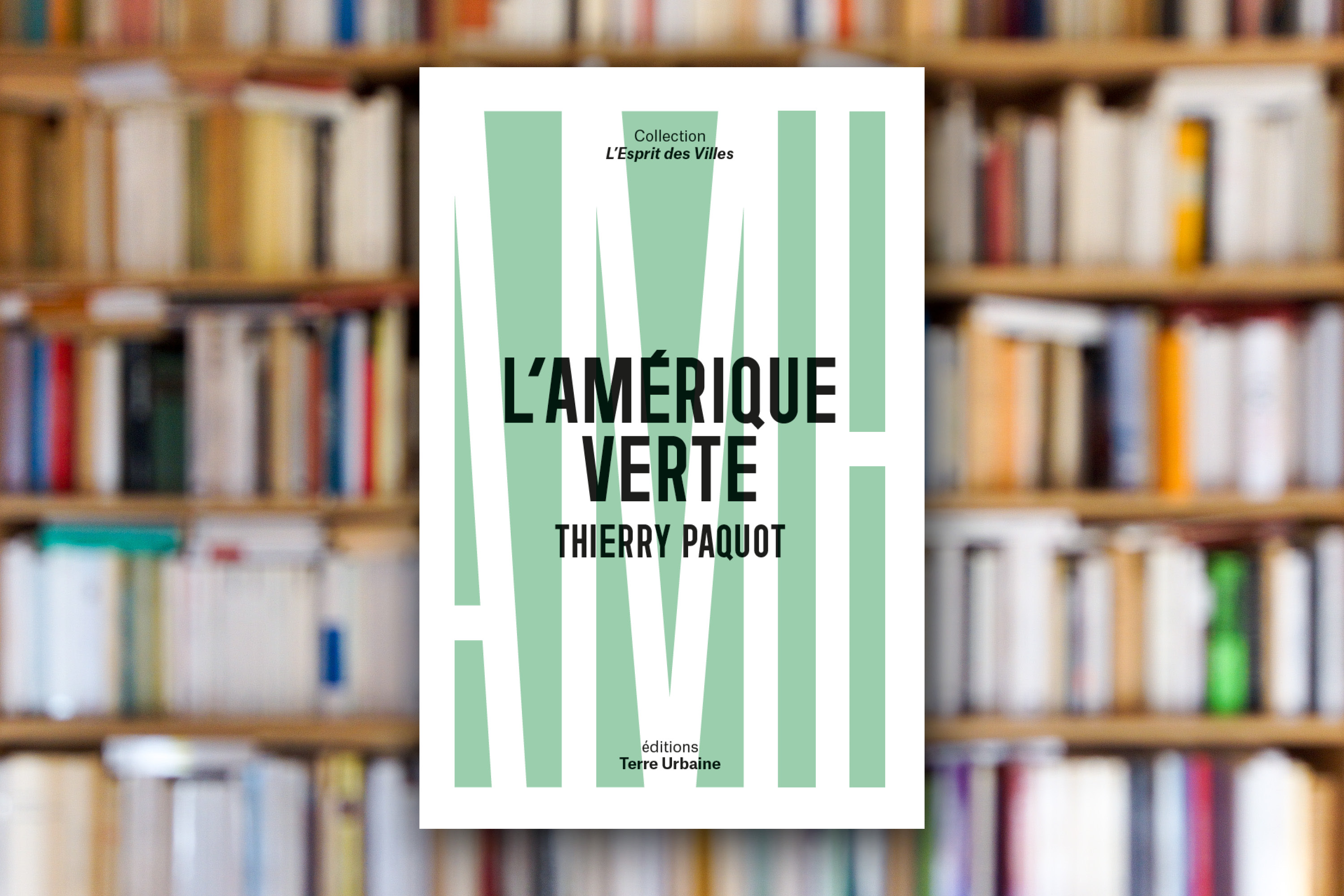
Introduction
Sur le long sentier salubre des pionniers
Je fis connaissance avec l’écologie, à mon insu, dans un livre pour la jeunesse, L’Éclaireur du Yellowstone (Yellowstone Scout) de W. M. Rush, dont je découvre aujourd’hui qu’avant de publier ce récit, il avait enquêté sur les élans menacés par le froid dans ce parc national. Bien des années après, c’est dans un autre parc national des États-Unis, celui des Arches (Utah), que je me suis promené mentalement en traduisant Desert solitaire d’Edward Abbey.
Je ne me doutais pas, mais j’apprends de Thierry Paquot que parmi les premiers écologistes américains (s’il est permis d’anticiper en leur collant cette étiquette) il faut distinguer les préservationnistes, qui voulaient « protéger des territoires de toute activité humaine » – d’où les parcs nationaux – et les conservationnistes, qui acceptaient « d’exploiter les ressources naturelles, mais sans les épuiser ». Mais, nous prévient Thierry Paquot, la réalité du mouvement écologiste aux États-Unis est bien plus complexe que cette distinction ne le fait supposer, et c’est en quoi la savante clarté de son ouvrage se révèle des plus précieuses.
J’avais ma petite idée de Ralph W. Emerson (la nature est bonne, la société exerce sur les individus des effets corrupteurs), de Henry D. Thoreau, l’auteur de l’inoubliable Walden ou la Vie dans les bois, qui influença George Eliot, et de Lewis Mumford, prédécesseur de Jean Giono dans le sillage de Melville, mais ils demeuraient pour moi des isolés, et des écrivains plus que des pionniers.
Thierry Paquot met de l’ordre dans nos connaissances émiettées tout en nous éclairant sur la diversité des tempéraments, des initiatives et des filiations. L’aphorisme du René Char des Feuillets d’Hypnos : « Notre héritage n’est précédé d’aucun testament », avertit le lecteur de L’Amérique verte qu’il ne pourra s’abandonner à aucun « courant en -isme » de lointaine paternité et en sera récompensé par un fourmillement des plus prometteurs. Couvrant près d’un siècle et demi de ses « portraits d’amoureux de la nature », l’auteur nous entraîne sur leurs traces successives, parfois enchevêtrées, avec une précision doublée d’humour – un humour qui l’amène à observer : « les nuages radioactifs des catastrophes nucléaires ne contournent pas les parcs naturels par courtoisie ».
Voici, pour nous mettre en appétit, un fameux trio : Emerson, l’étonnante Margaret Fuller et Thoreau. Puis cinq enthousiastes de l’appel de la forêt, parmi lesquels John Muir, qui oppose nature sacrée et nature profane ; John Burroughs, admirateur de Whitman, mais aussi des toiles de petites araignées « saturées d’humidité » ; et Gifford Pinchot, brouillé avec Muir à propos des dégâts que les moutons sont susceptibles de causer dans les forêts (cette partie de l’ouvrage contient deux pages fort utiles à qui se gratte la tête pour traduire wilderness). Vient le tour de « l’oncle d’Écosse », Patrick Geddes, apôtre d’une énergie non-polluante qui faciliterait l’avènement de l’eutopie, « versant ensoleillé de l’utopie », et dont l’influence s’exerce jusque dans l’Inde de Tagore, de Gandhi et de Radhakamal Mukerjee, « théoricien indien de l’écologie régionale », qui souhaitait rompre les barrières entre sciences physiques et humaines. Geddes bénéficie d’un chapitre à lui tout seul. Avec « La Santé de la Terre », le livre s’achève en beauté sur un quatuor : George Perkins Marsh reprochant à l’homme d’avoir abattu les forêts « dont l’enchevêtrement de racines fibreuses reliait l’humus au squelette rocheux de la terre » (il est moins judicieux quand il conseille, pour les zones désertiques des États-Unis, de pourvoir les soldats de dromadaires) ; Aldo Leopold, à qui, en octobre, les pins parlent des cerfs et qui, en juin, voit des « dividendes de rosée suspendus à chaque lupin »; Benton MacKaye, concepteur du sentier de randonnée pédestre des Appalaches, long de plus de trois mille kilomètres ; Lewis Mumford enfin, avocat d’une « communauté » qui soit « l’assemblage organique d’une histoire, d’un paysage, d’une économie, d’une esthétique, d’une écologie » (ceux qui ne jurent que par leur langue régionale feraient bien de lui prêter attention), avocat aussi d’une « décroissance choisie ». Vers lui, Thierry Paquot voit converger tous les amoureux de la nature qu’il a réunis dans son livre.
Il est réjouissant de constater que la plupart de ces naturalistes sont des marcheurs, qu’ils se servent de leurs mains, que l’écriture ne les détourne pas de l’effort physique et qu’ils semblent tous estimer, comme Emerson, que « la vie est notre dictionnaire ».
Leur combat continue, affirme en conclusion Thierry Paquot. Il est si bien placé pour le savoir que cet autre aphorisme des Feuillets d’Hypnos ne sera pas déplacé : « On ne se bat bien que pour les causes qu’on modèle soi-même et avec lesquelles on se brûle en s’identifiant. »
Thierry Paquot, L’Amérique verte. Portraits d’amoureux de la nature, « L’esprit des villes », Terre Urbaine, 2020, 244 pages, 20 euros.