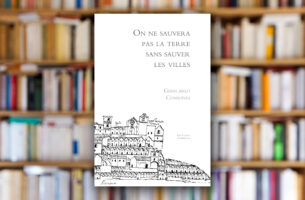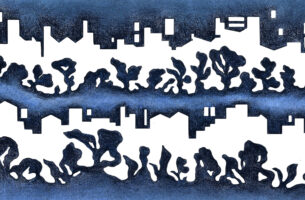Introduction
1895, le génial savant géographe anarchiste Elisée Reclus publie en anglais un des premiers textes sur la géographie des villes. Celui-ci ne sera tiré de l’oubli et traduit par Jean-Claude Chamboredon et Annie Méjean qu’en 1988. Pourtant, Élisée Reclus, en avance sur son temps, y compare les villes à des organismes vivants. Il nous raconte leur naissance et essor dans leurs dimensions tant écologiques que sociales. Une ville « ne saurait être séparée des conditions de temps et de lieu qui lui ont donné naissance. Toute ville a sa vie propre, ses traits propres, sa forme propre, de sorte que le constructeur ne devrait l'approcher qu'avec beaucoup de vénération. » Prenons conscience de l’individualité des villes. Par ailleurs, il annonce déjà l’urbanisation des mœurs « alors que l'homme de la campagne devient de jour en jour un citadin dans son mode de vie et de penser » et espère l’apparition d’une nouvelle relation fusionnelle entre les villes et les campagnes.
À mesure que le domaine de la civilisation s'étend et que les attractions qui s'exercent ainsi se font sentir sur un plus large espace, les villes, devenues parties d'un organisme plus grand, peuvent ajouter, aux avantages spécifiques qui leur ont donné naissance, des avantages de nature plus générale qui peuvent leur assurer un rôle historique de première importance. Ainsi, Rome, qui occupait déjà une position centrale par rapport aux terres comprises dans l'hémicycle des montagnes volcaniques latines, se trouva ensuite le centre de l'ovale formé par les Apennins. Et, plus tard, après la conquête de l'Italie, son territoire fut le point central de toute la péninsule bordée par les Alpes, et marqua presque exactement la position médiane entre les deux extrémités de la Méditerranée, l'embouchure du Nil et le détroit de Gibraltar. Paris, encore une fois, si bien situé près d'un triple confluent, au centre d'un bassin fluvial aussi nettement délimité qu'une île et à peu près au milieu d'une série concentrique de formations géologiques qui contiennent chacune leurs productions particulières, a aussi le grand avantage d'être situé à la rencontre de deux voies historiques, la route de l'Espagne par Bayonne et Bordeaux, et celle de l'Italie par Lyon, Marseille et la Riviera. En même temps, il incarne et individualise toutes les forces de la France en relation avec ses voisins occidentaux, l'Angleterre, les Pays-Bas, l'Allemagne du Nord. Simple lieu de pêche à l'origine, compris entre deux bras étroits de la Seine, ses ressources étaient limitées à ses filets, à ses bateaux, à sa plaine fertile qui s'étendait du Mont des Martyrs à la montagne Sainte Geneviève. Et la vallée convergente de l'Oise ajouta son trafic au reste. Les formations géologiques concentriques développées autour de l'ancien fond marin donnèrent progressivement une importance économique à leur centre naturel, cependant qu'il devenait un point central pour les échanges empruntant la voie historique entre la Méditerranée et l'Océan.
Est-il nécessaire d'insister sur l’avantage géographique de Londres, comme tête de pont de la navigation maritime de la Tamise ? N'a-t-elle pas en plus, le privilège d'être, de toutes les villes du monde, la plus centrale, l'une des plus facilement accessibles, en somme, de toutes les parties du globe ?
Dans son intéressant ouvrage sur la position géographique des capitales de l’Europe, J.-G. Kohl montre comment Berlin, qui fut longtemps un simple village, sans autre mérite que celui de fournir aux indigènes un passage commode entre les marais et un solide point d'appui sur un îlot de la Sprée, se trouva, dans le processus de développement historique du pays, sur une voie d'eau formée par une série de lacs et de canaux, à mi-chemin entre l'Oder et l'Elbe, en un point où les grandes routes traversant le pays en diagonale se rencontrent et se croisent, celle de Leipzig à Stettin [Szczecin, N.D.E.] et celle de Breslau [Wrocław, N.D.E.] à Hambourg. Dans les premiers temps, l’Oder ne coupait pas brusquement vers le Nord à emplacement actuel de Francfort sur l’Oder pour se jeter dans la Baltique, mais continuait sa course en direction du Nord-Ouest pour se jeter dans la mer du Nord. L’immense fleuve, long de plus de huit cents kilomètres, passait à l'endroit même qu'occupe aujourd'hui Berlin, situé presque au milieu de son ancienne vallée. La Sprée, avec ses étangs et ses marais, n'est que le vestige de cet important cours d'eau. La capitale allemande, contrôlant ainsi le cours des deux rivières, commande aussi aux deux mers, de Memel [le Niémen, N.D.E.] à Emden. Et c'est cette position, bien plus qu'aucune centralisation artificielle, qui lui donne son pouvoir d'attraction. Du reste, comme toutes les grandes villes du monde moderne, Berlin a décuplé ses avantages naturels avec des lignes de chemin de fer convergentes qui attirent le trafic des marchandises de son propre pays et des autres pays vers ses marchés et ses entrepôts.
Il reste que le développement d'une capitale est, en grande partie, artificiel. Les faveurs administratives qui lui sont accordées, l'affluence de courtiers, fonctionnaires, politiciens, soldats et toute la foule intéressée qui se presse autour d'eux, lui donnent un caractère trop particulier pour qu'on puisse accepter de l'étudier comme représentative d'un type. Il est plus sûr de raisonner à partir de l'existence de villes qui doivent leurs mouvements à des conditions purement géographiques et historiques. Il n'y a pas d'étude plus fructueuse pour l'historien que celle d'une ville dont les annales, en même temps que le cadre physique, lui permettent de vérifier sur le terrain les changements historiques sous lesquels on peut toujours observer un rythme régulier.
C'est alors comme si la scène se déroulait sous nos yeux : les huttes de pêcheurs, les cabanes de jardiniers tout près, puis quelques fermes éparpillées dans la campagne, une roue de moulin qui tourne dans le courant, plus tard, une tour de guet accrochée au flanc de la colline. De l'autre côté de la rivière, là où la proue du bateau frôle la berge, quelqu'un construit une nouvelle hutte ; une auberge, une petite boutique près de la maison du batelier invitent le passager et l'acheteur. Puis, s'élève le terre-plein du marché, bien visible au milieu du reste. Un sentier de plus en plus large, battu par le pas des hommes et des bêtes, descend de la place du marché à la rivière. Un chemin sinueux commence à gravir la colline, les routes futures se dessinent dans l'herbe piétinée des champs et les maisons s'installent sur les tertres verdoyants à la croisée des chemins. Le petit oratoire devient une église, l'échafaudage en plein vent de la tour de guet fait place au fortin, à la caserne, ou au castel. Le village se développe et se transforme en bourg, et le bourg en ville. La bonne manière de visiter une de ces agglomérations urbaines qui ont une longue histoire est de l'examiner dans l'ordre de sa croissance, en commençant par le site — généralement consacré à quelque légende — qui lui a servi de berceau, pour terminer avec les derniers progrès observables dans ses usines et magasins. Chaque ville a son caractère particulier, sa vie personnelle, son aspect physique propre. L'une est gaie et animée, l'autre entretient une mélancolie qui gagne le visiteur. Chaque génération laisse ce caractère à la suivante comme un héritage. Il y a des villes qui vous glacent dès l'entrée tant leur aspect est dur et hostile. Il y en a d'autres où vous êtes gai et léger comme à la vue d'un ami.
« Chaque ville a son caractère particulier, sa vie personnelle, son aspect physique propre. L'une est gaie et animée, l'autre entretient une mélancolie qui gagne le visiteur. Chaque génération laisse ce caractère à la suivante comme un héritage. Il y a des villes qui vous glacent dès l'entrée tant leur aspect est dur et hostile. Il y en a d'autres où vous êtes gai et léger comme à la vue d'un ami. »
D'autres contrastes se rencontrent dans les modes de croissance des différentes villes. Suivant le sens et l'importance de son commerce extérieur, la ville projette ses faubourgs comme des tentacules le long des routes extérieures. Si elle est située près d'une rivière, elle s'étend sur la berge à proximité des lieux de mouillage et d'embarquement. On est souvent frappé par la nette inégalité des deux parties d'une ville de part et d'autre d'une rivière, alors qu'elles semblent également bien situées pour attirer la population : la cause doit en être cherchée dans la direction du courant. Ainsi, le plan de Bordeaux suggère d'abord que le véritable centre habité aurait dû être le côté droit de la rivière, à la place occupée par le petit faubourg de La Bastide. Mais ici la Garonne décrit une grande courbe et c'est le long des quais de la rive gauche que son cours est le plus rapide ; or le flux du commerce va nécessairement où le courant du fleuve coule avec le plus de force. La population s'établit près de la partie du cours la plus profonde en évitant les berges envasées du rivage opposé.
On a souvent suggéré que les villes ont une tendance constante à se développer en direction de l'Ouest. Le fait — qui est vrai en bien des cas — est aisément explicable, s'agissant des régions de l'Europe de l'Ouest et d'autres de climat similaire, puisque l'Ouest est le côté directement exposé aux vents les plus sains. Les habitants de ces quartiers ont moins à craindre la maladie que ceux qui sont à l'autre bout de la ville, où le vent arrive chargé d'impuretés suite à son passage au-dessus des innombrables cheminées, bouches d'égouts et autres, mêlé à l'air rejeté par des milliers et des millions d'êtres humains. Du reste, on ne doit pas oublier que le riche, le désœuvré et l'artiste qui ont assez de temps pour pouvoir se livrer pleinement au plaisir de la contemplation du ciel, peuvent bien plus facilement apprécier les beautés du crépuscule que celles de l'aube. Consciemment ou inconsciemment, ils suivent le mouvement du soleil de l'Est vers l'Ouest, et aiment le voir disparaître enfin dans les nuages resplendissants du soir. Mais il y a bien des exceptions à cette norme de croissance des villes dans la direction que suit le soleil. La forme et le relief du sol, l'attrait du paysage, le sens du courant, l'attraction des industries et du commerce locaux, peuvent orienter vers n'importe quel point de l'horizon la poussée urbaine.
« La forme et le relief du sol, l'attrait du paysage, le sens du courant, l'attraction des industries et du commerce locaux, peuvent orienter vers n'importe quel point de l'horizon la poussée urbaine. »
Comme tout autre organisme qui se développe, la ville tend aussi à mourir. Elle n'échappe pas à la loi du temps et la vieillesse l'atteint, cependant que d'autres villes naissent autour d'elle, impatientes de vivre leur vie à leur tour. Par la force de l'habitude, en réalité par la volonté commune de ses habitants, et par l'attraction que tout centre exerce sur son voisinage immédiat, elle essaie de survivre ; mais — sans parler des accidents mortels qui peuvent survenir aux cités comme aux hommes — aucun groupe humain ne peut indéfiniment réparer ses pertes et renouveler sa jeunesse sans une dépense d'énergie de plus en plus lourde, dont parfois il se lasse. La ville doit élargir ses rues et ses places, reconstruire ses murs et remplacer ses vieux bâtiments, désormais inutiles, par des constructions qui répondent aux nécessités du moment. Pendant que la ville américaine surgit toute armée et parfaitement adaptée à son milieu, Paris, vieilli, encombré, encrassé, doit maintenir un harassant programme de reconstruction qui, dans la lutte pour l'existence, lui donne un handicap particulièrement fort par rapport à de jeunes cités comme New York ou Chicago. Ce sont ces mêmes raisons qui expliquent la succession et le remplacement de l'une par l'autre des immenses villes de l'Euphrate et du Nil, Babylone et Ninive, Memphis et le Caire successivement. Chacune de ces villes pouvait garder son importance historique, grâce aux avantages de sa position ; elle n'en devait pas moins abandonner ses quartiers surannés en déplaçant son implantation pour échapper à ses propres décombres, ou même à la pestilence montant de ses amas d'ordures. En général, le site abandonné d'une ville qui s'est déplacée est couvert de tombes.
« Comme tout autre organisme qui se développe, la ville tend aussi à mourir. »
D'autres causes de dépérissement, plus sérieuses que celles-ci, parce que résultant d'une évolution historique naturelle, ont frappé maintes cités jadis fameuses, leur destruction résultant inévitablement de conditions aussi déterminées que leur apparition. Ainsi, l'abandon d'une route principale ou secondaire à la suite de quelques progrès dans les moyens de transport peut détruire d'un coup une ville créée pour les nécessités du commerce. Alexandrie a ruiné Pelusium. Carthagène [Carthagène des Indes (Colombie), N.D.E.], dans les Indes occidentales, a renvoyé Porto-Bello [Portobelo (Panama), N.D.E.] à la solitude de ses forêts. Presque toutes les villes construites sur les rivages escarpés de la Méditerranée ont vu, suite aux exigences du commerce et à la suppression de la piraterie, leur site se déplacer. Jadis, elles étaient perchées sur de rudes escarpements et s'entouraient d'épaisses murailles, pour se défendre contre les seigneurs et les corsaires. De nos jours, elles sont descendues de leurs forteresses et s'étalent le long du rivage. Partout, la citadelle laisse place à l'esplanade. La ville est passée de l'Acropole au Pirée.
Dans nos sociétés, où les institutions politiques ont souvent donné une influence prépondérante au pouvoir d'un seul, il est arrivé plus d'une fois que le caprice d'un souverain fonde une ville à un endroit où jamais elle n'aurait pu s'élever par ses seules forces. Édifiée ainsi sur un site artificiel, la nouvelle ville ne s'est développée qu'au prix d'une extraordinaire dépense de force vitale. Madrid et Saint-Pétersbourg, par exemple, dont les huttes et les hameaux primitifs ne seraient jamais devenus les cités populeuses d'aujourd'hui sans Charles V et Pierre Ier, ont été construites au prix d'énormes investissements. Cependant, si elles doivent leur existence au despotisme, c'est du labeur conjugué des hommes qu'elles tirent les avantages qui leur ont permis de durer comme si elles avaient eu une origine normale. Bien que le relief naturel ne les ait jamais destinées à devenir des centres de vie humaine, c'est grâce à la convergence de communications artificielles — routes, chemins de fer, canaux — et aux échanges intellectuels qu'elles le sont devenues. Car la géographie n'est pas un donné immuable. Elle se fait et se refait jour après jour. Elle est modifiée à chaque heure par l'action des hommes.
« Car la géographie n'est pas un donné immuable. Elle se fait et se refait jour après jour. Elle est modifiée à chaque heure par l'action des hommes. »
De nos jours, on ne cite plus d'exemples de Césars bâtisseurs de villes à leur usage ; ceux qui les font construire sont les grands capitalistes, les spéculateurs, les présidents de syndicats financiers. De nouvelles villes poussent en quelques mois, fort étendues, merveilleusement disposées, superbement équipées de toutes les installations de la vie moderne, jusque et y compris l'école et le musée. Si le lieu est bien choisi, ces nouvelles créations sont bientôt entraînées dans le mouvement général de la vie de la nation : le Creusot, Crewe, Barrow-in-Furness, Denver, La Plata prennent rang parmi les agglomérations connues. Mais si l'emplacement est mauvais, les nouvelles villes disparaissent avec les intérêts particuliers qui les ont fait naître. Quand Cheyenne cesse d'être le terminus d'une ligne de chemin de fer, elle expédie plus avant ses maisons, par le prochain train pour ainsi dire ; et Carson City disparaît quand s'épuisent les mines d'argent, seule cause du peuplement de cet affreux désert.
Si le caprice du capital tente quelquefois de créer des villes que les intérêts généraux de la société condamnent à périr, il lui arrive aussi en revanche de détruire beaucoup de petites agglomérations qui ne demandent qu'à vivre. Dans les environs de Paris même, on peut voir un grand banquier et propriétaire foncier qui, année après année, accroît son domaine d'une centaine d'hectares en transformant systématiquement les terres cultivées en parc d'agrément et en détruisant des villages entiers qu'il remplace par des pavillons de gardiens dûment espacés.
« Si le caprice du capital tente quelquefois de créer des villes que les intérêts généraux de la société condamnent à périr, il lui arrive aussi en revanche de détruire beaucoup de petites agglomérations qui ne demandent qu'à vivre. »
Parmi les villes dont la fondation est artificielle, en totalité ou en partie, parce qu'elles ne répondent à aucun besoin véritable de la société industrielle, il faut citer aussi celles qui résultent des buts militaires, du moins celles qui ont été construites de nos jours par les grands États centralisés. Il en allait autrement quand la ville pouvait contenir la nation entière ; il était alors absolument nécessaire pour les besoins de la défense de construire des remparts enfermant tous les quartiers de la ville sans rien laisser à l'extérieur, de bâtir des tours de guet aux angles et d'ériger à côté du temple, au sommet de la colline de défense une citadelle où le corps entier des citoyens pouvait se réfugier en cas de danger ; si une bande de territoire s'intercalait entre la ville et son port, comme à Athènes, Mégare ou Corinthe, il fallait aussi protéger par de longs murs la route les reliant. Le système des fortifications résultait de la nature des choses, et s'inscrivait avec naturel et pittoresque dans le paysage. Au contraire, dans notre société où la division du travail est poussée à l'extrême et ou le pouvoir militaire est devenu pratiquement indépendant de la nation, au point qu'aucun civil n'ose donner son avis ou intervenir en matière de stratégie, la plupart des villes fortifiées ont une configuration complètement artificielle sans accord aucun avec les mouvements du terrain. Leur profil désagréable à l'œil brise les lignes du paysage. Jadis, du moins, quelques ingénieurs italiens tentèrent d'introduire de la symétrie dans le tracé de leurs fortifications en leur donnant la forme d'une immense Croix ou Étoile d'Honneur, avec ses rayons, ses pierreries, ses émaux, les murs blancs des bastions et redans formant un contraste régulier avec la vue toute de douceur de la vaste étendue de la rase campagne. Mais nos modernes forteresses ne visent pas à la beauté : cette idée n'entre jamais dans la tête du stratège. Un simple regard sur le plan des fortifications révèle leur monstrueuse laideur, leur totale absence d'harmonie avec leur environnement. Au lieu de suivre le dessin naturel du pays et d'étendre leurs bras librement dans les champs qu'elles dominent, elles sont posées comme une masse informe, ressemblant à des êtres aux oreilles écourtées et aux membres amputés. Regardez la forme mélancolique que la science militaire a donnée à Lille, à Metz, à Strasbourg. Même Paris, avec toute la beauté de ses constructions, la grâce de ses promenades, le charme de son peuple, souffre d'être enfermé brutalement dans un cadre de fortifications. Délivrée de cette enceinte déplaisante faite de lignes brisées, la ville aurait pu s'étendre d'une manière naturelle et agréable et prendre une forme gracieuse et simple en accord avec la nature et la vie.
« Délivrée de cette enceinte déplaisante faite de lignes brisées, la ville aurait pu s'étendre d'une manière naturelle et agréable et prendre une forme gracieuse et simple en accord avec la nature et la vie. »
Une autre cause d'enlaidissement de nos villes modernes vient de l'envahissement par les grandes industries manufacturières. Chaque ville, ou presque, est encombrée d'un ou plusieurs faubourgs hérissés de cheminées puantes, où les rues noircies sont bordées d'immenses bâtisses aux murs nus et aveugles, ou percés d'innombrables fenêtres, dans une symétrie lassante. Le sol tremble sous le grondement des machines et sous le poids des fourgons, des chariots et des trains de marchandises. Combien de villes, spécialement dans la jeune Amérique, où l'air est presque irrespirable et où tout ce qui s'offre au regard — le sol, les murs, le ciel — semble suinter la boue et la suie ? Qui peut évoquer sans frémir de dégoût une installation minière comme Scranton, sinueuse et interminable, dont les soixante-dix mille habitants n'ont pas même quelques hectares de gazon malpropre et au feuillage noir pour purifier leurs poumons ? Et l'énorme Pittsburgh dominée par sa couronne semi-circulaire de faubourgs émettant fumées et flammes, est-il possible de l'imaginer dans une atmosphère plus souillée que maintenant, quand on pense que les habitants assurent qu'elle a gagné à la fois en propreté et en clarté depuis qu'on utilise du gaz naturel dans ses fourneaux ? D'autres villes, moins noires que celles-ci, sont à peine moins hideuses, du fait que les compagnies ferroviaires ont pris possession des rues, places et avenues, et lancent leurs locomotives ronflantes et sifflantes le long des routes, éparpillant les gens à droite et à gauche de leur trajectoire. Quelques-uns des sites les plus charmants du monde ont été ainsi profanés. À Buffalo, par exemple, le passant essaie vainement de suivre le bord du merveilleux Niagara en se frayant un chemin à travers un chaos de rails, de fondrières et de canaux boueux, de tas de graviers et de montagnes de fumier, et de toutes les autres saletés de la ville.
« Chaque ville, ou presque, est encombrée d'un ou plusieurs faubourgs hérissés de cheminées puantes, où les rues noircies sont bordées d'immenses bâtisses aux murs nus et aveugles, ou percés d'innombrables fenêtres, dans une symétrie lassante. »
Une spéculation barbare sacrifie aussi la beauté des rues en cédant le terrain sous forme de lotissements sur lesquels les entrepreneurs construisent des quartiers entiers, dessinés d'avance par des architectes qui n'ont jamais même visité l'endroit, moins encore pris la peine de consulter les futurs habitants. Ils érigent ici une église gothique pour les fidèles de l'Église épiscopale, là, un édifice roman pour les Presbytériens, et un peu plus loin une sorte de Panthéon pour les Baptistes. Ils disposent le plan de leurs rues en carrés et en losanges, introduisant des variations bizarres dans le dessin géométrique des places et dans le style des maisons, tout en réservant religieusement les meilleurs coins pour les débits de boissons. L'absurdité de ce mélange complètement hétérogène est aggravée dans nombre de nos cités par l'intervention de l'art officiel qui prône des modèles pour les différents types d'architecture.
« Une spéculation barbare sacrifie aussi la beauté des rues en cédant le terrain sous forme de lotissements sur lesquels les entrepreneurs construisent des quartiers entiers, dessinés d'avance par des architectes qui n'ont jamais même visité l'endroit, moins encore pris la peine de consulter les futurs habitants. »
Cependant, même si le riche entrepreneur et le mécène officiel étaient toujours des hommes d'un goût cultivé, les villes présenteraient un affligeant contraste entre le luxe et la crasse, entre la somptueuse et insolente splendeur de quelques quartiers, et la sordide misère des autres : là des murs bas et ventrus cachent des cours qui suintent d'humidité où des familles affamées sont entassées dans des taudis branlants de bois ou de pierre. Même dans les villes où les autorités cherchent à dissimuler tout cela derrière un masque décent de palissades blanchies à la chaux, la misère se glisse encore à l'extérieur, et on sait que la mort poursuit son cruel travail à l'intérieur. Laquelle de nos villes n'a pas son Whitechapel ou sa Mile End Road ? Aussi élégantes et imposantes qu'elles puissent paraître à des yeux étrangers, chacune a ses vices secrets ou apparents, ses défauts fatals, ses maladies chroniques, mortelles si une libre et saine circulation ne peut être rétablie à travers l'organisme tout entier. Mais, de ce point de vue, la question architecturale et immobilière est indissociable de la question sociale dans son ensemble. Viendra-t-il jamais le temps où tous les hommes, sans exception, respireront l'air frais en abondance, jouiront de la lumière et du soleil, goûteront la fraîcheur de l'ombrage et le parfum des roses, nourriront leurs enfants sans crainte que le pain vienne à manquer dans la huche ? En toute hypothèse, tous ceux d'entre nous qui ne reportent pas leur idéal à une vie future, mais pensent un peu aussi à l'existence présente de l'homme, doivent regarder comme intolérable un modèle de société qui n'inclurait pas la délivrance de l'humanité de la simple faim.
« Viendra-t-il jamais le temps où tous les hommes, sans exception, respireront l'air frais en abondance, jouiront de la lumière et du soleil, goûteront la fraîcheur de l'ombrage et le parfum des roses, nourriront leurs enfants sans crainte que le pain vienne à manquer dans la huche ? »
Par ailleurs, ceux qui dirigent les cités obéissent presque toujours eux-mêmes — souvent contre leur volonté — à l'idée très juste que la ville est un organisme collectif, dont chaque cellule particulière doit être gardée en parfaite santé. La grande affaire des municipalités est toujours la question de la salubrité. L'histoire les prévient que la maladie n'épargne personne et qu'il est dangereux de laisser la pestilence dépeupler les taudis accolés aux palais. Parfois, elles vont jusqu'à la démolition complète des quartiers contaminés, oubliant que les familles qu'elles expulsent ne peuvent que reconstruire leurs habitations un peu plus loin, transportant peut-être le poison dans des quartiers plus salubres. Mais, même là où les cloaques malsains restent intacts, tous sont d'accord sur l'importance de veiller soigneusement aux conditions d'une hygiène générale — nettoyage des rues, ouverture de jardins et d'espaces verts ombragés par de grands arbres, enlèvement immédiat des détritus, alimentation abondante en eau pure pour chaque quartier et chaque maison. En ces matières, une compétition pacifique oppose les villes des nations les plus avancées et chacune tente ses expériences particulières dans le domaine de la salubrité et du confort. La formule définitive, cependant, n'a pas encore été trouvée, car l'organisme urbain n'est pas capable d'assurer par un processus automatique ses approvisionnements, sa circulation sanguine et nerveuse, la reconstitution de ses forces et l'élimination de ses déchets. Du moins, bien des villes ont-elles été transformées au point que la vie y soit plus saine en moyenne que celle de bien des campagnes où les habitants respirent jour après jour les vapeurs du fumier, et vivent dans une ignorance primitive des lois les plus simples de l'hygiène.
« Par ailleurs, ceux qui dirigent les cités obéissent presque toujours eux-mêmes — souvent contre leur volonté — à l'idée très juste que la ville est un organisme collectif, dont chaque cellule particulière doit être gardée en parfaite santé. »
C'est aussi la conscience que la vie urbaine est celle d'un organisme collectif qui se manifeste dans les préoccupations artistiques des municipalités. Comme l'ancienne Athènes, comme Florence et les autres cités libres du Moyen Âge, toutes nos villes modernes sont soucieuses de s'embellir. Le moindre village a son clocher, sa colonne, sa fontaine sculptée. Sans doute est-ce un art horriblement laid, dans la plupart des cas, que cet art conçu par des professeurs qualifiés, sous la surveillance d'un comité, d'autant plus prétentieux qu'il est plus ignorant. L'art vrai doit trouver sa propre voie et ne pas être lié à des directives imposées par la commission de la voirie. Ces petits messieurs du conseil municipal sont comme le général romain Munnius qui était toujours disposé à donner l'ordre que ses soldats repeignent toute peinture qu'ils auraient abîmée. Ils prennent la symétrie pour la beauté et pensent que des reproductions identiques donneront à leur ville un Parthénon ou un Saint-Marc.
« l'organisme urbain n'est pas capable d'assurer par un processus automatique ses approvisionnements, sa circulation sanguine et nerveuse, la reconstitution de ses forces et l'élimination de ses déchets. »
Et même s'ils pouvaient effectivement recréer chaque œuvre comme ils demandent à leur architecte de le faire, il n'y en aurait pas moins outrage à la nature. Car aucun monument ne saurait être séparé des conditions de temps et de lieu qui lui ont donné naissance. Toute ville a sa vie propre, ses traits propres, sa forme propre, de sorte que le constructeur ne devrait l'approcher qu'avec beaucoup de vénération. C'est comme une offense contre la personne que de supprimer l'individualité d'une ville, et de la couvrir d'immeubles conventionnels et de monuments disparates sans relation avec son caractère actuel et son passé. On rapporte que, à Édimbourg, la charmante capitale écossaise, le travail de reconstruction est mené tout autrement, dans le respect de ce qui existe. S'attaquant aux ruelles pittoresques mais sordides, on les transforme graduellement, maison par maison : chaque habitant garde son logis, mais un logis plus propre et plus beau où l'air et la lumière pénètrent ; on regroupe les amis et on leur donne des lieux de réunion pour les échanges sociaux et la jouissance des arts. Petit à petit, c'est une rue entière qui, tout en gardant son caractère original, mais débarrassée de la saleté et des odeurs, apparaît ; fraîche et pimpante, comme la fleur qui surgit, sans défaut, sous le pied sans qu'une seule motte de gazon ait été remuée autour de la plante-mère.
« Toute ville a sa vie propre, ses traits propres, sa forme propre, de sorte que le constructeur ne devrait l'approcher qu'avec beaucoup de vénération. C'est comme une offense contre la personne que de supprimer l'individualité d'une ville, et de la couvrir d'immeubles conventionnels et de monuments disparates sans relation avec son caractère actuel et son passé. »
Ainsi, par destruction ou par restauration, les villes sont-elles régénérées à jamais, sur leur emplacement même : ce processus ira, sans doute, en s'accélérant sous la pression des habitants eux-mêmes. À mesure que les hommes modifient leur propre idéal de vie, ils doivent nécessairement faire évoluer, en accord avec celui-ci, cette « corporéité » élargie que constitue leur habitat. La ville reflète l'esprit de la société qui l'a créée. Si la paix et la bonne volonté règnent parmi les hommes, il n'y a pas de doute que la disposition et l'aspect des cités répondront aux nouveaux besoins issus de la grande réconciliation sociale. Et d'abord, les parties de la cité irrémédiablement sordides et insalubres seront rayées de la surface de la terre ; ou alors il n'en subsistera plus que le témoignage de groupes de maisons librement disposées parmi les arbres, plaisantes à regarder, pleines de lumière et d'air. Les quartiers les plus riches, maintenant agréables à la vue, mais souvent à la fois incommodes et insalubres, seront pareillement transformés. L'hostilité ou l'exclusion, traits que l'esprit de la propriété individuelle donne maintenant aux habitations privées, auront disparu. Les jardins ne seront plus cachés à la vue par des murs inhospitaliers. Les pelouses ou plates-bandes et les plantations qui entourent les maisons s'étendront en allées ombragées jusqu'à la limite des promenades publiques comme elles le font déjà dans quelques villes et universités américaines. La supériorité de la vie communautaire sur la vie privée strictement enclose et jalousement gardée aura rattaché maintes habitations privées à un groupe organique d'écoles et de phalanstères. Là aussi, de larges espaces devront être ouverts pour laisser passer l'air et donner une meilleure apparence à l'ensemble.
« Ainsi, par destruction ou par restauration, les villes sont-elles régénérées à jamais, sur leur emplacement même : ce processus ira, sans doute, en s'accélérant sous la pression des habitants eux-mêmes. »
Évidemment, les villes qui grandissent déjà si vite le feront encore plus vite ou plutôt elles se fondront peu à peu dans la campagne, et, sur toute la surface du pays, les provinces seront parsemées de maisons qui, malgré la distance, appartiendront réellement à la ville. Londres, aussi denses que soient ses quartiers centraux, est un merveilleux exemple de cette dispersion de la population urbaine à travers champs et forêts sur plus de cent kilomètres à la ronde, jusqu'à la côte même. Des centaines de milliers de gens qui ont leurs affaires en ville et qui, pour ce qui est de leur travail, sont d'actifs citadins, passent leurs heures de loisir et d'activités domestiques sous les ombrages des grands arbres, près de ruisseaux aux eaux vives, ou non loin du bruit des vagues jaillissantes. Le vrai cœur de Londres, « la Cité », la bien nommée, n'est guère qu'une grande Bourse le jour, désertée la nuit. Les centres d'activité du Gouvernement, du Parlement, des sciences et des arts, sont réunis autour de ce grand foyer d'énergie qui s'étend d'année en année et repousse la population résidente vers les banlieues. Il en est de même à Paris, où le noyau central, avec ses casernes, ses tribunaux et ses prisons, présente un aspect plus militaire et stratégique que résidentiel.
« La ville reflète l'esprit de la société qui l'a créée. Si la paix et la bonne volonté règnent parmi les hommes, il n'y a pas de doute que la disposition et l'aspect des cités répondront aux nouveaux besoins issus de la grande réconciliation sociale. »
Le développement normal des grandes villes consiste donc, selon notre idéal moderne, dans la conciliation des avantages de la vie rurale et de la vie urbaine ; l'une apportant l'air, le paysage, la solitude délicieuse, l'autre la facilité de communication, la distribution par réseaux souterrains d'énergie, de lumière et d'eau. Ce qui était jadis la partie la plus habitée de la cité est précisément la partie qui est maintenant désertée, parce qu'elle est devenue propriété collective ou du moins centre public de vie intermittente. Trop utile à l'ensemble des citoyens pour être monopolisé par des familles privées, le cœur de la cité est le patrimoine de tous. Il en est de même, pour les mêmes raisons, dans les agglomérations moins importantes ; et les citoyens demandent en outre à pouvoir utiliser les espaces ouverts de la cité pour des rassemblements publics et des manifestations en plein air. Chaque ville devrait avoir son agora, où puissent se rencontrer ceux qui sont animés par une passion commune ; Hyde Park est une agora de ce type où, en serrant un peu, pourrait tenir un million de personnes.
« Trop utile à l'ensemble des citoyens pour être monopolisé par des familles privées, le cœur de la cité est le patrimoine de tous. [...] Chaque ville devrait avoir son agora, où puissent se rencontrer ceux qui sont animés par une passion commune »
D'autres raisons encore tendent à favoriser une déconcentration dans la ville moderne et à ouvrir un peu ses espaces centraux à des activités venues de l'extérieur. Bien des institutions implantées à l'origine au cœur de la ville se déplacent vers la campagne. Écoles, collèges, hôpitaux, hospices, couvents, n'y ont plus leur place. Seules les écoles de quartiers devraient y subsister, mais entourées de jardins, et seuls les hôpitaux absolument indispensables pour les accidents et les maladies soudaines. Les établissements transférés dépendent encore de la ville, détachés d'elle au point de vue spatial, tout en gardant leur lien vital avec elle. Ils sont autant d'éléments de la ville disséminée dans la campagne. Le seul obstacle à une extension indéfinie des villes et à la fusion totale avec la campagne vient, non pas tant de la distance, que du coût élevé des communications, car on peut atteindre par le rail la solitude des champs ou de la côte à une distance de soixante-dix à quatre-vingts kilomètres, en moins de temps qu'il n'en faut pour aller d'un bout de la ville à l'autre. Mais ces limites à un libre usage du chemin de fer par les pauvres reculent graduellement devant l'avance du progrès social.
« Alors que l'homme de la campagne devient de jour en jour un citadin dans son mode de vie et de penser, le citadin, lui, se tourne vers la campagne et aspire à être un campagnard. »
Ainsi, le modèle de l'ancienne ville, nettement délimitée par des murs et des fossés, tend de plus en plus à disparaître. Alors que l'homme de la campagne devient de jour en jour un citadin dans son mode de vie et de penser, le citadin, lui, se tourne vers la campagne et aspire à être un campagnard. C'est sa croissance même qui permet à la ville moderne d'abandonner son existence solitaire et de tendre à se fondre avec d'autres villes, retrouvant ainsi la relation originelle qui unissait le marché naissant à la campagne dont il était issu. L'homme doit avoir le double avantage d'accéder aux plaisirs de la ville, avec ses solidarités de pensées et d'intérêts, les possibilités qu'elle offre d'étudier, de pratiquer les arts et, en même temps, il doit jouir de la liberté qui existe dans la liberté de la nature et se déploie dans le champ de son vaste horizon.
Élisée Reclus (1895), « The Evolution of Cities » in Contemporary Review, n°67 ; traduit et présenté par Jean-Claude Chamboredon et Annie Méjean in Cahiers d'économie et sociologie rurales, n° 8, 1988 ; repris dans Villes et civilisations urbaines, recueil dirigé par Marcel Roncayolo et Thierry Paquot, Larousse, 1992.