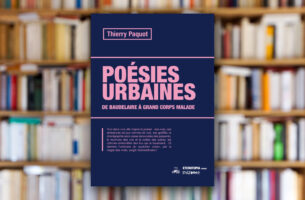Nouvelles de nulle part
L’impossible ville algérienne : entre État rentier et citoyens désemparés
Habib Benkoula Mohamed Larbi Merhoum | 17 décembre 2020

Introduction
Trois générations d’architectes algériens se rencontrent. Amine Belarbi questionne de but en blanc ses deux aînés sur la ville algérienne, son évolution, son organisation et son absence d’urbanité et de citadinité. Habib Benkoula – par ailleurs enseignant et chroniqueur au Quotidien d’Oran – et Mohmamed Larbi Merhoum – figure incontournable de l’architecture algérienne contemporaine – lui répondent sans détour et font le procès d’un urbanisme rentier sans urbanité, ni diversité, ni altérité, bref sans ville, ce terreau pourtant nécessaire selon eux à l’avènement du citoyen avec ses droits et ses devoirs.
Des droits sans devoir
Pourquoi ceux qui squattent des logements illégalement ou qui auto-construisent sans autorisation bénéficient-ils de logements sociaux, alors que des millions d’autres travaillent durement pour accéder à la propriété d’appartements modestes, très mal conçus et réalisés ?
[Mohamed Larbi Merhoum] Cela résulte de la gestion de la rente par les minorités au pouvoir, qui agissent sans assise populaire ni crainte des couches moyennes éduquées. Le pouvoir module la rente selon les capacités de nuisances des uns et des autres. Quand un logement vaut 1000 fois le SMIG, l’épargne n'a plus de sens. Il n'y a que l’octroi ou le vol qui permette à un citoyen lambda d'accéder au logement. Octroi et vol ont deux corollaires, la soumission et la corruption... Dans les deux cas, le niveau d'exigence est inexistant. La qualité du logement devient secondaire. C'est le cas quand les individus considèrent qu’ils n'ont ni devoir ni obligation ni entre eux ni envers une entité collective. Il en résulte une société informelle qui favorise des rapports informels dans le sens des X et dans le sens des Y.
[Habib Benkoula] Le civisme, qui est à la mode dans ce qui ressemble à des débats publics dans notre pays, n'est pas une réalité, cela ne relève même pas de l'éducation nationale scolaire qui s'appuie sur d'autres considérations plutôt culturelles et certainement archaïsantes. Une société civile est une société des devoirs inscrits dans la République, par des lois et leurs applications. Le gros problème dans notre pays « douarisé » (1), c'est qu'on a troqué depuis l'Indépendance les devoirs contre les droits. Henri Lefebvre (1901-1991) revendiquait un droit à la ville, dans un article éponyme paru en 1967, je réclame un devoir de ville. Nos villes sont livrées totalement au bon-vouloir de leurs populations qui constituent autant de microsociétés locales, qui baignent dans l’informel, suite à l’abandon d’un État sans crédibilité au regard de la majorité des Algériens, et se satisfont d’un droit sans devoir. À dire vrai, ils n’ont ni l’un ni l’autre ! Certes, le pouvoir y trouve son compte et achète ainsi la paix sociale. Mais cela peut-il durer, avec une crise qui s’aggrave dans tous les domaines ?

Un urbanisme rentier
Par quelle logique laisse-t-on des promoteurs construire des cités fermées, accentuant la fracture sociale ? Pourquoi leurs habitants se pensent-ils au-dessus des autres ?
[M.L.M.] Ce sont les règles d'urbanisme qui le permettent, inspirées vaguement de la charte d'Athènes, la notion d'espace public y est absente. L'espace public suppose un tissu urbain fait de parcellaires et de voies hiérarchisées. La réglementation repose sur le triptyque un terrain/un projet/un propriétaire. Du coup le bâti et le non-bâti dans un projet ne sont pas hiérarchisés, tous deux sont privés. Il aurait fallu instituer systématiquement la parcelle comme unité de croissance et donc le lotissement comme mode de partage du territoire pour pouvoir en extraire un espace possiblement et obligatoirement public. En attendant, ces gated-communities à l'américaine vont perdurer, d'autant qu'elles correspondent à l'individualisme dominant et à l'ubérisation grandissante de toutes les activités de la société. Indépendamment du produit immobilier, qu’est l’enclave résidentielle sécurisée, des habitants peuvent très bien clôturer leur terrain et placer des gardes à l'entrée... L’important est ailleurs : tout dessin de ville prédétermine un dessein de vie. Aussi, je ne crois pas que ce genre d'apartheid puisse exister dans les cités médiévales, les médinas et même les villes industrielles du XIXe siècle, où l’autre trouvait sa place.
[H.B.] L'urbanisme rentier a favorisé la promotion rentière. Pendant ces vingt dernières années, on n’a fait que transférer la prébende et la concussion à grande échelle du domaine public au domaine privé. Pour le dire autrement, l'État public est devenu un État privé par des pratiques scandaleuses qui ont fait la « Une » des médias nationaux et internationaux. En gros, ce qui passait illégalement sur la voie publique, sous Bouteflika se réalisait de manière privée, au point où tout le monde se voyait promoteur ! Beaucoup de familles souhaitaient que leurs enfants deviennent architectes afin d’exercer comme promoteurs. La rente était forte, l’immobilier rapportait gros, du moins avant la crise et la pandémie. À présent, c'est le commerce sanitaire qui culmine, tout le monde se voit médecin pour opérer une personne saine s'étant crue malade. Nous sommes passés de la promotion immobilière à la promotion sanitaire.
Par ailleurs, les promoteurs n'ont aucune conscience de l'urbanisme en tant que philosophie du vivre ensemble. Ils ghettoïsent pour protéger leur exploit personnel, ce qui est une réaction typiquement non-urbaine. Nous en sommes là : il n'y a pas de villes parce qu'il n'y a pas de projets d'urbanisme. Il n’y a que des urbanismes hasardeux rêvant d'accumulation qui renforcent des statuts et leurs contraires. Il y a des cités fermées qui donnent la sensation à leurs habitants qu'ils sont privilégiés, et d'autres cités fermées qui stigmatisent leurs habitants par leur caractère très social. Frantz Fanon est toujours d'actualité par son propos du colonisé qui veut absolument prendre la place du colonisateur. Dans ces conditions de frustration sociétale, la ville est certainement impossible puisque le principe de la société est émietté spatialement. Je cours le risque d’affirmer que nos urbanismes ne sociabilisent plus ou très peu.
Vers une citoyenneté
Pourquoi nos trottoirs sont-ils si mal entretenus et encombrés ? Avec des extensions privées totalement prohibées ? Pourquoi l'Algérien nettoie-t-il uniquement devant sa propriété ?
[M.L.M.] Le trottoir est le premier lieu de négociation entre l'intérêt privé et l'intérêt public. C'est aussi le premier jalon de la manifestation du respect de l'autorité, de la chose publique. Les premiers signes de respect ou de transgression par rapport à l'État se dessinent sur cette frange de territoire. Il est donc normal que les rapports État/Citoyen en Algérie quand ils sont essentiellement liés à la distribution de la rente comme seul mode de gestion de la société génèrent une relation de prédation entre l'État et le citoyen. Pour le citoyen, l'État est un corps étranger, une entité contraire à ses propres intérêts. Le bras de fer entre eux est sans répit. Cela tient certainement à de lointains phénomènes historiques, comme la notion de beylek c’est-à-dire des choses qui n’appartiennent à personne parce qu’étatiques ou publiques et dont chacun use sans s’en préoccuper. Le trottoir, comme l'impôt, est un signe irréfutable de la citoyenneté. Les transgressions de l'espace public, tout comme la résistance immodérée à l'impôt auquel beaucoup préfèrent la zakat (aumône légale, troisième pilier de l’islam), sont l’expression d’une défiance du citoyen envers l’État. Il nous faut passer de la relation administrateur/administré avec ce qu'elle suppose comme chantage, prédation, corruption, à la relation État /citoyen avec ce que cela suppose comme partage et acception de règles de conduite réciproques. En attendant, le trottoir défoncé reste la manifestation d’une rupture irréversible du couple État/Citoyen.
[H.B.] En fait, on ne se rend pas compte à quel point notre culture est par essence privative, même si nous prétendons pour des tas de raisons le contraire. Il faut faire la part entre ce qui se dit en haut d'un minbar et ce qu’on observe dans la vie quotidienne. Même nos mosquées sont érigées sur des espaces collectifs, détournés et sans reconnaissance aucune de l'intérêt général. C'est dire ô combien le pilier fondateur de la société algérienne, communautaire par principe, n'hésite pas à empiéter sur les règles qui assurent l'équilibre de l'être-collectif en privatisant aussi bien les esprits que les territoires. La médina relève de l'espace privé et je n'y vois presque pas d'espaces publics à distinguer de l'espace collectif traditionnel. Les femmes devaient y circuler à des horaires stricts, tout en rasant les murs. Un ami sociologue disait qu'elles étaient des morceaux de murs ambulants qui devaient revenir au mur ! Il s’agissait d'enclore les esprits, à l’image de la ville entourée de son enceinte et les confiner. Il y régnait une dictature d'hommes faussement porteurs de belles paroles qui contredisaient la tendance dominante issue généralement des interprétations religieuses souvent arrêtées et oppressives, des sociétés locales. Cette attitude « médinée » n’a pas disparue, elle conditionne encore l’inconscient collectif et pérennise des schémas mentaux « archaïques ».
Jadis les communautés incarcérées dans des structures sociales stables dans la longue durée trouvaient des mécanismes efficaces pour gérer la chose collective (jamais publique dans les médinas et ksour). Dorénavant, notre schizophrénie culturelle, notre ressourcement excessif dans le passé magnifié et sacralisé et notre malaise face à la modernité que nous rejetons à cause de son origine occidentale, assimilée à la chrétienté, empêchent d’imaginer des mécanismes qui pourraient modérer et assouplir nos ethos. Nous sommes restés profondément des communautés de l'introverti. L'espace au-delà de la â'tba (le « seuil ») ne nous concerne pas. Mais nous n'hésitons pas à nous l'accaparer puisqu'il n'y a pas d’autorité pour l’empêcher. Je dois avouer que l'État se fout des trottoirs, qui ne représentent aucun enjeu pour lui. Les gouvernants et responsables, à tous les niveaux, n'ont aucune vision de ce que serait la citoyenneté, aussi ne font-ils rien pour la susciter. L'urbanisme en fabriquant de la ville réaliserait de la citoyenneté, ce dont les dirigeants n'ont aucune idée.
Ni vision, ni projet
Quelle utilité ont des instruments comme le PDAU (Plan directeur d’aménagement et d’urbanisme) et le POS (Plan d’occupation des sols) si personne ne les respecte ? Pourquoi nos extensions de villes sont-elles si moches ?
[M.L.M.] Les instruments d'urbanisme doivent servir un projet d'urbanisme lequel traduit une vision politique et économique. Pas de vision, pas de projet. Par ailleurs, depuis les années 1990 et l'ouverture du marché, une économie parallèle s'est installée avec ses acteurs, ses règles et a imprimé le territoire de sa logique beaucoup plus efficace et plus adaptée aux besoins des usagers que les PDAU et les POS. Sidi Yahia (2) est un exemple de cette erreur de parallaxe entre ce que voit l'urbaniste technocrate du Centre National d'Etudes et de Recherches en Urbanisme et le citoyen. Le premier a dessiné un lotissement périphérique social. Le second en a fait les Champs-Elysées d'Alger. De même le quartier du Hamiz (3) longtemps considéré comme un quartier illicite s'est avéré être une plateforme économique régionale. L'urbanisme de l'État rentier est en décalage avec une société qui s'en est libérée économiquement – de façon informelle. Les extensions subissent elles aussi des visions étatiques erronées que les citoyens adaptent pour répondre à leurs besoins. Elles ne sont pas moches. Elles sont logiques. La beauté d'un tissu vient du respect de règles admises par tous. Ce n'est pas le cas chez nous où le citoyen et l'État sont finalement des colocataires d'un même territoire sans règlement de copropriété ni syndic.
[H.B.] Les instruments d'urbanisme servent à « surveiller et punir ». Ce sont des dispositifs juridiques visant à rendre l'usage des territoires contrôlables. J'ai beaucoup écrit sur le sujet et avec du recul, aucune des réponses ou explications que j'ai apportées ne me satisfait. Je pense que ces outils vont mal aux territoires qu'ils mobilisent, comme ils ne prennent pas suffisamment en compte les caractéristiques et richesses des géographies. Il leur manque l'intelligence de l'espace du fait de les faire agir seulement en producteurs et redistributeurs d'espaces, pas plus.
Il y a aussi les acteurs qui transforment ces outils en moyens rentiers, ce qui fait dire au sociologue Rachid Sidi que nous avons à faire à un « urbanisme rentier ». Par ailleurs, l'erreur que nous commettons c'est de les voir en tant que producteurs d'architecture, ce qui n'est pas censé être le cas. Cette confusion dans la perception des échelles et des idées peut être imputée aux acteurs dits professionnels de l'urbanisme qui sont généralement des architectes. Ces outils ont démontré leur efficacité ailleurs mais pas chez nous. Notre problème est celui de la qualité des acteurs, des leaders des services d'urbanisme, des architectes, pas celui des seuls outils. Nous pouvons toujours évoquer le caractère bureaucratique de l'appareil administratif algérien, au service des intérêts illicites. Et qui fait dire aux agents de cet appareil, que c'est la faute à la politique, pas à eux !
J’ajouterais une réflexion sur la question des extensions, des prolongements de la ville au-delà de son centre, suite à une pression démographique et économique. Ce que nous avons produit depuis l'Indépendance ce sont des étalements urbains, des coupures successives avec les déjà-là et des accumulations de constructions hasardeuses.
La difficulté du patrimoine
Comment se fait-il que les anciens quartiers soient délaissés ?
[M.L.M.] Les quartiers anciens souffrent soit d'un déclassement social et économique, suite à une désocialisation comme le sont toutes nos médinas, soit d'une défaillance de gestion due à l'abandon de dispositifs prévus pour (syndic, concierge, règlements de copro…) et leur remplacement idéologique et démagogique par une gestion étatique qui n'a jamais fonctionnée. À l'origine une cession des biens vacants dans les années 1980 a transformé l'Algérien locataire en propriétaire sans les obligations qui vont avec comme la gestion de la copro et tous les impôts et taxes qui y sont liés. Habiter la médina comme habiter la ville européenne obéit à des règles sociales et des règles précises de fonctionnement. Quand ces règles n'existent plus, quand les échanges économiques rejoignent l'informel, la superposition de l'espace physique et l'espace économique qui permet à ces tissus de garder leur valeur marchande n'est plus de mise. Les politiques urbaines aidant le déclassement des centres s'est accéléré. Il faudra attendre que le logement tout comme l'économie quittent les enjeux politiciens et retrouvent leur valeur marchande réelle pour espérer redonner une seconde vie à nos villes et nos médinas.
[H.B.] C'est la question à laquelle je ne sais pas répondre sans avoir au fond de mon esprit, d'autres interrogations comme « qu'est-ce qu’un quartier ancien en Algérie ? » Dans le cas d'Oran, l'ancienneté ne semble concerner que Sid el Houari qui relève « plus » de l'histoire des Européens que de celle des Algériens. L'élite d'Oran veut sauvegarder un décor européen, un morceau de la colonisation, tout en se dressant en bloc contre la colonisation et son caractère criminel. Aussi, la nostalgie de la toponymie européenne marque les esprits. Même soixante ans après l'indépendance, le territoire urbain de l'imaginaire social demeure européen et est pris pour référence. Beaucoup des plus âgés se mettent en valeur par rapport à des Européens qu'ils connaissaient à « l'époque » , ne serait-ce que pour signifier leur supériorité sur ceux qui n'étaient pas encore là. C'est dire ô combien la définition du patrimoine dans le cas des territoires européens d'Algérie demeure compliquée. L'élite qui défend ce patrimoine universel n'arrive pas, à mon sens, à voir en quoi la population qui y loge ne se sent guère concernée par l'histoire qu'il incarne. Les populations qui y résident ne possèdent pas les savoir-faire qui ont permis la construction des quartiers de la ville basse. Les populations européennes jusqu'à la décennie 1930 étaient dans leur «urbanotope », elles maitrisaient la technologie de son œuvre, alors que les populations algériennes y agissent en intruses avec d'autres modalités d'urbanités et de représentation de soi.
La culture de l’architecte
Pourquoi beaucoup d'architectes algériens méprisent la société au lieu d'essayer de la comprendre ?
[M.L.M.] Je ne pense pas que le mot mépris soit le bon. Le malaise qu'il y a entre l'architecte algérien et la société est que l'accomplissement d'un architecte tel qu'on lui enseigne à l'école, centré sur le « star-system international », est difficilement compatible avec ce que porte la société comme contradictions et aspirations individuelles ou collectives. Le référentiel véhiculé par l'enseignement de l'architecture étant en décalage avec la réalité économique sociale et politique qui attend l'architecte crée une incompréhension souvent insurmontable entre l'architecte et la société. Cette dernière se transforme en frustration puis en méfiance mutuelle.
En fait, la réalité est jugée par nos enseignements comme inéligible à être un matériau d'étude. Voilà un écueil majeur à surmonter. Symétriquement la société restructurée, ou restructurée à la sauce du néo-libéralisme et de l'archaïsme religieux a développé ses propres codes, ses propres Vitruve. Les choses s'arrangeront quand la bourgeoisie néolibérale dépassera le cap de l'accumulation primitive et s'installera dans une logique de reproduction de son capital par le savoir. En attendant, le champ d'observation et d'expérimentation est énorme. Ce corps apparent d'impossibilité et d'impuissance demande à être touché en des points précis pour qu'il réagisse. Notre métier tient plus de l'acupuncture que du diagnostic clinique classique. Notre quête tient plus du raccord à trouver entre notre réalité et nos fantasmes. Une piste serait de faire que le local, qui fonde nos particularismes, alimente une forme de modernité et d'universalité.
[H.B.] Nos architectes ne sont pas encore formés pour comprendre. Beaucoup en effet sont coupés de la société et des sociétés locales. Leur connaissance de ces dernières sont des sommes d'approximations qui les en éloignent, les séparent. Les architectes sont eux-mêmes un cumul de contradictions culturelles. Il y a l'architecte qui est plongé sincèrement dans sa religiosité identitaire, l'architecte qui est à fond la caisse pour le monde moderne, bref, chacun aspire à remplir son destin au nom de dieu, au nom de la république. L'architecture n'est presque pas considérée en tant que fait social et culturel. Les architectes sont une énième fois, fiers d'avoir construit et de posséder des aptitudes de constructeurs – ce qui n'est pas vraiment le cas – que d'être des observateurs de la société.
L'architecture comme l'urbanisme est une discipline totale, elle nécessite un haut niveau culturel de celles et ceux qui veulent l’exercer, ce qui n'est pas du tout le cas chez nous. Tout au long de l'histoire de l'humanité, l'architecture a incarné le temple et le palais, la croyance et le pouvoir. La modernité l'a popularisée et a fait des habitations individuelle et collective un exercice qui a contribué à déposséder massivement les populations de leur savoir-faire et aussi et surtout, ce qui ne se dit jamais, de leur légitimité sociale. En même temps, il ne faut pas se comparer aux pays qui ont des traditions architecturales fortes, solides, comme la France ou l'Angleterre et même le Japon ou la Chine. Ces pays ne souffrent pas de nos crises culturelles et sociales que la politique nationale ne fait qu'exacerber. C'est pour cela que je ne crois pas tellement à un changement national s'il n'est pas d'abord précédé d'une véritable révolution culturelle et citoyenne.
Propos recueillis par Amine Belarbi à Oran en novembre 2020
Notes
(1) De douar : établissement humain rural maghrébin qui était selon Jacques Berque : « une timide amorce d’une commune » (Le Maghreb entre deux guerres, Seuil, 1962, p.133). Douarisé est le terme que j’utilise pour exprimer « la ruralisation de la ville algérienne » et la contradiction qui est toujours en cours entre le monde urbain (des villes) toujours en voie de citadinisation (comme en voie de développement) et le monde rural demeurant largement archaïque par ses traditions inertes.
(2) Nouveau quartier chic et improvisé dans la commune d’Alger, établi sur un lit d’oued en contrebas de Hydra.
(3) Quartier situé à l’Est d’Alger, en direction de Rouiba. Il est commercial spécialisé en quincaillerie, articles de bâtiments et électroménagers.