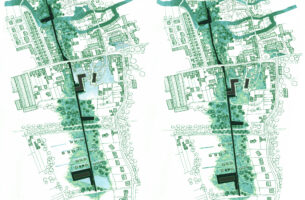Introduction
« Tant de mains pour transformer ce monde, et si peu de regards pour le contempler [1]. » La sentence de Julien Gracq résonne singulièrement à l’oreille du topophile. Elle invite à cultiver un « sens des paysages [2] » dont on sait combien l’auteur du Rivage des Syrtes tenait le sien d’une solide formation de géographe. Retour sur une manière de géo-graphie considérée comme art d’écrire la terre.
Louis Poirier alias Julien Gracq. D’un côté, le professeur d’histoire-géographie au lycée Claude-Bernard, fonctionnaire discret et consciencieux au patronyme si délicieusement IIIe République. De l’autre, l’écrivain ermite, styliste intransigeant, sinon hautain, auteur d’une œuvre majeure tôt élevée au rang de classique et pléiadisée. Malgré les efforts de l’un pour cantonner l’autre à un univers de papier, les deux se rejoignirent – le milieu littéraire s’en souvient – lorsque, le 3 décembre 1951, Louis Poirier, qui s’apprêtait à déjeuner au café Voltaire, restaurant de la place de l’Odéon où il avait son rond de serviette (et aujourd’hui succursale de Flammarion), dut affronter une horde de journalistes venus recueillir la réaction du tout récent lauréat du prix Goncourt : « Je ne puis, comme je l’ai indiqué clairement, faire autrement que refuser le prix qui m’est décerné [3]. » Sous le feu des flashs, le pseudonyme de couverture, soudain, prit les traits d’un homme entre deux âges, rasé de frais, le sourire rare, un poireau ponctuant fièrement la commissure droite des lèvres, encravaté dans un col pelle à tarte digne de ces années-là, petit gilet clair et veste en laine à revers cranté, tapotant sa cigarette au-dessus d’un cendrier Cinzano. Scène en noir et blanc d’un Paris tout simenonien. À partir de ce jour, quand un élève du lycée Claude-Bernard se risquerait à demander une dédicace au célèbre professeur, il s’entendrait répondre : « Au lycée, je suis Monsieur Poirier et je ne connais pas Julien Gracq [4]. » D’un côté, le géographe ; de l’autre, l’écrivain ? D’un côté, docteur Jekyll ; de l’autre Mr. Hyde ?
L’île mystérieuse

Louis Poirier est né le 27 juillet 1910 dans le Maine-et-Loire, à Saint-Florent-le-Vieil, rue du Grenier-à-Sel, dans la bâtisse médiévale éponyme, à tourelles d’escalier en vis, dont la silhouette à contre-jour a pu nourrir l’image du château qui hante ses livres. À quelques mètres de là, sa famille, dans les années 1920, fera sortir de terre, ou plutôt de l’eau de la Loire toute proche, une maison qui n’est pas sans rappeler « l’une de ces villas de prétentieuse et médiocre apparence que le siècle commençant a multipliées sur les plages de second ordre [5] ». C’est là que, jusqu’à sa mort en 2007, Gracq passera des jours de loisir, ainsi que sa retraite, et c’est à cette adresse que tous les Franz Xaver Kappus écriraient à leur Rilke dans l’espoir de recevoir en retour quelque lettre à un jeune poète, avant peut-être d’envisager la « visite au Grand Écrivain », pèlerinage laïque d’un rite d’adoubement auquel beaucoup sacrifièrent [6]. Une existence de près d’un siècle, de la rue du Grenier-à-Sel à la rue du Grenier-à-Sel. Voilà bien la géographie de Gracq : « Un cercle d’un rayon de huit kilomètres entre le tombeau de Bonchamps et le château natal de Gilles de Rais [7] », et où, pourrait-on ajouter, il a exercé son œil et, ensemble, son imagination. « Randonneur casanier, itinérant hexagonal » pour Régis Debray, « Gracq, qui a peu voyagé », du moins de par le monde, « mais beaucoup regardé, s’est limité à faire et refaire le tour du propriétaire de son bocage natal, des pays de l’Ouest et de la Loire – compte non tenu de quelques raids au Farghestan [8] occidental, Angleterre, Espagne, États-Unis [9]. » L’incipit des Eaux étroites dit bien quelle sorte d’arpenteur fut Gracq : « si le voyage seul – le voyage sans idée de retour – ouvre pour nous les portes et peut changer vraiment la vie, un sortilège plus caché, qui s’apparente au maniement de la baguette de sourcier, se lie à la promenade entre toutes préférée, à l’excursion sans aventure et sans imprévu qui nous ramène en quelques heures à notre point d’attache, à la clôture de la maison familière [10] ».
Enfant, le petit Louis robinsonne sur une île mystérieuse, celle qui s’étend en face de la maison, l’île Batailleuse, où il rejoue ses lectures de Jules Verne. De l’aveu même de Poirier devenu Gracq, c’est dans cette « passion d’enfance », Jules Verne, qu’il faut rechercher son goût pour la géographie, même s’il a « eu assez vite le goût de regarder les paysages », au point que, dans les trains, « il était difficile de [le] décoller de la vitre du wagon » [11]. L’œuvre de Verne était pour lui, confia-t-il, « une espèce de Livre des Merveilles [12] ». De ces Voyages extraordinaires il donne toutefois l’impression d’avoir moins aimé les paysages que d’avoir rapporté le désir d’objets fétiches, comme un boomerang ou surtout, « dans Mathias Sandorf…, la grille, qui permet de crypter un message [13] ». C’est que le petit Louis a « toujours eu le goût des cryptogrammes, des clés qui permettent de déchiffrer un message obscur [14] ». Ce qui lui plaît chez Verne, c’est autant qu’il ait « annexé la “face de la Terre” au roman [15] » que son goût du mystère, du merveilleux et le parfum d’une magie qui ne va pas sans nécessiter une initiation. En la matière, le père de Louis, Emmanuel, tient lieu, au même titre que Verne, de grand prêtre : « Si j’ai quelque penchant pour la poésie, et souvent pour celle qui monte de la Terre, c’est de mon père que je le tiens [16]. » Une Terre qui se révèle donc parsemée de signes et qu’on ne peut déchiffrer sans clé de lecture…
Cartes sur table
Ce « goût du cryptogramme », s’il l’a « pris dans Jules Verne », le petit Louis le satisfait aussi bien, faute de se « mettre sous la dent » aucun des Voyages extraordinaires ou « aucun Fenimore Cooper », au fil des pages d'un « guide Michelin périmé » dans lequel il lui « arrive de [se] laisser entraîner une heure ou deux, à regarder, à comparer, à superposer en imagination comme des calques les feuilles roses des plans de villes [17] ». Une fois devenu géographe, il reportera ce goût sur « la carte géographique qui est d’ordre scientifique » [18] dans laquelle il voit une sorte de « sésame qui permettrait de comprendre comment les choses s’enchaînent dans le relief [19] », rendant ainsi possible la « révélation » : « la carte géologique me donnait l’impression d’être une espèce de clé magique qui permettrait de déchiffrer les formes du terrain, une clé que les autres n’avaient pas et que j’avais l’impression de posséder » [20]. Cette façon d’enchanter la carte n’est paradoxalement pas incompatible, à ses yeux, avec « le côté concret de la géographie » qui l’« attirait beaucoup » [21].
Après des études secondaires au lycée Clemenceau de Nantes et une khâgne à Henri-IV à Paris, il intègre l’École normale supérieure et, en 1934, est reçu cinquième à l’agrégation d’histoire et géographie – plus pour celle-ci que pour celle-là, on l’aura compris. L’année précédente, il avait décroché son diplôme d’études supérieures en géographie. Son mémoire, « La morphologie du Saumurois et des Mauges » (la rue du Grenier-à-Sel, toujours…), il le rédige sous la direction d’Emmanuel de Martonne (1873-1955), lui-même élève et gendre du père de la géographie physique, Paul Vidal de La Blache (1845-1918). Martonne restera son maître : « C’est [lui] qui m’a appris à voir un paysage, d’une manière non pas impressionniste, mais je dirais plutôt cézanienne, dans ses masses, sa structure, son style de relief, son articulation [22] », là où Jules Verne restait « paysagiste, et paysagiste impressionniste », en l’occurrence, incapable de saisir « les structures » de ses « cartes imaginaires » qui présentent « de sérieuses invraisemblances […] sur le relief littoral, par exemple », où « la disposition des caps et des plages n’est pas toujours très rationnelle » [23]. Pareil à la lecture de Jules Verne cependant, l’enseignement de Martonne est nimbé du charme des rites initiatiques, comme lorsque le maître et « le petit troupeau de ses vrais fidèles [24] » partent en excursion du côté de Meulan gratter quelque affleurement de marnes sannoisiennes : « Le sentiment d’appartenance à un petit groupe, aux rites particuliers, devait renforcer cette attractivité [25] » pour une discipline qui s’emploie à décrypter les paysages au moyen de ces grilles que sont les courbes de niveau des cartes, de préférence « au 80 000e, la carte d’état-major, qui est particulièrement expressive en ce qui concerne les formes du terrain [26] ». Expressive : le mot, par sa polysémie, n’est pas innocent.
De ses premiers travaux de recherche, Poirier tire deux articles qui seront publiés en 1934 et 1935 par Martonne dans les Annales de géographie. Et déjà Julien Gracq perçait sous Louis Poirier :
« Entre ces bois, la Plaine s’étend toute plate, à peine creusée par les ondulations légères des chepseaux » ;
« çà et là seulement, un gros village aux murs blancs de tuffeau et aux toits d’ardoise se montre de loin, souvent posé à la corne d’un bois, entre les bois, les vignes, les champs et les prés tout proches des bas-fonds » ;
« Ce qu’on appelle “un bois” dans le Bocage ne mériterait pas ce nom dans la Plaine : c’est généralement quelque misérable taillis de châtaigniers » [27] ;
« Au printemps les chemins creux des Mauges se parent de fleurs blanches éclatantes : c’est le seul moment de joie de cette contrée sévère » ;
« Derrière ces haies, sous des bouquets d’arbres, se cachent les maisons isolées, les fermes au toit de tuiles rouges » [28]…
N’était un don d’écriture, il est vrai qu’à l’époque où Poirier est formé, « le géographe garde le goût de la description et du beau style [29] » : dans ces pages, un village « se montre », des maisons « se cachent », des taillis peuvent être jugés « misérables » et des « fleurs blanches éclatantes » être une promesse de « joie ». De la description géographique Gracq se souviendra chaque fois qu’il recherchera le mot juste, fût-il technique et paré, pour l’occasion, de l’italique, comme ces « chepseaux » de son premier article de géographe. Rien de très différent dans l’œuvre de l’écrivain, par exemple dans La Maison : « ce n’était guère que ce qu’on eût appelé en Poitou une brande ; une étendue confuse de taillis maigres de chênes et de châtaigniers [30] » ; ou bien à propos du pays de Retz, dans Nœuds de vie : « La campagne ici avec ses vallons et ses collines est tranchée net par la mer ; il n’y a pas de transition ; jusqu’au bord même des étroites platures brunes qui se découvrent au reflux grimpent et descendent sans paraître lui prêter attention les chemins montueux et terreux du Bocage, enclos d’aubépines et de ronciers à mûres [31]. »
Jean-Louis Tissier a bien mis en évidence les procédés que le géographe transpose dans la prose de l’écrivain : le lexique (surtout la terminologie morphologique), souvent imprimé en italique, donc, comme « une forme d’excuse [32] » ; la position de surplomb du guetteur [33], celle que l’on adopte depuis un château fort, comme à Argol qui « se dressait à l’extrémité [d’un] éperon rocheux [34] », comme sur les remparts d’Orsenna où le « coup d’œil », « du haut de la tour des signaux, plongeait sur la “base des Syrtes” [35] », ou comme depuis un balcon en forêt ; enfin le « parti pris de généralisation [36] » dont témoigne par exemple l’usage des majuscules dans l’orthographe des mots « Bocage » et « Plaine ».
Comment Louis Poirier devient Julien Gracq
Au mitan des années 1930, toutefois, l’heure de Julien Gracq n’a pas encore sonné : Louis Poirier commence une carrière dans l’enseignement et pense même un instant à se lancer dans la recherche. Démobilisé du service militaire à la fin de septembre 1935, il est nommé professeur d’histoire au lycée de Nantes où il enseignera d’octobre 1935 à juillet 1936, concevant le projet d’une thèse, sur la Crimée, toujours sous la direction de Martonne.
C’est pendant l’été 1937, avant d’être muté pour la rentrée au lycée de Quimper où il restera jusqu’en 1939, qu’il rédige Au château d’Argol, refusé au début de 1938 par la NRF et finalement publié en janvier 1939 chez José Corti, à semi-compte d’auteur et sous pseudonyme. Rétrospectivement, Julien Gracq dira de ce livre qu’il « est un peu une liquidation […] de beaucoup de lectures [37] » ; mais, après l’enthousiasme dont Breton lui fait part dans une lettre du 13 mai 1939, il est bien l’acte de baptême de Julien Gracq, qui évoluera avec son double Poirier dans un espace-temps parallèle.
Ce double à l’état civil, après un passage subreptice à Amiens, rejoint le lycée d’Angers en 1941, où il reste en poste de novembre à juillet de l’année suivante. À la rentrée de 1942, il est nommé au lycée Marcelin-Berthelot à Saint-Maur, près de Paris, où il ne restera qu’un mois, car le démon de la géographie le tente encore : lorsque, à la fin d’octobre, Martonne lui propose le poste d’assistant temporaire de géographie tout juste ouvert à l’université de Caen, il nourrit encore l’ambition de rédiger une thèse, mais portant cette fois-ci, pour des raisons régionales, sur la « morphologie de la Basse-Normandie ». Il enseigne à Caen jusqu’en 1946, mais, abandonnant toute ambition universitaire, obtient une mutation en 1947 au lycée Claude-Bernard à Paris, où il restera jusqu’à sa retraite, le 29 juin 1970 [38].
Entre 1934 et 1947, Louis Poirier aura eu le temps, comme géographe, de publier quelques articles scientifiques et des notes de lecture [39], ainsi qu’une recension parue dans la revue Critique et portant sur deux ouvrages posthumes d’Albert Demangeon (1872-1940) [40]. Après cette date, l’écriture scientifique, chez lui, cède définitivement le pas à l’écriture littéraire.
Des yeux neufs
Pourtant, Poirier a aimé la recherche en géographie, notamment pour sa verdeur : la discipline « commençait, elle n’avait presque pas d’ancêtres, on lisait les contemporains. Elle était en train de se faire. Je suis content d’avoir étudié la géographie à ce moment où l’on pouvait encore, un peu superficiellement, tout saisir ensemble [41] ». Mais son dernier article, portant sur « L’évolution de la géographie humaine », sonne rétrospectivement comme un adieu et prend la mesure des changements épistémologiques à l’œuvre dans une discipline qui bientôt ne le concerna plus.
Albert Demangeon a, selon lui, engagé le « mouvement d’évolution accélérée qui a été celui de la géographie humaine depuis l’époque encore toute proche où une discipline nouvelle est sortie définitivement des limbes [42] ». Le temps est désormais loin où « la géographie humaine », « née, dans la première moitié du xixe siècle, en liaison étroite avec des préoccupations de naturaliste », était fille de « la géographie botanique – de l’écologie » [43], illustrée par Humboldt, et se voulait « l’étude des rapports de l’homme avec le milieu physique », fût-ce en établissant une « subordination étroite de l’homme à la nature », une « soumission aveugle aux conditions de relief et de climat selon des lois naturelles », au risque d’un « déterminisme rigide » [44]. En somme, pour ce géographe-là, la formule était vraie selon laquelle « l’histoire des hommes est écrite sur la carte ». Le disciple de Martonne enfonce le clou : « on peut dire que c’est bien encore une conclusion de ce genre que suggère – sans la formuler – [la] puissante démonstration » [45] de Vidal de La Blache. Dans une telle perspective, l’initié qui possédait la clé de lecture pour lire une carte prétendait comprendre les raisons de l’implantation des hommes sur tel ou tel territoire.
Or, tout a changé, et Poirier reconnaît à Demangeon le mérite d’avoir mis en lumière « les apports enchevêtrés que dans un pays de vieille civilisation tel que la France ont laissé sur le sol des successions de générations industrieuses, l’importance fondamentale pour la vie des hommes des apports de ce “quaternaire historique” dont les strates se lisent dans les piles d’archives [46] ». Partant, l’axiome des lois naturelles se trouve désormais supplanté par celui selon lequel « il n’y a pas pour l’homme de milieu physique pur [47] » : « le milieu géographique », c’est, pour Demangeon, « la nature continûment colmatée par le sédiment historique » [48]. Si la géographie humaine doit se renouveler, c’est en entretenant une « relation de plus en plus serrée […] avec les techniques, à travers lesquelles une nécessité seconde, une nécessité forgée par l’homme se substitue à l’ancienne dépendance par rapport au sol [49] ». Avec plus d’un demi-siècle d’avance [50], on ne saurait mieux définir une géographie de l’Anthropocène qui tienne compte du rôle géologique que joue l’homme augmenté, lequel, malgré les rappels à l’ordre de sa dépendance au milieu physique, nourrit plus que jamais l’ambition de s’arracher aux conditions naturelles par la technique, soit géoingénierie, soit transhumanisme.
De l’avance certes, surtout quand Poirier conclut son propos en soulignant combien « l’homme devenu démiurge semble échapper aux déterminations jusque-là contraignantes – vaguer en liberté dans un monde qu’il est en mesure de retailler à sa fantaisie », « un monde où la seule intelligence de l’homme, génératrice de techniques qui à leur tour l’embrigadent collectivement sans merci, substituera une fatalité créée aux anciennes déterminations du milieu » [51]. Encore géographe dans l’âme, Poirier veut croire qu’« il sera passionnant de voir la géographie humaine adapter ses méthodes à un monde pour lequel elle devra se refaire des yeux neufs [52] ». Mais ses yeux à lui, il le sait, sont déjà ceux de Julien Gracq.
Lieux et milieux
L’auteur d’Un beau ténébreux, à cette date, a déjà opéré sa mue et commencé à pratiquer, plus qu’« une simple transposition littéraire de thèmes géographiques [53] », un « transfert du domaine universitaire au domaine littéraire [54] ». Même si « dans les premières œuvres […], les références géographiques sont rares [parce qu’il] semble qu’un temps de décantation ait été nécessaire pour faire de ce savoir géographique un matériau littéraire utile [55] », le « sens des paysages » de Gracq apparaîtra aigu « dans les récits et dans les fragments des Lettrines [56] », après s’être manifesté dans le comportement de protagonistes qui ressemblent au géographe qu’il était, mis en scène « à plusieurs reprises devant une carte », « le plus souvent envisagée comme un objet attirant, un ensemble de symboles à déchiffrer et à investir [57] » – Aldo dans la « chambre des cartes » du Rivage des Syrtes, ou bien les personnages d’Un balcon en forêt et de La Presqu’île.
Armé des outils du géographe, Gracq s’emploie à renouveler la tradition littéraire de la description [58] : « Quand on est géographe », explique-t-il, « on voit la physionomie d’un paysage, c’est-à-dire qu’on dégage très rapidement les traits qui sont concordants et qui donnent aux paysages un style particulier. Je pense que cela se voit dans mes livres [59] ». De fait, dans ses livres, « la description n’est ni pure sensibilité, ni simple constat, elle est déjà explicative. Le paysage est envisagé comme un ensemble de signes qui concourent à une même signification [60] ». Paradoxalement, ici, « la culture géographique n’est pas dépoétisante [61] » ; au contraire : elle confère au paysage rang non « d’objet mais de sujet », lequel, grâce à elle, devient « l’englobant, qui déteint et imprègne, non un supplément d’âme ni un complément d’information » [62].
Puisque le géographe a dû renoncer au « schéma imaginatif [63] » hérité de ses maîtres, c’est à l’écrivain que revient la charge de le prendre à son compte pour réimplanter l’homme dans des lieux qui lui soient des milieux, et ainsi le rappeler à ce qui l’y relie, quand les technologies dressent littéralement des écrans entre lui et le monde : « Le personnage [chez] Gracq est inséparable d’un milieu avec lequel il entretient de multiples relations. Ce milieu est avant tout un milieu naturel et Gracq déplore à plusieurs reprises que la littérature française de l’après-guerre privilégie la relation sociale, en quelque sorte, déracine le personnage [64] ». Il n’est d’ailleurs pas indifférent que ses romans soient « délibérément non urbains » : « il faut souligner cette singularité quand la littérature, avant les années 1970, n’avait pas été contaminée par la mode écologique » [65] et alors que « le roman, la littérature ne s’occupaient pas du tout des campagnes, qui faisaient partie d’un monde à moitié sauvage [66] ».
Gracq, une fois abandonné le genre du roman, n’en prendra pas moins souci de la ville, et ce, à deux reprises, soit exercice de réenchantement comme dans La Forme d’une ville – où Nantes « finit par symboliser l’espace même de la liberté [67] » –, soit plaisir aristocratique de la distinction comme dans Autour des sept collines – où Gracq ne se montre pas « tout à fait conquis par Rome [68] », « ville parasite, assistée [69] ». Dans les deux cas, paysages encore, quoique paysages urbains, où se relier au milieu, c’est habiter. « Les villes [sont] faites pour être habitées [70] », et « habiter une ville, c’est y tisser par ses allées et venues journalières un lacis de parcours [71] », bref, y déambuler en projetant « nos perceptions, nos souvenirs, nos désirs et nos rêves [72] ». Impossible à Rome, « ghetto sacralisé par le glacial enregistrement muséal, à jamais privé de toute irradiation imaginative [73] » où les habitants semblent des « sinistrés qu’on reloge dans un castel en déshérence ou une abbaye désaffectée [74] ». A l’inverse, Nantes dégage « une présence incubatrice, une chaleur enveloppante [75] ». Elle est un « humus urbain [76] » où la « symbiose » entre homme et lieu a pu si bien opérer qu’on se retrouve « plongé corps et âme dans un élément beaucoup plus concret […] que celui auquel on applique d’habitude le nom de milieu » [77].
La plante humaine
C’est donc dans l’ordre de la littérature que « Julien Gracq a reconstruit pour nous ce qu’il appelait une “pure écologie de l’homme”, quelque chose que la géo ne pouvait plus être et que seule la littérature pouvait encore assurer [78] » – même si la géographie est peut-être en train de renouer, de nos jours, avec le « schéma imaginatif » de ses premiers temps « en raison du changement de paradigme (comme dit l’université), qui ne vient plus de la mécanique mais de la biologie », et parce que, « depuis qu’il est question de biosphère, l’aura salvatrice s’est reportée de l’ingénieur sur le jardinier » [79]. Si tel est le cas, alors les géographes de demain devraient tirer profit de la qualité de regard que Gracq jette sur le monde, car cette qualité lui vient tout droit, quoique cristallisée et comme chimiquement précipitée, des origines de la géographie.
Oui, géographe, Julien Gracq l’est resté, malgré Louis Poirier, et en cela fidèle à une géographie d’inspiration botanique (donc à une écologie) à la Humboldt. Est-ce un hasard si, après que, dans son article de 1947, Louis Poirier eut rappelé que, selon une telle géographie, les « “colonies humaines” [sont] fondamentalement analogues aux colonies des plantes », Julien Gracq, à peine quinze ans plus tard, célèbre le « mariage d’inclination autant et plus que de nécessité, mariage tout de même confiant, indissoluble qui se scelle chaque jour et à chaque minute entre l’homme et le monde qui le porte, et qui fonde ce que j’ai appelé pour ma part la plante humaine [80] » ?
Notes
[1] J. Gracq, Lettrines, Paris, José Corti, 1967, p. 148.
[2] « Entretien avec Jean-Louis Tissier (1978) », in J. Gracq, Entretiens, Paris, José Corti, 2002, p. 24.
[3] Pour ces détails, voir R. Aïm, Julien Gracq, prix Goncourt 1951. Histoire d’un refus, Joué-les-Tours, Éditions La Simarre, 2020, p. 12-15.
[4] Anecdote rapportée par R. Matignon et citée ibid., p. 15. Louis Poirier ajoutait toutefois, bienveillant : « Repassez à la fin de l’année, lorsque les cours seront finis. Je vous signerai votre exemplaire bien volontiers. »
[5] J. Gracq, La Maison, Paris, José Corti, 2023, p. 9-10.
[6] Par exemple J. Garcin, qui raconte sa visite in Littérature vagabonde, Paris, Flammarion, 1995 ; rééd. 2009, p. 35-46.
[7] J. Gracq, Carnets du grand chemin, Paris, José Corti, 1992, p. 138.
[8] Allusion au territoire imaginaire en guerre larvée contre la seigneurie d’Orsenna dans Le Rivage des Syrtes.
[9] R. Debray, « Gracq, ou la leçon de géographie », Médium, no 31, 2012/2, p. 44 ; même si la concession n’est pas superflue : « Gracq a traversé l’Europe », rappelle justement J. Garcin (in Littérature vagabonde, op. cit., p. 39), et a fait des « voyages de géographe souvent, sensible aux formes de la terre, mais tout autant voyages de l’écrivain suivant la pente de son imagination » (B. Boie, « Chronologie », in J. Gracq, Œuvres complètes I, éd. B. Boie, Paris, Gallimard, « Bibliothèque de la Pléiade », 1989 ; rééd. 2011, p. lxxviii).
[10] J. Gracq, Les Eaux étroites, Paris, José Corti, 1977, p. 9.
[11] J. Gracq, Entretiens, Paris, José Corti, 2002, p. 14.
[12] Ibid., p. 13 ; l’édition José Corti ne compose pas l’expression en italique, bien que la référence à Marco Polo soit évidente ; le volume de la « Bibliothèque de la Pléiade » compose l’expression sans capitales et avec un bourdon (« livre de merveilles »), ce qui déforme légèrement le propos (éd. citée, p. lxvi).
[13] J. Gracq et alii, Jules Verne aujourd’hui. Conversations avec J.-P. Dekiss, Paris, Éditions Le Pommier, 2013, p. 17.
[14] J. Gracq, Entretiens, op. cit., p. 14.
[15] J. Gracq et alii, Jules Verne aujourd’hui, op. cit., p. 70 ; l’expression entre guillemets est une allusion à Eduard Suess (1831-1914), l’un des pionniers de l’écologie.
[16] J. Gracq, Lettrines II, in Œuvres complètes II, éd. B. Boie, Paris, Gallimard, « Bibliothèque de la Pléiade », 1995, p. 351.
[17] J. Gracq, La Forme d’une ville, Paris, José Corti, 1985, p. 18-19.
[18] J. Gracq et alii, Jules Verne aujourd’hui, op. cit., p. 17.
[19] Ibid., p. 66.
[20] J. Gracq, Entretiens, op. cit., p. 14.
[21] Ibid. ; à l’origine, dans l’article de J.-L. Tissier, le propos est plutôt rapporté ainsi : « j’ai toujours eu le goût du concret » (J.-L. Tissier, « De l’esprit géographique dans l’œuvre de Julien Gracq », Espace géographique, t. X, no 1, 1981, p. 57b), formulation sans doute corrigée par Gracq lui-même pour l’édition dans le volume d’Entretiens.
[22] Entretien avec Ch. Jannoud, Le Figaro littéraire, 10 février 1973.
[23] J. Gracq et alii, Jules Verne aujourd’hui, op. cit., p. 67.
[24] J. Gracq, Lettrines II, in éd. citée, p. 341.
[25] J.-L. Tissier, « De l’esprit géographique dans l’œuvre de Julien Gracq », art. cité, p. 57b.
[26] J. Gracq, Entretiens, op. cit., p. 17.
[27] L. Poirier, « Bocage et Plaine dans le sud de l’Anjou », Annales de géographie, vol. 43, no 241, 1934, p. 22.
[28] Ibid., p. 23.
[29] J.-L. Tissier, « De l’esprit géographique dans l’œuvre de Julien Gracq », art. cité, p. 58b.
[30] J. Gracq, La Maison, op. cit., p. 8.
[31] J. Gracq, Nœuds de vie, Paris, José Corti, 2021, p. 31.
[32] J.-L. Tissier, « De l’esprit géographique dans l’œuvre de Julien Gracq », art. cité, p. 54a.
[33] Selon J.-L. Tissier, « de tradition, le point haut est le lieu éminent où se réalise de manière concrète le travail géographique » (ibid., p. 54a).
[34] J. Gracq, Au château d’Argol, in Œuvres complètes I, éd. citée, p. 10.
[35] J. Gracq, Le Rivage des Syrtes, ibid., p. 570.
[36] J.-L. Tissier, « De l’esprit géographique dans l’œuvre de Julien Gracq », art. cité, p. 54b.
[37] J. Gracq et alii, Jules Verne aujourd’hui, op. cit., p. 97.
[38] Pour la chronologie détaillée, voir B. Boie, « Chronologie », in J. Gracq, Œuvres complètes I, éd. citée, p. lix sq.
[39] Par exemple L. Poirier, « La mise en valeur du Soudan français », Annales de géographie, vol. 43, no 245, 1934, p. 560 ; « Les projets de grands travaux de canalisation en Finlande et en Russie », Annales de géographie, vol. 44, no 252, 1935, p. 652-654 ; « Le dépeuplement des régions montagneuses en Italie », ibid., p. 656 ; « Essai sur la morphologie de l’Anjou méridional (Mauges et Saumurois) », Annales de géographie, vol. 44, no 251, 1935, p. 474-491 ; « Un essai d’interprétation du réseau hydrographique de la Basse-Normandie », Bulletin de l’association de géographes français, 1946, no 175-176, p. 12-23.
[40] A. Demangeon, Problèmes de géographie humaine, Paris, Armand Colin, 1942, et La France. Géographie économique et humaine, in P. Vidal de La Blache et L. Gallois (dir.), Géographie universelle, Paris, Armand Colin, t. VI, 2e et 3e vol., 1946 et 1948.
[41] J. Gracq, Entretiens, op. cit., p. 16.
[42] L. Poirier, « L’évolution de la géographie humaine », Critique, no 8-9, janv.-févr. 1947, p. 86.
[43] Ibid., p. 86.
[44] Ibid., p. 87 ; souligné dans le texte.
[45] Ibid.
[46] Ibid., p. 88.
[47] Ibid. ; souligné dans le texte.
[48] Ibid., p. 89 ; souligné dans le texte.
[49] Ibid., p. 93.
[50] Régis Debray évoque le « très perspicace et prophétique article de la revue Critique, en 1947, […] où il parle expressément d’une écologie de l’homme et même d’une écologie dynamique » (in « Gracq, ou la leçon de géographie », art. cité, p. 34).
[51] L. Poirier, « L’évolution de la géographie humaine », art. cité, p. 94.
[52] Ibid.
[53] J.-L. Tissier, « De l’esprit géographique dans l’œuvre de Julien Gracq », art. cité, p. 51a.
[54] Ibid., p. 57a.
[55] Ibid., p. 53b.
[56] Ibid., p. 51b.
[57] Ibid., p. 55a.
[58] Voir ibid., p. 54a.
[59] Cité ibid., p. 54b, note 4.
[60] Ibid., p. 54b.
[61] Ibid., p. 59b.
[62] R. Debray, « Gracq, ou la leçon de géographie », art. cité, p. 35.
[63] L. Poirier, « L’évolution de la géographie humaine », art. cité, p. 87.
[64] J.-L. Tissier, « De l’esprit géographique dans l’œuvre de Julien Gracq », art. cité, p. 55b.
[65] Ibid., p. 55b.
[66] J. Gracq et alii, Jules Verne aujourd’hui, op. cit., p. 94.
[67] J. Gracq, La Forme d’une ville, op. cit., p. 5.
[68] J. Gracq, Autour des sept collines, Paris, José Corti, 1988, p. 10.
[69] Ibid., p. 59.
[70] Ibid., p. 9.
[71] J. Gracq, La Forme d’une ville, op. cit., p. 2.
[72] Bernard Vouilloux, En lisant Julien Gracq. La Littérature habitable, Paris, Hermann, 2007, cité in Matthias Fougerouse, « Pour une littérature habitable », Acta fabula, vol. 9, no 2, févr. 2008, p. 6.
[73] J. Gracq, Autour des sept collines, op. cit., p. 117.
[74] Ibid., p. 58.
[75] J. Gracq, La Forme d’une ville, op. cit., p. 211.
[76] Ibid., p. 203.
[77] Ibid., p. 198.
[78] M. Murat, « “Tout cela se passait dans des temps très anciens” : Julien Gracq et les mutations du monde rural », p. 4 ; en ligne : https://www.geographie.ens.psl.eu/IMG/Michel%20Murat.pdf
[79] R. Debray, « Gracq, ou la leçon de géographie », art. cité, p. 37.
[80] J. Gracq, Préférences, in Œuvres complètes I, éd. citée, p. 879.