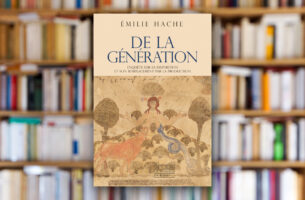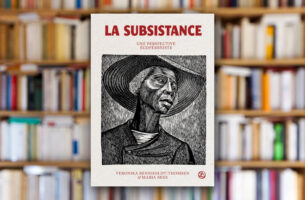Introduction
1983. Dix ans après la parution — en feuilleton dans le journal le Monde — de son essai Énergie et équité, Ivan Illich, explore à nouveau, lors d’un séminaire au Colegio de Mexico, le concept d’énergie — à distinguer du symbole « E » — dans ses intrications avec le concept de travail et dans la perspective de sa géo-histoire des besoins. « Aujourd’hui, l’énergie a détrôné le travail en tant que symbole de ce dont les individus et les sociétés ont besoin. C’est un symbole qui va comme un gant à notre époque : celui de tout ce qui est à la fois abondant et rare », écrit-il alors. N’est-ce pas encore plus vrai de nos jours, 20 ans après sa mort (le 2 décembre 2002), alors que la sobriété et le rationnement énergétiques sont de rigueur.
Il y a peu en commun entre le symbole « E » qu’utilise le physicien et l’« énergie », quand ce mot est utilisé par un économiste, un politicien ou un passionné de moulins à vent. « E » est un algorithme, « énergie », un mot chargé de sens. « E » n’a de sens que dans une formule, le mot « énergie » est lourd d’implications cachées : il renvoie à un subtil « quelque chose » qui a la capacité de mettre la nature au travail. C’est quand il parle à ses clients que l’ingénieur dont la routine consiste à s’occuper de mégawatts prononce le mot « énergie ». Aujourd’hui, l’énergie a détrôné le travail en tant que symbole de ce dont les individus et les sociétés ont besoin. C’est un symbole qui va comme un gant à notre époque : celui de tout ce qui est à la fois abondant et rare.
« Aujourd’hui, l’énergie a détrôné le travail en tant que symbole de ce dont les individus et les sociétés ont besoin. C’est un symbole qui va comme un gant à notre époque : celui de tout ce qui est à la fois abondant et rare. »
« E », la notion théorique et « énergie », la construction sociale, sont toutefois nés comme des frères siamois. À la fin du XIXe siècle, vieux de cinquante ans déjà, séparés, ils étaient devenus des sosies antagoniques. « E » avait mûri dans ces serres de la science que sont les labos. Chaque nouvelle pirouette qu’il avait appris à faire, chaque nouveau tour étaient soigneusement contrôlés et enregistrés. C’était devenu un symbole dont les règles gouvernant l’usage étaient devenues la théorie. Selon les mots d’Einstein, il faisait partie de « la théorie qui décide ce que voit le physicien ». Mais dans le même temps, son jumeau, « énergie », avait été élevé au trône du Tout-Puissant tout en devenant la métaphore de ce que l’on désigne actuellement par le terme de « besoins fondamentaux ». « E » était devenu abstrait au-delà de toute expression, alors qu’« énergie » devenait ce quelque chose de mystérieux et trivial, indigne ou plutôt exempté de tout examen. Aujourd’hui, ces jumeaux que leur histoire a aliénés l’un à l’autre donnent lieu à deux types de discours qu’il est de plus en plus illusoire de vouloir traduire l’un dans l’autre.
Le régime de la rareté
Loin de moi le désir d’ajouter un iota aux connaissances sur « E ». Je ne prétends pas davantage traiter de l’énergie « libre » et « liée », dont les flux devinrent pour Freud la base de la sexualité, thème qui mériterait un autre essai. Mon propos n’est pas non plus de commenter les tentatives d’interprétation du « fonctionnement » de l’ordre social en termes de thermodynamique, comme l’a fait Georgescu-Roegen. Je ne traiterai pas davantage de ces auteurs qui, inspirés par Ostwald, ont voulu compléter l’histoire économique par une énergétique historique. Dans les années 1950, Leslie White, précédant les mystiques de l’énergie contemporains, a décrété que tout progrès reflète la capacité d’une société de s’approprier l’énergie. Pour moi, l’interprétation de l’économie comme un cas spécial de la thermodynamique, celle de la société comme un système d’échanges énergétiques autorégulés ou celle de l’évolution sociale comme un contrôle croissant des flux d’énergie sont des analogies séduisantes mais boiteuses. La raison pour laquelle je m’intéresse à l’histoire de l’« énergie » est différente de celles qui sous-tendent toutes ces tentatives. Je découvre pour ma part, sous l’émergence de ce symbole verbal, le moyen par lequel la nature a été réinterprétée comme un domaine gouverné par l’axiome de la rareté et les êtres humains redéfinis comme ses clients aux besoins sans cesse croissants.
« Je découvre pour ma part, sous l’émergence de ce symbole verbal, le moyen par lequel la nature a été réinterprétée comme un domaine gouverné par l’axiome de la rareté et les êtres humains redéfinis comme ses clients aux besoins sans cesse croissants. »
Une fois l’univers entier soumis au régime de la rareté, homo ne naît plus sous les étoiles mais sous les axiomes de l’économie. Pour mener à bien mon projet, je devrai examiner les racines sémantiques du terme « énergie » et rendre compte de la transformation grotesque du sens de « vigueur humaine » qui fut le sien à celui de « capital de la nature ». En grec, le mot energeia est fort et fréquent. Il peut être rendu en français par « en devenir », avec toutes les nuances propres à cette expression. Dans sa version latine, in actu, le terme est d’importance centrale en philosophie médiévale, car il a le sens de forme, perfection, acte, par opposition à la simple possibilité. Dans sa version anglaise, le mot apparaît pour la première fois au XVIe siècle. À l’époque de la première reine Élizabeth, energy dénote la force expressive d’une personne et la qualité de sa présence. Un siècle plus tard, le mot peut qualifier une force d’impact impersonnelle, comme le pouvoir de conviction d’un argument ou la capacité qu’a la musique d’église de produire un effet sur l’âme. La portée du terme se limite encore strictement aux effets psychiques engendrés par une personne ou par une chose.
La vis viva
C’est au cours du XVIIe siècle que le projet de quantifier les forces de la nature s’est fait jour. Leibniz parla d’une grandeur qui demeure semblable à elle-même quoi qu’il arrive, « comme la monnaie, quand elle est changée ». La vis viva, force vive de l’univers, devint une quantité de mouvement que certains voulaient désigner par m·v, d’autres par m·v². Au cours du siècle suivant, la notion de quantité de mouvement devint un concept important pour les philosophes de la nature qui tentaient de rendre compte de phénomènes mécaniques de collision, de tension des ressorts ou de « force » de billes en mouvement. Chacune des langues européennes s’enrichit alors de termes techniques désignant les différents types de « force » et d’« efficacité » observés et rendus de diverses manières par les expressions m.v, m.v2, ½m.v2. En 1807, Thomas Young nomma energy la notion antérieurement appelée vis viva. Il écrivit que ce terme pouvait être appliqué avec justesse au produit d’une masse par le carré de sa vitesse. Paradoxalement, c’est au moment où toutes les sciences naturelles commençaient à nier systématiquement la vitalité de la nature, sa Lebenskraft, que le terme « énergie », utilisé au cours des trois siècles précédents pour désigner la force expressive d’un visage ou la vivacité d’une affirmation, fut appliqué aux « forces de la nature ». Mais il fallut attendre quarante ans pour qu’il soit adopté par la terminologie de la physique pour désigner – en contraste avec la définition de Young – un « quelque chose » devant être distingué d’une force. En physique moderne, l’énergie se distingue de la force comme une intégrale de sa fonction.
« Paradoxalement, c’est au moment où toutes les sciences naturelles commençaient à nier systématiquement la vitalité de la nature, sa Lebenskraft, que le terme « énergie », utilisé au cours des trois siècles précédents pour désigner la force expressive d’un visage ou la vivacité d’une affirmation, fut appliqué aux forces de la nature. »
C’est cette distinction qui permit l’essor d’« énergie ». Auparavant, tant que la nature pouvait être appelée « mère », un tel concept ne lui avait jamais été attribué.
Mais, selon les mots de Justus Liebig, en 1844, la nature était devenue la « matrice » de diverses « forces », telles que l’électricité, la chaleur, la lumière, le magnétisme qui, toutes, pouvaient être mesurées en unités de travail. Ce glissement sémantique ressemble étrangement à un autre glissement, prenant place, celui-ci, dans le langage de l’obstétrique. Jusqu’au début du XVIIIe siècle, c’étaient les femmes qui mettaient au monde les enfants, assistées par des sages-femmes. Après 1820, une sorte de bio-ingénieur, le gynécologue, put se targuer d’extraire l’enfant de la matrice, et cet enfant sera destiné à rejoindre la masse laborieuse.
Le potentiel de travail
Durant la première moitié du XIXe siècle, la physique élabora une idée apparentée à celle de force de travail : les valeurs équivalentes et mesurables des quantités de chaleur, d’électricité et de mouvement mécanique. Un Anglais fit bouillir de l’eau en perforant un cylindre de métal pour en faire un canon et démontra l’existence d’un lien entre la pression de la vapeur produite et l’effort physique du cheval faisant tourner le foret. Un autre frotta l’un contre l’autre deux blocs de glace que la chaleur de friction fit fondre et mit la quantité d’eau obtenue en relation avec l’effort fourni. La quête d’une sorte « d’étalon-or » de la nature conduisit à un nouveau style de métaphysique expérimentale consistant à obtenir en laboratoire la preuve de l’existence d’entités qui ne peuvent pas être observées. Le postulat d’existence de quelque chose de constant qui ne ferait que changer d’apparence selon des modalités observées et mesurées avec une précision croissante devint le fondement de la nouvelle mythologie scientifique.
« Le postulat d’existence de quelque chose de constant qui ne ferait que changer d’apparence selon des modalités observées et mesurées avec une précision croissante devint le fondement de la nouvelle mythologie scientifique. »
En dépit du fait que personne, évidemment, ne l’avait jamais observé – et de ce que, durant au moins dix ans, il n’y eut pas d’accord sur le nom qu’il fallait lui donner –, Mayer (1842), Helmholtz (1847), Thomson (le futur Lord Kelvin) et bien d’autres, travaillant indépendamment les uns les autres, définirent ce « quelque chose » comme la capacité de la nature d’effectuer un travail. Le « travail », au cours des cinq ans séparant la « découverte » de Mayer de celle de Helmholtz était devenu une magnitude physique, et l’énergie, sa source. Le travail était défini comme la production d’un changement physique, et l’énergie, comme sa cause méta-physique.
« Le travail était défini comme la production d’un changement physique, et l’énergie, comme sa cause méta-physique. »
Il est significatif de rappeler que durant le deuxième quart du XIXe siècle, le même mythe scientifique trouva son expression dans trois images différentes : la matrice, devenue la source de la vie, l’univers, source de l’énergie, et la population, source de la force de travail. Je m’attache ici à mettre en lumière les traits parallèles de la seconde et de la troisième image. Alors qu’une Arbeitskraft, une force de travail sous-jacente, était imputée à l’activité humaine, l’énergie fut imputée à la nature comme sa capacité sous-jacente de produire un travail physique. Par cette imputation, la nature put être refondue à l’image de cette nouveauté d’alors : le travailleur. La nature, redéfinie comme matrice et dépôt d’une force de travail nommée « énergie », devint ainsi le miroir du prolétariat et la matrice de toute force de travail disponible. L’image de la machine à vapeur devint sous-jacente dans les représentations du réel.
« Alors qu’une Arbeitskraft, une force de travail sous-jacente, était imputée à l’activité humaine, l’énergie fut imputée à la nature comme sa capacité sous-jacente de produire un travail physique. »
Sous les monarchies absolues des XVIe et XVIIe siècles, l’horloge avait été un symbole unificateur. Avec ses jeux d’automates dansants lorsque sonnaient les heures et son théâtre de sphères cosmiques, l’horloge du roi ou de l’empereur était plus qu’un mécanisme servant à mesurer le temps. Elle offrait le spectacle de l’harmonie rationnelle tant en médecine, que dans l’organisation des parades ou dans l’art de gouverner ; l’horloge paraissait démontrer ainsi la nécessité d’une autorité cosmique sur les corps, les planètes et les sujets. Toutefois, pour les protestants politiques et religieux de la fin du XVIIe siècle, ces rouages privés d’autonomie perdirent leur pouvoir métaphorique. Le symbole de la monarchie constitutionnelle qu’ils érigèrent ne fut plus l’horloge mais la machine autorégulée, image d’un ordre fondé sur les forces mutuellement compensées et l’équilibre dynamique de l’Offre et de la Demande. Toutefois, aucun « travail » n’était encore attendu de ces machines cartésiennes. Au contraire, la nouvelle machine de l’âge thermodynamique est faite pour travailler ; elle est le symbole de l’âge de la production, des inputs et des outputs. Dorénavant, la nature, l’utérus, la population seront perçus comme des objets qui « marchent » tant qu’ils travaillent, et même la vieille horloge sera réinterprétée dans ce sens. La première machine effectuant notoirement un « travail » fut la machine à vapeur, suivie de la dynamo, inventée par Faraday en 1831, ou plutôt par son inversion accidentelle en moteur électrique à l’exposition universelle de Vienne en 1873. Finalement, le moteur de combustion interne mobile paracheva le troisième stade d’un monde moderne qui « travaille ».
En 1827, Joule était à la recherche d’un mot pour désigner « l’unité de travail effectuée par une unité de combustible ». Il choisit le mot duty, définissant ainsi ce que nous appelons le « rendement », ou l’efficience, d’un moteur comme le « devoir » de fournir tant d’unités de travail. La réduction – si caractéristique du deuxième quart du XIXe siècle – de la notion de devoir à l’efficience du travail producteur des machines, puis des hommes et des femmes et à celle de la « reproduction » pour les femmes est un puissant signe de l’emprise de la machine. À la fin de cette courte période, « l’ensemble de la soi-disant histoire mondiale n’est rien de plus que la production de l’homme par le travail humain » comme l’écrivit Marx. L’invention simultanée de ces deux formes distinctes de « potentiel de travail », l’énergie et la force de travail, n’a pas été l’objet des études qu’elle mériterait. L’examen de cette simultanéité rend nécessaire de revenir sur l’histoire d’« E » afin d’éviter toute confusion entre « E » et l’« énergie ».
De l’énergisme à l’énergétique
La première tentative d’écrire une histoire du « principe de conservation », formulé 25 ans auparavant par Helmholtz, date de 1872 et est due à Ernst Mach. Celui-ci, toutefois, ne traita pas explicitement de la conservation de l’énergie, mais de celle d’une entité appelée le travail. C’est Max Planck qui, en 1884, à l’âge de 26 ans, écrivit la première histoire explicite d’« E ». Excluant toute hypothèse sur la constitution de la nature ou de la chaleur ainsi que toute référence au mouvement des corpuscules ou des fluides impondérables, il se concentra sur la mesure des manifestations de la nature en « travail » et sur l’histoire du système de comptabilité correspondant. Avec son essai, Planck espérait remporter le premier prix du concours annuel de la faculté de philosophie de Göttingen mais il ne gagna qu’un deuxième prix (1). Il était évident pour Planck que le sens physique du concept d’énergie, dont il voulait étudier l’évolution historique, dérivait du principe de sa conservation, c’est-à-dire de l’idée « qu’il est impossible d’obtenir du travail sans compensation ». Planck rappelle que cette idée fut formulée pour la première fois vers 1840 et qu’à partir des années 1860, sa validité n’a plus été mise en question. Je n’ai pas trouvé trace, dans son essai, de l’expression du moindre soupçon de ce que le langage dans lequel furent formulés ces nouveaux principes de la physique pourrait être créateur de constructions sociales.
À la même époque cependant, Mach faisait de son côté les premiers pas conduisant à la séparation d’« énergie » et d’« E », divorce qui mettra fin à près d’un demi-siècle de thermodynamique classique. Pour Mach, il était inadmissible de postuler sans critiquer l’existence d’une mystérieuse « force de travail » derrière les phénomènes empiriques observés, à moins que celle-ci puisse être vérifiée par une expérience directe. Non qu’il niât qu’une telle hypothèse pût être justifiée ; tout ce qu’il demandait, c’est que la personne s’en prévalant le fasse en connaissance de cause, ne perdant pas de vue qu’il s’agissait d’une supposition et non d’un fait empirique. De plus, toujours selon Mach, quand plusieurs hypothèses semblent également applicables, il faut choisir celle qui s’intègre le plus élégamment dans les formules mettant les événements observés en relation, point que sa controverse avec H.R. Hertz clarifie. Ce dernier avait décrit la nature ondulatoire de la propagation transversale des ondes électromagnétiques dans l’espace sans avoir explicitement recours à « E ». L’objection de Mach n’était pas motivée par quelque faute de raisonnement de Hertz, mais par l’idée que l’introduction d’« E » aurait conféré plus d’élégance à la description du phénomène. Quant à Einstein, il maintint sa vie durant qu’une entité telle que « E » « ne peut pas être dérivée logiquement de l’expérience mais doit plutôt être comprise comme une pure création de l’esprit humain ». Au début du XXe siècle, ceux qui insistaient sur l’utilité de cette construction considéraient que « E » désignait l’état d’un champ. Les philosophes kantiens l’interprétaient comme la formulation physique du principe de causalité. Poincaré y voyait une tautologie. Vers 1920, les quelques physiciens encore nostalgiques d’une interprétation métamathématique d’« E » tentaient d’en rendre compte comme d’une conséquence de la symétrie entre champs ou une caractéristique de l’homogénéité du temps, ou comme un quelque chose qui, en mécanique quantique et en relativité, jouerait un peu le même rôle que la section d’or en architecture grecque : une manifestation du logos.
« Toute vie est une lutte pour l’énergie libre, dont les quantités disponibles sont soumises à la rareté »
Wilhelm Ostwald
À mesure que grandissait le prestige de la physique théorique moderne, il devenait plus difficile de maintenir la sobriété d’un Mach ou d’un Einstein. Tous ceux qui étaient rejetés hors du cercle magique dans lequel « E » avait une dénotation précise tendaient à voir les physiciens de carrière comme des alchimistes modernes tenant la clé des richesses ultimes ou des initiés à une nouvelle mystique. Jouant le jeu, maints physiciens se mirent à aguicher le public en lui vendant l’idée que l’« énergie » était l’attribut de l’ultime réalité. En 1892, sous l’étiquette d’« énergétisme », F. Paulsen avait déjà propagé l’idée que, plus que la mathématique, l’éthique doit être comprise comme l’autre face de la physique, argumentant que toutes deux traitent de la perfection de l’être à travers son activité, son travail. Le plus illustre représentant de cette nouvelle « énergétique » fut sans conteste Wilhelm Ostwald. Lauréat du prix Nobel de chimie en 1909, éditeur de prestigieuses publications scientifiques dont une série de plus de 200 volumes sur les grands savants (2), inventeur d’un système de classification des couleurs, Ostwald dédia son opus magnum à Ernst Mach. Il y présente l’« énergie » comme la seule substance réelle, le substrat commun de la matière et de l’âme. Pour lui, le second principe de la thermodynamique est la base de l’économie et de l’éthique. « Toute vie est une lutte pour l’énergie libre, dont les quantités disponibles sont soumises à la rareté » (1913). Toute évaluation, tout choix, toute action et toute volition peuvent être réduits en termes énergétiques comprenant la réalité matérielle aussi bien que spirituelle. Entre 1911 et 1916, Ostwald publia régulièrement un sermon moniste dominical pour l’Association moniste mondiale dont il devint président. Quarante ans plus tard, ces prédications avaient perdu l’attrait de la nouveauté et paraissaient les élucubrations d’un physicien chimiste devenu philosophe. Toutefois, les Gifford Lectures de 1956-1957 de Heisenberg font état, sans pathos, des mêmes convictions, formulées comme un credo : « La substance dont, depuis les particules élémentaires, sont faites toutes choses […] « cela » qui est cause de changement mais ne se perd jamais […] qui peut être transformé en mouvement, chaleur, lumière, tension […] c’est l’énergie. »
« La substance dont, depuis les particules élémentaires, sont faites toutes choses […] « cela » qui est cause de changement mais ne se perd jamais […] qui peut être transformé en mouvement, chaleur, lumière, tension […] c’est l’énergie. »
Wilhelm Ostwald
Dans la mesure où « E » devenait plus ésotérique, un nombre croissant de physiciens, gourous autoproclamés, s’assigna la tâche de populariser sa nature réelle. Après que de célèbres physiciens eurent mis leur prestige en jeu pour défendre l’interprétation de l’énergie comme l’ultime Kapital, le principe de la « conservation de l’énergie » devint la confirmation cosmologique du postulat de la rareté. Le principe de contradiction fut opérationnalisé en une formule populaire : « il n’y a pas de déjeuner gratuit ». Par cette expansion cosmique de la présomption de rareté, le monde, visible et invisible, put être réduit à un jeu de somme zéro, comme si Jéhova, en déclenchant un big bang, avait créé das Kapital.
Tant l’énergétisme du XIXe siècle qui avait entrepris de réduire la valeur à l’énergie, que le monisme énergétique du XXe siècle, encore manifeste dans les propos exotériques de Heisenberg, adhéraient au mythe selon lequel la science est une entreprise rationnelle. Cela changea à partir des années 1970, quand Fritjof Capra publia le Tao de la physique (3). La « découverte » de l’énergie refléterait maintenant une évolution de la conscience humaine (4), un type supérieur de connaissance permettant de recouvrer une certaine forme d’expérience mystique. Selon d’autres auteurs, la cosmologie de la physique moderne convergerait avec de vieilles intuitions orientales, de Chine (5) et, selon un auteur (6) qui cite l’école védique de l’Advaita Vedanta, de l’Inde. Les alchimistes seraient-ils en train de se transformer en théologiens ? La théologie de l’énergie est étrangère aux questions précises qu’il m’importe de poser sur la mathématique d’« E ».
Une comète lointaine
De fait, ce qui m’intéresse n’est pas la théologie de l’énergie, mais les superstitions qui l’entourent. Ce premier séminaire sur la construction sociale de l’énergie se tient au Colegio de México, ce qui pour moi a une signification très spéciale. En effet, la bibliothèque de cette institution héberge une immense collection de documents sur les superstitions latino-américaines. Durant une trentaine d’années de labeur, j’ai contribué moi-même à assembler ce matériel. L’étude de la religiosité superstitieuse a été mon passe-temps durant six années – ni théologie ni simplement religiosité populaire, mais superstition. J’ai appris de mon ami Lenz Kriss-Rettenbeck à appeler superstitions les croyances populaires et les formes de conduite engendrées sous l’aegis, sous la protection d’une église. C’est pourquoi elles peuvent être étudiées en contraste tant avec les dogmes enseignés, qu’avec les rituels propagés par ses organisations ou les idéologies promues par l’Église. En ce sens restrictif, une superstition ne peut exister qu’à l’ombre d’une église puissante. En ce sens, la superstition n’est pas un simple syncrétisme, mais l’usage que la religiosité populaire fait de l’Église. C’est ce contexte particulier qui m’a conduit à m’intéresser à l’histoire d’« énergie » comme à une superstition engendrée par la religiosité civique moderne. Vers 1847, les Pères la révélèrent, Ostwald et ses pairs la prêchèrent et le laïcat accepta le message d’un éveil spirituel à un cosmos défini par les postulats de la rareté.
« Lorsque le pétrole devint politique, l’énergie devint un équivalent du combustible : des watts pour les machines et des calories pour les gens. »
Par conséquent, il ne saurait y avoir une histoire de l’« énergie » en tant que construction sociale sans une histoire du travail, et vice versa. Les destinées des deux mots sont enchevêtrées depuis leur élévation à l’empyrée des mots clés. Toutefois, ce sont des étoiles de types différents. « Énergie » a d’abord été détectée par Young. Plutôt qu’une étoile fixe, il semble s’agir d’une comète lointaine qui changea de position lorsqu’elle devint plus brillante. « Travail » ressemble au contraire à une étoile fixe bien connue qui, s’embrasant telle une supernova, conduisit à la nécessité de renommer des constellations entières. De Joule à Planck, « énergie » resta plus ou moins confinée aux cercles académiques. Après Ostwald, elle devint le saint graal, l’arcanum d’un monde sécularisé, un « pouvoir » qu’il appartenait aux physiciens de domestiquer. Bientôt, à mesure que le labo acquérait plus de prestige que la planche à dessin de l’ingénieur, les Einsteins remplacèrent les Eiffels à la galerie des héros publics. Au cours de ce changement, « énergie » conserva sa connotation positive. La condamnation de la bombe A ne retomba pas sur elle, mais sur l’atome. Lorsque le pétrole devint politique, l’énergie devint un équivalent du combustible : des watts pour les machines et des calories pour les gens.
Lire le second volet.
Allocution inaugurale du séminaire « Options fondamentales pour une société de bas profil énergétique », tenu au Collegio de Mexico en juillet 1983. Texte traduit par Jean Robert initialement publié dans le numéro d’août-septembre 2010 de la revue Esprit, consacré à Ivan Illich à la suite d’une rencontre autour de sa pensée, organisée par Thierry Paquot et Jean Robert à l’Institut d’Urbanisme de Paris en mai 2009.
Notes
(1) De fait, déçu par le « manque de qualité » des essais présentés, le jury n’attribua pas de premier prix cette année-là, de sorte que ce deuxième prix récompensa le meilleur travail (ndt).
(2) Wilhelm Ostwald, Ostwalds Klassiker des exacten Wissenschaften, Francfort, Harry Deutsch Verlag, puis Leipzig, Akademische Verlagsgesellscharf Gees und Portig, puis Leipzig, Teubner Verlagsgesellschaft, 1889-1989 (ndt).
(3) Fritjof Capra, le Tao de la physique (1971), Paris, Sand, 1975.
(4) Erich Jantsch and Conrad H. Waddington (eds), Evolution and Consciousness: Human Systems in Transition, Reading, Addison-Wesley, 1976.
(5) Gary Zukov, The Dancing Wu Li Masters, New York, William Morrow and Company, 1979.
(6) Michaël Talbot, Mysticism and the New Physics, New York, Bantam Books, 1981.