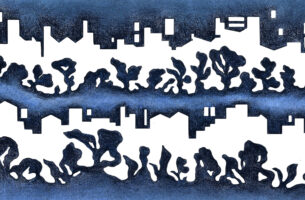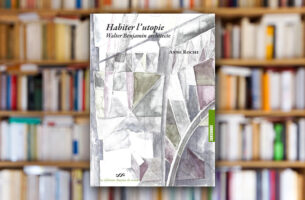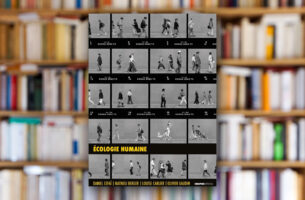Introduction
À l’occasion de l’anniversaire de la revue Topophile, Thierry Paquot se livre à une épistémologie de la notion, mystérieuse et pourtant si évidente, de topophilie. Du philosophe de l’imagination matérielle Gaston Bachelard au géographe humaniste sino-américain Yi-Fu Tuan en passant par les poètes anglais William Auden et John Betjeman, la topophilie se manifeste avant tout comme une amitié sincère et tranquille, attentive et attentionnée, heureuse, tout simplement, envers, avec et parmi un lieu, mon lieu. Malheureusement, tous les lieux ne nous mettent pas à l’aise, l’être humain s’évertue même parfois à créer des lieux anxiogènes développant ainsi un sentiment de topophobie concourant à cet acte irréversible qui se généralise : le topocide.
Voilà un mot, « topophilie », qui ne figure pas encore dans tous les dictionnaires. Pourtant, il apparait sous la plume de Gaston Bachelard (1884-1962) dans La Poétique de l’espace publié en 1957. Lors de ma première lecture de ce merveilleux ouvrage, il y a bien longtemps, je n’y avais pas porté attention, captivé par d’autres thèmes que l’auteur traite avec une incroyable subtilité et originalité. Ce philosophe des sciences, cet épistémologue, de grande renommée, explore les espaces abstraits de la physique quantique et de la théorie de la relativité (L’expérience de l’espace dans la physique contemporaine, 1937), sans pour autant oublier l’espace rêvé et toutes les images qui y sont associées. Dans La Formation de l’esprit scientifique (1938), il cite des poètes et observe que « tout travail patient et rythmique, qui réclame une longue suite d’opérations monotones entraine l’homo faber à la rêverie. » Le théoricien de La Philosophie du non (1940), divise son œuvre en deux versants solidaires, l’un sérieux et scientifique, l’autre fantaisiste, ouvert à la poésie, à la psychanalyse, à la libido...
Il confie dans Fragments d’une Poétique du Feu, ouvrage posthume et inachevé, qui résonne comme un testament : « (...) je n’ai connu le travail tranquille qu’après avoir coupé ma vie de travail en deux parties quasi indépendantes, l’une mise sous le signe du concept, l’autre sous le signe de l’image. (...) Tout alla un peu mieux dans ma vie de travail quand je vis que je pouvais, que je devais mener deux vies. » À mes yeux, c’est pourtant le même Gaston Bachelard qui publie Le Nouvel esprit scientifique (1934) et s’attelle à l’étude de l’imagination matérielle en traitant des quatre éléments (la terre, l’air, le feu et l’eau) dans cinq ouvrages majeurs (deux pour la terre), car s’il pratique un « rationalisme actif » au plus près du « savoir scientifique » de son temps, il cultive ses rêveries au point où elles le « travaillent » afin qu’il élabore « une doctrine de l’imagination littéraire ». Dans ses deux vies, une seule obligation, penser, mais dans la première à partir des erreurs passées, il note, en effet, que « L’idée scientifique a un long passé d’erreurs » ; et dans la seconde, en saisissant « la parole poétique » dans le présent de son énonciation, car elle n’a pas de passé.
Topo-analyse et maison archétypale
C’est dans l’inépuisable Poétique de l’espace (à chaque nouvelle lecture, je me surprends à y dénicher une idée nouvelle) qu’il préconise la « topo-analyse » et invente le mot « topophilie ». « Nous voulons, annonce-t-il, examiner, en effet, des images bien simples, les images de l’espace heureux. Nos enquêtes mériteraient dans cette orientation, le nom de topophilie. » Le mot figure noir sur blanc ! Une fois écrit, il existe ! Il reviendra à deux autres reprises sous sa plume sans plus de précision. Est-ce pour cela qu’il passe inaperçu, au point où personne ne le reprend ? Je m’en étonne d’autant plus que cette trouvaille langagière « colle » parfaitement au sentiment partagé par bon nombre de mes contemporains : l’amitié du lieu, l’amitié avec un lieu. En effet, la plupart des humains ressente intensément cette relation qui les attache à un lieu, ne serait-ce que leur lien avec leur maison natale ou leur pays natal. Bizarrement aussi, Il ne propose pas son contraire, la « topophobie », ayant pris le parti des espaces heureux contre ceux de l’hostilité, il se refuse à désigner les lieux anxiogènes, désagréables, inhabitables...
« Nous voulons examiner, en effet, des images bien simples, les images de l’espace heureux. Nos enquêtes mériteraient dans cette orientation, le nom de topophilie. »
Gaston Bachelard
La « topo-analyse » est ici mieux traitée, il en esquisse la définition suivante : « La topo-analyse serait donc l’étude psychologique systématique des sites de notre vie intime. » Avant de préciser : « Dans le théâtre du passé qu’est notre mémoire, le décor maintient les personnages dans leur rôle dominant. On croit parfois se connaître dans le temps, alors qu’on ne connaît qu’une suite de fixations dans des espaces de la stabilité de l’être, d’un être qui ne veut pas s’écouler, qui, dans le passé même quand il s’en va à la recherche du temps perdu, veut ‘suspendre’ le vol du temps. Dans ses mille alvéoles, l’espace tient du temps comprimé. L’espace sert à ça. » Par cette formulation, Gaston Bachelard, associe « temps » et « espace », non pas seulement car l’un contient l’autre, mais parce que les territorialités et les temporalités de notre existence se solidarisent sans cesse, au point où l’on ne peut pas les penser séparément. C’est du moins la lecture que j’en fais (1). La topo-analyse et la chrono-analyse avancent, à mon avis, d’un même pas...
Plus loin, il indique que « la topo-analyse a la marque d’une topophilie. » Me remémorant un lieu amical, je retrouve aussitôt une situation passée, ma mémoire ressemble alors à une éponge, en la pressant, mille souvenirs en sort, mais comme il s’agit d’instants d’intimité, je ne peux vous en dire plus ! Nous possédons nos propres espaces de solitude heureuse que nous protégeons de toute intrusion qui en perturberait l’harmonie. Nous savons aussi, intuitivement, qu’un lieu ne se résume pas à un emplacement délimité sur une carte, aussi l’aphorisme bachelardien résonne bien en nous : « la maison natale est plus qu’un corps de logis, elle est un corps de songes. » Visiter une maison amie ne revient pas à connaitre le nombre de ses mètres carrés ou de ses pièces, mais quelques histoires qui la concernent et qui l’incarnent.
« La maison natale est plus qu’un corps de logis, elle est un corps de songes. »
Gaston Bachelard
À dire vrai la maison natale relève de l’archétype. Un archétype est un « modèle », un « type idéal », « primitif », comme les « Idées » platoniciennes, le Vrai, le Beau, le Bien, etc. Avec le psychanalyste Carl Gustav Jung, il désigne un symbole originel et universel de l’inconscient collectif. La maison natale, comme archétype, possède une cave où se logent les interdits, les secrets, les peurs ; des étages auxquels on accède en montant et descendant l’escalier qui témoignent de la verticalité propre à l’humain (qui se lève chaque matin) et un grenier, endroit propice, par excellence, à la rêverie, où sont entreposés des vêtements démodés, des coffres remplis de trésors abandonnés par nos aïeux, des ustensiles sans usage, tout un bric-à-brac qui stimule l’imagination des enfants. Malheur à ceux qui ignorent « la hardiesse de l’escalier », ils sont comme cet homme que plaint le poète Joe Bousquet, « à un seul étage : il a sa cave dans son grenier »...

Gaston Bachelard nous invite successivement à visiter la maison onirique, à ouvrir le tiroir et l’armoire, à observer le nid, la coquille, les coins, à saisir à la fois la miniature et l’immensité, à penser « la dialectique du dehors et du dedans » et « la phénoménologie du rond ». Impossible de résumer un tel ouvrage où chaque phrase serait à recopier et à méditer. Une fois l’ouvrage refermé vous pouvez vous exercer à l’autobiographie environnementale, sorte d’auto-topo-analyse, décrivant les lieux qui ont fait de vous ce que vous êtes devenu et ainsi cheminer en compagnie de Gaston Bachelard, qui lui, ne s’est pas risqué à se topo-analyser, n’accordant que de rares confidences sur ses différents logis... Nous savons simplement qu’il se sentait oppressé dans son appartement de la rue de la Montagne-Sainte-Geneviève, près de la place Maubert, non loin de la Sorbonne, où il professait. Il préférait Bar-sur-Aube, où il est né et où il a enseigné au collège, avant d’être nommé professeur à l’université de Dijon en 1930, à 46 ans. Il y restera dix ans avant de rejoindre la capitale, mais lors des congés, il retournait toujours au pays, un pays qu’il avait à fleur de peau et de pensée à chaque instant... Peut-être que dans sa famille l’on préférait la campagne à la ville, à l’idée de « la ville », forcément grande, agressive, toujours agitée, impersonnelle...
Un précédent poétique
Wystan Hugh Auden (1907-1973), poète et critique anglais, part vivre à Berlin durant la République de Weimar avec son amant, Christopher Isherwood (1904-1986), qui décrit l’ambiance de cette ville dans des nouvelles, dont l’une sera adaptée au théâtre, puis au cinéma, Cabaret. Il épouse Erika Mann, la fille de l’auteur de La Montagne Magique, lesbienne, menacée par le régime nazi, qui ainsi possède un passeport britannique, ils ne divorceront jamais de ce « mariage blanc »... En 1937, il s’engage comme ambulancier du côté des Républicains espagnols et se désole du climat délétère au sein d’un gauche et d’une extrême-gauche absurdement divisée. Avec Christopher, ils s’installent aux États-Unis en 1939. Il fait la connaissance du poète Chester Kallan (1921-1975), deviennent amants et vivront ensemble. Il devient citoyen américain en 1946 et l’année suivante introduit le recueil de poèmes de John Betjeman (1906-1984), Slick but not streamlined. Poems and short pieces (2).
Poète passionné par l’architecture victorienne, il fonde la Victorian Society en 1958, est rédacteur de l’Architetural Review de 1930 à 1935, défenseur implacable des gares, dont St-Pancras, dorénavant terminus de l’Eurostar – où trône sa statue –, et vice-président du Bath Preservation Trust de 1965 à 1971. En 1972, il est élu « poète officiel de la Reine » et intervient fréquemment à la télévision, plébiscité par les téléspectateurs... Son ancrage territorial est évident, c’est ce que remarque Auden qui évoque à propos d’une telle sensibilité aux lieux, une poésie topophilesque (il parle de topophiliac poem). À plusieurs reprises dans son commentaire introductif, il utilise les mots, topophilia, topophil et tophiliac, qui devaient surprendre les lecteurs peu habitués à ce vocable. J’ignore d’où il le tenait, mais visiblement il y tient pour qualifier le « genre poétique » de John Betjeman, pour qui cette « topophilie » ne correspond ni à l’attachement du fermier envers sa terre, ni au chauvinisme local du plumitif régionaliste, mais à cette compréhension, spontanée, d’un lieu, dénuée de toute possessivité, comme allant de soi, même pour un endroit non encore visité par le poète.
L’inexplicable amitié
Dans la topophilie git nécessairement la virtualité de la rencontre amicale, sans qu’on sache ce qui va la déclencher... Pourquoi apprécie-t-on cette maison, aux volets avachis, au crépi auréolé d’ombres, à l’escalier grinçant, au parquet patiné ? Peut-être à cause des présences passées qu’elle contient et maintient actives ? Peut-être parce que vous vous y sentez bien mieux que dans cet appartement tout neuf avec son coin cuisine sans fenêtre dans le séjour et ce balcon ridicule qui n’accepte même pas une chaise ? Et ces toilettes comme un placard et cette chambre exiguë et cet ascenseur au code secret, tout cet immeuble propre comme une clinique, qui ouvre à même la rue, sans un arbre, sans un jardinet, sans un répit entre le dehors et le dedans...
Et si c’était le lieu qui s’évertuait à vous plaire, se rendait indispensable à votre bien-être, compatissait à vos malheurs et se réjouissait de vos satisfactions ? Une relation amicale se construit toujours à deux : tel lieu et vous. Pourquoi ? « Le cœur a des raisons que la raison ne connait point » nous indique Pascal. Avant lui, et pour expliquer l’inexplicable qui l’unissait à La Boétie, Montaigne avouait simplement : « parce que c’était lui, parce que c’était moi ». Il en va de même pour la topophilie, elle se constate, elle est sans cause, du moins rationnelle, logique, compréhensible. Comme une amitié entre humains, la topophilie connait ses orages qui peuvent conduire à la rupture. La « désamitiée » se vit parfois plus douloureusement qu’un divorce, une enquête sur ce sujet apporterait un éclairage qui nous manque. Il s’agit d’un amour d’une autre nature qu’érotique, certainement sublimé, tout aussi exigeant, prenant, entier. L’amitié refuse les demi-mesures. L’amitié ne se satisfait pas du tiède, elle revendique la flamboyance de la connivence. Elle possède ses moments de jalousie. Elle s’alimente du renouveau, de la surprise, de l’étonnement.
« Aucun lieu ne se contente d’être un banal réceptacle, un dépôt, un décor. Il agit et réagit, en cela il entre en interrelations avec les humains et le vivant qui y séjournent. »
Thierry Paquot
On le devine être ami du lieu signifie que ce dernier nous gratifie aussi d’innombrables présents, comme les senteurs du bois, le murmure de la rivière, les cancans des oiseaux, le calme de l’aurore, les couleurs changeantes du ciel, la beauté des paysages... Et cette relation se tisse de réciprocités. Aucun lieu ne se contente d’être un banal réceptacle, un dépôt, un décor. Il agit et réagit, en cela il entre en interrelations avec les humains et le vivant qui y séjournent. Toute amitié se nourrit d’attentions, de prévenances, de complicités, d’accords, de cadeaux, de marques de générosité. La philia est un des quatre mots grecs pour dire « amour », avec eros (amour physique, désir), agapê (amour spirituel, qui sera traduit en latin par caritas, qui donnera « charité en français » et aussi « chérir », qu’on utilise parcimonieusement) et storgê (amour filial, familial). La topophilie est exigeante, elle refuse le comportement frivole et le propos futile, elle cultive la disposition à la disponibilité, soit le contraire de la goujaterie, de la flagornerie, du calcul...
Conséquemment, il nous faut ménager les lieux, en prendre soin. On ne peut aimer et être aimé que si l’on porte attention à l’autre, indéfiniment, avec affection. Or, les activités humaines trop souvent saccagent les territoires afin d’en exploiter les richesses et en déstabilisent tous les équilibres écosystémiques. Même la toponomie en souffre, les noms des lieux-dits perdent leur signification, lorsque la noue est recouverte, le moulin détruit, la mare comblée, le pré bétonné, le peuplier abattu, la fontaine déplacée... Ces appellations perdent leur sens et deviennent orphelins de leur propre géohistoire. Notre topophilie est contrariée par la globalisation, ses valeurs économiques et son imaginaire consumériste, pourtant elle vibre encore au plus profond de nous – pour combien de temps ? –, prête à se déployer au moindre frémissement mémoriel.
La topophilie correspond-elle à un invariant anthropologique qui remonterait à la nuit des temps ? Le sentiment de la philia envers un lieu appartient-il à toutes les cultures ? Ou bien seulement à tel peuple, à telle période de son histoire, dans certaines circonstances ? Dépend-il d’une sensibilité particulière ? Relève-t-il de l’universel ou du pluriversel ? Et qu’en dirait une approche genrée ? On le voit, la topophilie se réalise, s’entretient, évolue, se métamorphose, meurt aussi, et alors abandonne les deux amis à leur propre solitude... La topophilie s’envisage, dorénavant, partout sur cette terre urbaine. Elle mobilise toutes les combinaisons amicales, indépendamment de nos goûts personnels, peut-être plus portés vers des territoires moins denses et encore grandement peuplés d’arbres et de forêts, de pâturages et de champs, de collines et de vallées, de rivages et de landes, de lacs et de rivières. Il me faut admettre la topophilie en milieu urbain, au cœur des mégalopoles, ne pas la dévaloriser au nom d’une nature idéalisée car déjà grignotée par l’asphalte réservé aux automobiles et abîmée par la chimie indispensable à l’agriculture intensive. J’ai connu des maisons agréables dans des villes guère épargnées par l’architecture moderne, le béton et la géométrie froide des voiries. Généralement elles étaient entourées d’un jardin désordonné, sortes d’îlots incongrus au milieu d’une urbanisation planifiée, ultimes témoins d’une époque révolue, que convoitaient les promoteurs, avides de nouveaux gratte-ciel. Elles avaient du charme, étaient donc charmantes et trouvaient vite un habitant heureux en leur compagnie. C’est de là que datait leurs topophilies qui n’en constituaient qu’une...
Une géographie affective
Dans l’introduction à Topophilia. A Study of Environment Perception, publié en 1974, le géographe américain, Yi-Fu Tuan, né en 1930 à Tianjin en Chine, écrit : « La topophilie est le lien affectif entre les gens et le lieu, l’environnement. ». Il y traite des interactions Homme/Environnement, mais aussi des processus perceptifs et des cinq sens, de l’évolution du sentiment de la nature, de l’imaginaire des lieux et de leurs symboles. etc. Déjà en 1961, il commençait à s’intéresser à la topophilie, comme en témoigne un article récemment traduit en français (3), dont je vais présenter les grandes lignes. C’est en géographe qu’il lit Gaston Bachelard, à la fois, La Terre et les Rêveries de la volonté, La Poétique de l’espace et L’Eau et les Rêves et constate avec regret que « la topophilie de Bachelard ne semble pas embrasser les villes. » En effet dans La Poétique de l’espace, Bachelard raconte comment il n’a pu s’endormir à cause des bruits de la ville. Quand ceux-ci, par la vertu de son imagination, sont devenus le roulis de l’océan et son lit une embarcation résistante à la tempête, le philosophe a pu rejoindre le pays du sommeil... Yi-Fu Tuan, partisan d’une géographie culturelle constate que « les gens ne célèbrent pas toujours les lieux sauvages et rustiques sans regarder d’un mauvais œil l’Homme et son œuvre la plus ‘fière, brave, ardente, folle et extravagante’ qu’est la ville. » Aussi doute-t-il, non pas de l’honnêteté des déclarations topophilesques de certains, tel Bachelard, mais d’une certaine idéalisation d’une « nature naturelle » au détriment d’une « nature domestiquée ». Il remarque que les plus anciens poèmes et tableaux qui consacrent la nature traitent des paysages « humanisés », comme dans le classique chinois Yi Jing (Le Livre des mutations) qui évoque le travail des fermiers.
« La topophilie est le lien affectif entre les gens et le lieu, l’environnement. »
Yi-Fu Tuan
Pour Yi-Fu Tuan, plus nous nous rapprochons de notre période, plus la sauvageté du territoire est valorisée, y compris celle des forces indomptables de la nature, comme dans le célèbre tableau de Turner, Pluie, vapeur et vitesse, de 1844, qui représente un train aux prises avec un terrible et violent orage... « Comme les poètes et artistes, constate-t-il, nous avons le loisir de gouter les fruits variés de la Terre. Notre principal devoir est de donner un portrait correct et sensible de leur impact sur nous, et si un fruit, aussi beau soit-il, est aigre, nous ne devons pas hésiter à le dire. » Le géographe s’imprègne d’un paysage avant de le décrire, le plus minutieusement possible, sans oublier le climat, l’architecture, les couleurs saisonnières, les espèces végétales, etc., tout en faisant suivre ce moment de concentration par un temps de relaxation, un « état d’attente attentive » écrit-il en empruntant ce terme d’attente au français. Il termine ses recommandations, en quittant la topophilie, pour conseiller la pratique d’une curiosité sans aucune limite, ni disciplinaire, ni politique ou mythologique et culturelle. Il est difficile de mesurer l’impact de son livre, régulièrement réimprimé, quant à la diffusion de l’idée de topophilie aux États-Unis.
La géographie culturelle, dont il est une des figures marquantes, ne s’en réfère presque pas et je ne connais pas d’articles ou de recherches qui en prolongent les analyses. Néanmoins, la topophilie, sans se référer à Yi-Fu Tuan, trouve avec la paysagiste Clare Cooper-Marcus (née en 1934 en Grande-Bretagne) une adepte. Elle enseigne à Berkeley, où elle a été l’étudiante de Melvin Webber, et travaille sur les effets bénéfiques de la nature sur le comportement des humains, le rôle du jardin dans la guérison des patients lors de leur convalescence, tout comme de l’importance des espaces verts urbains pour la détente des enfants et le développement de leur imagination. Elle commente aussi bien Carl Gustav Jung que Gaston Bachelard et Amos Rapoport, en particulier dans The House as a Miror of Self, publié en 1995. (4) Là, elle expose la conception bachelardienne de la topoanalyse et la complète ainsi : « j’irais plus loin, en affirmant que cet exercice devrait être requis de chaque architecte. Il ou elle devrait essayer de comprendre comment ses images du moi sont inconsciemment concrétisées par le design, et comment les scènes de son développement antérieur, en particulier de son enfance, entre les âges d’environ cinq à douze ans, sont souvent inconsciemment reproduites dans ses plans, probablement pour se remémorer cette étape précédente et souvent plus heureuse de sa vie. » Elle invente alors « l’autobiographie environnementale » qu’elle prescrit à ses étudiants et que j’importe dans mes cours en formulant ainsi la question : « Racontez en quoi les lieux contribuent à faire de vous, ce que vous êtes ? » Sachant que de la topoanalyse à la topophilie il n’y a qu’un pas, vite parcouru. En effet, la topoanalyse en se focalisant sur certains lieux vous révèle à quel point ils sont importants pour vous, qu’ils sont en fait des amis...
« La topoanalyse en se focalisant sur certains lieux vous révèle à quel point ils sont importants pour vous, qu’ils sont en fait des amis... »
Thierry Paquot
La topophilie apparait comme une idée neuve de ce premier quart du XXIe siècle, aussi nous devons suivre de près la revue du même nom et voir en quoi, comment et par qui, elle progresse dans les diverses formations aux métiers pour des « espaces heureux » et des « lieux habitables » et plus généralement dans la constitution d’une géographie affective, réelle et virtuelle, que chacune et chacun se doit de revendiquer et d’exalter !
La puissante topophobie
Il ne faudrait pas sous-estimer la force de la topophobie, ennemie de la topophilie. La topophobie consiste en la crainte (la phobie) du lieu. Elle figure en bonne place dans les glossaires de la psychanalyse, généralement avec cette citation de Sigmund Freud, tirée de son Introduction à la psychanalyse, publié en 1916 : « Les malades atteints d'agoraphobie (topophobie, peur de l'espace), affection qui ne rentre plus dans le cadre de la névrose obsessionnelle, mais que nous désignons sous le nom d'hystérie d'angoisse, reproduisent dans leurs tableaux nosologiques, avec une monotonie souvent fatigante, les mêmes traits : peur des espaces confinés, de grandes places découvertes, de rues et allées s'allongeant à perte de vue. Ils se croient protégés lorsqu'ils sont accompagnés par une personne de leur connaissance ou lorsqu'ils entendent une voiture derrière eux. Mais sur ce fond uniforme chaque malade présente ses conditions individuelles, des fantaisies, pourrait-on dire, qui sont souvent diamétralement opposées d'un cas à l'autre. Tel redoute les rues étroites, tel autre les rues larges ; l'un ne peut marcher dans la rue que lorsqu'il y a peu de monde, tel autre ne se sent à l'aise que lorsqu'il y a foule dans les rues. » Je suggère d’élargir la définition de ce terme, de le sortir de son contexte psychiatrique et psychanalytique et de l’étendre à tout désagrément spatial, bâti ou non et à toute dépréciation territoriale. Une architecture anxiogène, un bâtiment écrasant, le vertige à partir d’une certaine hauteur, un paysage trop vaste, un canyon abrupt entre deux parois rocheuses, sont des lieux qui effraient, inquiètent, paniquent. Les éviter relève de la topophobie. Dans ce cas, elle est discriminante et peut très bien se combiner à une topophilie envers d’autres lieux, à nos yeux, plus hospitaliers, agréables, satisfaisants.
L’autre topophobie, celle qui résulte de la globalisation du capitalisme financiarisé marque une indifférence envers le lieu, un mépris pour le territoire, un détachement vis-à-vis du logement, des lieux sans aucune qualité émotionnelle. Pour une multinationale, comme pour de nombreux décideurs nationaux et mêmes locaux, un territoire s’évalue à sa rentabilité, en toute méconnaissance de la richesse de sa biodiversité, de la singularité de sa géographie et de son climat, des savoir-faire de ses habitants, de ses cultures et patrimoines, etc. Je considère que ce système économique après avoir précarisé les emplois – l’autoentreprenariat est un moyen de contrer le salariat, pourtant à l’origine du capitalisme, tout comme le précariat et le stagériat, quant à la déqualification programmée de nombreux métiers par la robotisation, de l’agriculture à l’industrie en passant par le commerce, nous la constatons chaque jour –, précarise les territoires. Ceux-ci seraient interchangeables. En fait, ils s’apparentent à des plateaux techniques sur lequel on branche un aéroport, une gare de trains à grande vitesse, une autoroute, un CHU, un labo de recherche et des universités, des ateliers, des entrepôts, des logements, des hôtels, des centres commerciaux, des centres de loisirs, etc., qui une fois épuisés sont abandonnés au profit d’un autre « plateau technique » d’un ailleurs identique. Cela s’appelle délocaliser lorsqu’un élément déménage et une déterritorialisation quand l’ensemble est condamné à la mort économique. Cette déterritorialisation, à l’âge du productivisme numérique, repose sur la marchandisation des sols à l’échelle planétaire et leur dénaturation. Or un sol est bien plus qu’une surface cultivable ou artificialisable pour les infrastructures circulatoires ou la marée pavillonnaire... La terre que l’on cultive est d’abord un sol que l’on fertilise, le « terreau » résulte d’un mélange de terre et de fumier, il peut aussi être « naturel » lorsque la terre contient des végétaux en décomposition. Mais la terre nous cultive également. Est « terrestre » tout ce qui dépend de la terre sur Terre, en opposition à « céleste ».
La planète Terre est avant tout constituée d’eau (à environ 70 % avec les océans, mers, fleuves, lacs, etc.), néanmoins elle dispose de 13,5 milliards d’hectares de terres émergées, dont 22 % sont cultivables et 50 % seulement mis en culture. Les agricultures respectent ou épuisent le sol, tout dépend de comment elles le cultivent. La permaculture, l’agroforesterie, l’agriculture « bio », le semis direct sous couvert et d’autres pratiques « organiques », économes en eau, en énergie et plus généralement en « intrants » industriels, sont du côté de la santé de la terre, elles appartiennent à un autre univers mental qui ne promeut pas des alternatives à l’agriculture « capitaliste », mais un art de vivre qui considère la faune et la flore comme des « colocaterres », si j’ose cette expression… « Au début du XXIe siècle, nous indique Daniel Nahon, chaque habitant de la planète ne dispose que de 800 mètres carrés de terre arable alors qu’un habitant d’Europe occidentale, pour satisfaire son besoin en nourriture (surface en pâtures pour animaux, en cultures, en forêts…), nécessiterait 1 400 mètres carrés et un habitant des États-Unis 4 000 mètres carrés. » (5) Certes, l’on pourrait discuter des heures sur le mode de calcul de l’empreinte écologique, elle indique une tendance que je résume ainsi : sur une année, le mode de vie dominant n’est pas compatible avec les capacités terrestres dans la mesure où il consomme plus que ce que la terre peut fournir. Aussi nous faut-il, non seulement modifier notre mode de vie d’un point de vue frugal, mais dépenser annuellement moins d’une Terre, afin de la réparer...
« La topophobie s’accompagne généralement d’une homogénéisation des paysages et d’une banalisation des lieux, qui perdent ainsi leur pouvoir déclencheur de rêveries. »
Thierry Paquot
Les terres agricoles régressent au fur et à mesure que le front urbain s’étend, tout en produisant davantage, ce qui signifie une surexploitation absurde. Entre 1960 et 2007, la France a cédé 5,1 millions d’hectares de terres arables, soit 110 000 hectares par an, à l’urbanisation directe (terrains à bâtir) ou indirecte (infrastructures de transport, chantiers, cimetières, terrains vagues, carrières, décharges, jardins d’agrément et pelouses…). La vogue tenace de l’habitation individuelle isolée s’est accompagnée d’une augmentation de superficie et du logement (plus 15 m2 entre 1984 et 2006) et du jardin (500 m2 en 1974 et 720 m2 après 1999) et d’une demande de transport (d’où de nouvelles routes, voies ferrées, parkings, etc.). Une telle artificialisation des sols concerne toute l’Union européenne – à l’exception de la Belgique et de l’Espagne, qui ont vu leurs surfaces agricoles croître durant la période récente (1993-2003). (6)
Depuis quelques décennies, et bien marginalement, des associations – et parfois des États, comme l’Équateur et la Nouvelle-Zélande − attribuent à un fleuve ou à une forêt le statut de « personnalité juridique » leur permettant de défendre leur cause au tribunal, avec l’appui d’une association. Cette « éthique de la terre », prônée par Aldo Leopold dans son Almanach d’un comté des sables (1949), vise à doter la faune et la flore de la capacité de s’opposer juridiquement aux agissements de certains humains à leur endroit, et ainsi de les protéger de toute altération. Le sol, comme n’importe quel lieu, a donc un droit, qui ne peut être bafoué par un quelconque agriculteur, transporteur, promoteur ou élu. Voilà un moyen pour contrecarrer le topocide qui vient amplifier l’écocide et le géocide… La topophobie s’accompagne généralement d’une homogénéisation des paysages et d’une banalisation des lieux, qui perdent ainsi leur pouvoir déclencheur de rêveries.
La topophilie et la topophobie sont pas des affaires personnelles, à dimension sociétale et environnementale, elles participent contradictoirement à l’écologie existentielle dont l’objectif est l’habitabilité de la Terre, qui ne peut se réaliser qu’en combinant les territorialités de notre existence à nos temporalités et inversement. Pour les topophiles, l’habitabilité est la qualité de l’habitat, celle-ci échappe à toute marchandisation, à toute médiation extérieure, elle relève du rapport que chacun entretient avec le milieu, duquel il procède et auquel il contribue. Pour eux, l’environnement ne leur est pas extérieur, ils savent qu’ils l’environnent aussi... Pour les topophobes – qui rêvent d’enclaves résidentielles sécurisées éparpillées sur l’ensemble du globe – leur indifférence au territoire exprime leur prétention à dominer la Nature avec le déploiement inconsidéré de la Technique, en laquelle ils croient indéfectiblement. Les topophiles misent sur la coopération, l’entraide et l’harmonie entre les humains et le monde vivant, alors que les topophobes optent pour la compétition, l’intérêt privé et l’hubris. Le combat est inégal. L’enjeu est double : au niveau personnel, nous le comprenons bien, notre existence ne peut que bénéficier d’une telle amitié, et réciproquement, et au niveau collectif, il en va de la survie des humains sur la petite Terre. Je laisse à Gaston Bachelard le mot de la fin de cet exposé : « L’espace livré à l’imagination ne peut rester l’espace indifférent livré à la mesure et à la réflexion du géomètre. Il est vécu. Et il est vécu, non pas dans sa positivité, mais avec toutes les partialités de l’imagination. En particulier, presque toujours il attire. Il concentre de l’être à l’intérieur des limites qui protègent. » Pour le dire autrement, l’espace vécu dans ses rythmes alimente l’imagination qui nous prépare à cette relation amicale avec un lieu.
Texte de Thierry Paquot. Illustrations de Moé Muramatsu.
Notes
(1) Cf. « Territorialités et temporalités de l’existence. L’épreuve de l’expérience ou comment combiner rythmanalyse et topo-analyse », Rythmanalyse(s). Théories et pratiques du rythme, ontologie, définitions, variations, sous la direction de Jean-Jacques Wunenburger et Julien Lamy, Lyon, Jacques André éditeur, pp.187-198.
(2) Cf. Slick but no streamlined. Poems and short pieces, New York, Doubleday & Company, 1947, avec une Préface de William H. Auden.
(3) Cf. « Topophilia : personal encounters with the landscapes”,par Yi-Fu Tuan, Landscape, vol. XI, n°1, automne 1961, traduit par Martin Paquot, « Topophilie, rencontres intimes avec le paysage », revue numérique, Topophile, novembre 2020. On se reportera avec intérêt à Espace et lieu. La perspective de l’expérience, seul ouvrage de Yi-Fu Tuan publié en français, traduit par Céline Perez, Gollion (CH), Infolio, 2006.
(4) Ce texte est repris dans le recueil, Habitat et Nature. Du pragmatique au spirituel, traduction française par Irène de Charrière, Gollion (CH), Infolio, 2006.
(5) Cf. L’Épuisement de la terre. L’enjeu du xxie siècle, par Daniel Nahon,Odile Jacob, 2008.
(6) Je renvoie le lecteur à l’étude de Philippe Pointreau et Frédéric Coulon, « Abandon et artificialisation des terres agricoles », Courrier de l’environnement de l’Inra, 57, 2009.
Bibliographie
Thierry Paquot, Mesure et démesure des villes, CNRS, 2020.
Thierry Paquot, Demeure terrestre. Enquête vagabonde sur l’habiter, « L’esprit des villes », Terre urbaine, 2020.