Dans le miroir du passé
Le municipalisme libertaire : une nouvelle politique communale ?
Murray Bookchin | 15 juin 2022

Introduction
1995, Murray Bookchin expose ce que serait la structure politique d’une société écologiste et libertaire, c’est-à-dire décentralisée et autogérée. La commune apparaît alors comme la base d’une société libre et d’une individualité authentique. Individualité et communauté s’intriquent et s’élèvent l’un l’autre sans domination dans un processus d’autoformation. « La commune, écrit Bookchin, est la cellule vivante qui forme l’unité de base de la vie politique et de laquelle tout procède : la citoyenneté, l’interdépendance, le fédéralisme et la liberté. » « Elle constitue, poursuit-il, le lieu de parole au sein duquel les gens peuvent se confronter les uns aux autres intellectuellement et émotionnellement, se connaître à travers le dialogue, le langage du corps, l’intimité et l’échange face à face, afin de prendre des décisions collectives. » Engagement, responsabilité, liberté, solidarité ou philia, autoformation ou paideia s’épanouissent dans le municipalisme libertaire.
Les deux sens du mot « politique »
Il existe deux manières de comprendre le mot « politique ». La première, classique, définit la politique comme un système de rapports de pouvoir géré de façon plus ou moins professionnelle par des gens qui s’y sont spécialisés, les soi-disant « hommes politiques ». Ils se chargent de prendre des décisions qui concernent directement ou indirectement la vie de chacun d’entre nous, et ils mettent en œuvre ces décisions au moyen de structures gouvernementales et bureaucratiques.
Ces « hommes politiques » et leur « politique » sont habituellement considérés avec un certain mépris par nombre d’Américains. Ils accèdent au pouvoir à travers des « partis », c’est-à-dire des bureaucraties fortement structurées qui prétendent « représenter » les gens – et parfois, une seule personne en « représente » beaucoup, comme les représentants ou les sénateurs. On les appelle les « élus », traduisant ainsi en termes politiques une vieille notion religieuse, et ils forment en ce sens une véritable élite hiérarchique, malgré leur prétention de parler « au nom du Peuple ». Ils ne sont pas « le Peuple ». Ce sont, au mieux, ses « représentants », ce qui les met à part de celui-ci, et au pire, ses manipulateurs, ce qui les met en travers de la volonté du peuple. Souvent, ce sont des spéculateurs, des émissaires des grandes entreprises, des classes dirigeantes et des lobbies en tout genre. Souvent aussi, ce sont des personnages répugnants qui se conduisent de façon immorale, malhonnête et élitiste dans les médias, et trahissent régulièrement leurs engagements programmatiques au « service »des gens. En revanche, ils sont ordinairement fort utiles aux groupements qui défendent des intérêts particuliers (généralement ceux des nantis), grâce auxquels ils espèrent faire progresser leur carrière et leur confort matériel.
« Ils ne sont pas le Peuple. Ce sont, au mieux, ses représentants, ce qui les met à part de celui-ci, et au pire, ses manipulateurs, ce qui les met en travers de la volonté du peuple. »
Ce système professionnalisé, élitiste, souvent immoral et manipulateur qu’est la « politique », qui n’est le plus souvent qu’une parodie du processus démocratique que nous associons avec nos traditions, est en fait un concept relativement neuf. Il est apparu avec l’État-nation, il y a quelques siècles, quand des monarques absolus comme Henry VIII en Angleterre et Louis XIV en France ont commencé à concentrer entre leurs mains un énorme pouvoir, pour former cette structure hiérarchique que nous appelons « État » et pour façonner ces entités politiques de grande taille, les « nations », à partir d’entités plus décentralisées telles que les cités libres, les confédérations de cités et les divers domaines seigneuriaux.
Avant la formation de l’État-nation, la politique avait un sens très différent de celui d’aujourd’hui – un sens dont les « pouvoirs établis » font tout ce qu’ils peuvent pour effacer le souvenir. Dans le meilleur des cas, elle signifiait la gestion des affaires publiques par la population au niveau local, c’est-à-dire dans les villages, les bourgs, les quartiers et les villes – affaires publiques qui sont ensuite devenues le domaine exclusif des politiciens et des bureaucrates. La population gérait la chose publique directement dans des assemblées de citoyens physiquement présents, telles qu’on en rencontre encore dans les town meetings de la Nouvelle-Angleterre (1), et elle élisait des conseils chargés tout au plus d’exécuter les décisions politiques prises dans ces assemblées. Ces dernières tenaient à contrôler de près les activités de ces conseils, et révoquaient les délégués dont l’action faisait l’objet d’une désapprobation publique.
« La politique était une forme d’éducation, non de mobilisation ; elle n’avait pas pour seul but de prendre des décisions mais encore de façonner le caractère et de développer l’intelligence. »
En outre, la vie politique ne se limitait pas aux assemblées de citoyens ; elle se manifestait par une culture politique foisonnante, faite de conférences publiques, de discussions quotidiennes, sur les places, dans les parcs, au coin des rues, dans les écoles et les réunions informelles, etc. On discutait de politique partout où l’on se retrouvait, se préparant ainsi pour les assemblées citoyennes. La politique était une forme d’éducation, non de mobilisation ; elle n’avait pas pour seul but de prendre des décisions mais encore de façonner le caractère et de développer l’intelligence. À travers ce processus d’autoformation, le collectif des citoyens faisait mûrir non seulement le sentiment de sa cohésion mais aussi la personnalité individuelle, cet épanouissement de l’individu qui est indispensable si l’on veut stimuler l’autogouvernement et l’autogestion. Enfin, cette culture politique a donné naissance à des cérémonies civiques, des fêtes, des commémorations, expressions partagées des joies et des deuils collectifs. Tout cela induisait dans chaque localité (village, bourg, quartier ou ville) un sentiment de spécificité et d’identité qui favorisait plus la singularité de l’individu que sa subordination au collectif.
Un écosystème politique
Une politique de ce type était organique et écologique, et non formelle ou fortement structurée (dans l’acception verticale, hiérarchique, du terme), comme elle le deviendrait par la suite. Il s’agissait d’un processus constant et non d’un épisode occasionnel comme les « journées électorales ». Chaque citoyen, femme ou homme, développait sa personnalité à travers son propre engagement politique, grâce à la richesse des discussions et des interactions avec les autres, et par la conscience de son propre pouvoir qu’il en retirait. Les citoyens avaient le sentiment – justifié – d’être maîtres de leur destin et de pouvoir décider de leur sort, plutôt que de voir celui-ci prédéterminé par des personnes et des forces sur lesquelles ils n’exerçaient aucun contrôle. Ce sentiment résultait d’une réciprocité : la sphère politique renforçait l’individualité en lui donnant un sentiment de puissance et, vice versa, la sphère individuelle renforçait la sphère politique en l’assurant de sa loyauté. Dans un tel processus de réciprocité, le « moi » individuel et le « nous » collectif n’étaient pas subordonnés l’un à l’autre mais se soutenaient mutuellement. La sphère publique fournissait la base collective, le sol sur lequel pouvaient croître de fortes personnalités, et celles-ci, à leur tour, se rassemblaient en une sphère publique créative, démocratique, institutionnalisée de façon transparente. C’étaient des citoyens au plein sens du terme, c’est-à-dire des agents actifs de la prise de décision et de l’autogestion politique de la vie communautaire, y compris sur le plan économique, et non des bénéficiaires passifs de biens et de services fournis par des entités locales en échange d’impôts et de taxes. La communauté constituait une unité éthique de libres citoyens, et non une entreprise municipale instituée par un « contrat social ».
« La communauté constituait une unité éthique de libres citoyens, et non une entreprise municipale instituée par un contrat social. »
La commune : un enjeu moderne
Beaucoup de problèmes se posent à ceux qui cherchent à définir comment intervenir au niveau communal, mais il existe en même temps des possibilités considérables d’imaginer de nouvelles formes d’action politique, qui remettraient en honneur le concept classique de citoyenneté avec ses valeurs participatives.
À une époque où le pouvoir des États-nations s’accroît, où l’administration, la propriété, la production, les bureaucraties et les flux de pouvoir et de capitaux tendent à la centralisation, est-il possible d’aspirer à une société fondée sur des choix locaux, à base municipale, sans passer pour des utopistes incurables ? Cette vision décentralisée et participative n’est-elle pas absolument incompatible avec la tendance à la massification de la sphère publique ? La notion de communauté à l’échelle humaine n’est-elle pas suggérée par un atavisme réactionnaire qui lorgne vers un monde prémoderne (du genre de ce que la « communauté du peuple » représentait pour les nazis)? Et ceux qui la soutiennent n’entendent-ils pas rejeter ainsi toutes les conquêtes technologiques réalisées au cours des différentes révolutions industrielles depuis deux siècles ? Ou encore : est-ce qu’une « société moderne » peut être gouvernée sur des bases locales à une époque où le pouvoir centralisé semble être un état de fait irréversible ?
À ces questions théoriques s’en ajoutent beaucoup d’autres à caractère pratique. Comment coordonner des assemblées locales de citoyens pour traiter de questions comme le transport ferroviaire, l’entretien des routes, la fourniture de biens et ressources provenant de régions éloignées ? Comment passer d’une économie basée sur l’éthique du business (ce qui inclut sa contrepartie plébéienne: l’éthique du travail) à une économie guidée par une éthique basée sur la réalisation de soi au sein de l’activité productive ? Comment changer les instruments de gouvernement actuels, notamment les constitutions nationales et les statuts communaux, pour les adapter à un système d’autogouvernement basé sur l’autonomie municipale ? Comment restructurer une économie de marché orientée vers le pro t et basée sur une technologie centralisée, pour la transformer en une économie morale orientée vers l’homme et basée sur une technologie alternative décentralisée ? Et, de plus, comment toutes ces conceptions peuvent-elles confluer au sein d’une société écologique qui cherche à établir une relation équilibrée avec le monde naturel et qui veut se libérer de la hiérarchie sociale, des dominations de classe et de sexe, et de l’homogénéisation culturelle ?
« L’idée suivant laquelle les communautés décentralisées relèveraient d’une sorte d’atavisme prémoderne, ou mieux, antimoderne, […] relève d’une conception de l’individualisme qui confond individualité et égoïsme. »
L’idée suivant laquelle les communautés décentralisées relèveraient d’une sorte d’atavisme prémoderne, ou mieux, antimoderne, reflète une incapacité à reconnaître qu’une communauté organique ne doit pas nécessairement être un organisme dans lequel les comportements individuels sont subordonnés au tout. Elle relève d’une conception de l’individualisme qui confond individualité et égoïsme. Il n’y a rien de nostalgique ni de novateur dans la tentative de l’humanité d’harmoniser le collectif et l’individuel. L’impulsion à réaliser ces buts complémentaires (surtout en un temps comme le nôtre, où tous deux courent le risque d’une dégradation rapide) se manifeste par une recherche humaine constante qui s’est exprimée tant dans le domaine religieux que dans le radicalisme laïc, dans des expériences utopistes comme dans la vie citoyenne de quartier, dans des groupes ethniques fermés comme dans des conglomérats urbains cosmopolites. Ce n’est que grâce à une connaissance qui s’est sédimentée au fil des siècles qu’on a pu empêcher la notion de communauté de verser dans le grégarisme et l’esprit de clocher, et celle d’individualité de verser dans l’égoïsme.
Une politique en dehors de l’état et des partis
Tout programme qui essaye de refonder et d’élargir la signification classique de la politique et de la citoyenneté doit clairement indiquer ce que celles-ci ne sont pas, ne serait-ce qu’à cause de la confusion qui entoure ces deux mots. La politique n’est pas l’art de gérer l’État, et les citoyens ne sont pas des électeurs ou des contribuables. L’art de gérer l’État consiste en des opérations qui engagent l’État: l’exercice de son monopole de la violence, le contrôle des appareils de régulation de la société à travers la fabrication de lois et de règlements, la conduite de la société au moyen de magistrats professionnels, de l’armée, de la police et de la bureaucratie. L’art de gérer l’État acquiert un vernis politique lorsque les soi-disant « partis politiques » s’efforcent, à travers divers jeux de pouvoir, d’occuper les postes où l’action de l’État est conçue et mise en œuvre. Une « politique » de ce genre est à ce point conventionnelle qu’elle en est presque assommante. Un «parti politique », c’est habituellement une hiérarchie structurée, étoffée par des adhérents, et qui fonctionne de façon verticale. C’est un État en miniature, et dans certains pays, comme l’ex-Union soviétique et l’Allemagne nazie, le parti constituait réellement l’État lui-même.
« Les partis politiques sont donc tout aussi inorganiques que l’État lui-même – une excroissance de la société qui n’a pas de réelles racines au sein de celle-ci, ni de responsabilité envers elle au-delà de ses besoins de compétition, de pouvoir et de mobilisation. »
Les exemples soviétique et nazi du Parti/État ont montré l’extension logique du parti en État. De fait, tout parti a ses racines dans l’État et non dans le corps des citoyens. Le parti traditionnel est ajusté à l’État comme un vêtement à un mannequin. Aussi variés que puissent être le vêtement et son style, ils ne font pas partie du corps politique: ils ne font que l’habiller. Il n’y a rien d’authentiquement politique dans ce phénomène : il vise précisément à contenir le corps politique, à le contrôler et à le manipuler, et non à exprimer sa volonté – ni même à lui permettre de développer une volonté. En aucun sens, un parti « politique » traditionnel ne dérive du corps politique ou n’est constitué par lui. Toute métaphore mise à part, les partis « politiques » sont des répliques de l’État lorsqu’ils ne sont pas au pouvoir, et sont souvent synonymes de l’État lorsqu’ils sont au pouvoir. Ils sont formés pour mobiliser, pour commander, pour acquérir du pouvoir et pour diriger. Ils sont donc tout aussi inorganiques que l’État lui-même – une excroissance de la société qui n’a pas de réelles racines au sein de celle-ci, ni de responsabilité envers elle au-delà de ses besoins de compétition, de pouvoir et de mobilisation.
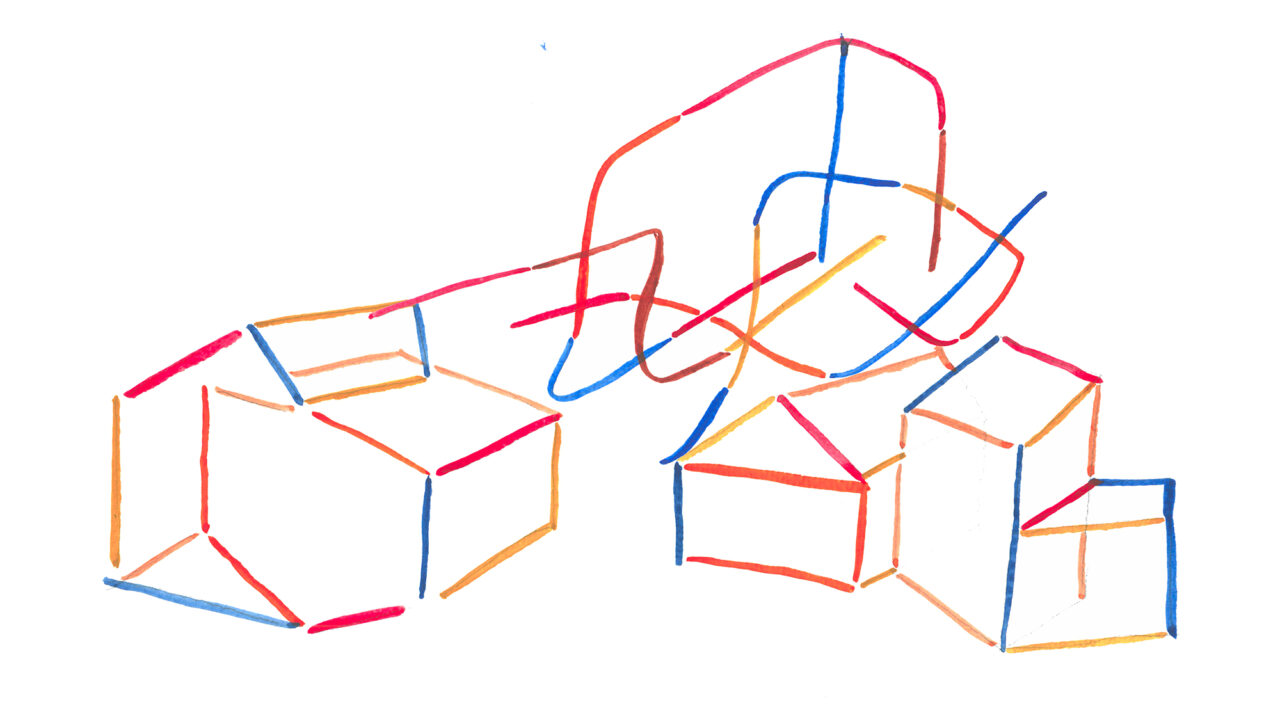
Un nouveau corps politique
La politique, au contraire, est un phénomène organique. Elle est organique au vrai sens où elle représente l’activité d’un corps public – une communauté si on préfère – de même que le processus de la floraison est une activité organique de la plante enracinée dans le sol. La politique, conçue comme une activité, implique un discours rationnel, un peuple conscient de son pouvoir, l’exercice de la raison pratique, et sa réalisation dans une activité partagée et véritablement participative.
La reprise en main et la mise en œuvre élargie de la politique doit, selon moi, prendre pour point de départ les citoyens et leur environnement immédiat au-delà de la famille et de la sphère de la vie privée. Il ne peut pas y avoir de politique sans collectivité. Et par collectivité, j’entends une association au niveau municipal d’individus, appuyée sur son pouvoir économique, ses groupes de base institués par elle, et soutenue par la confédération de communautés voisines organisées au sein d’un réseau territorial à l’échelon local et régional. Les partis qui ne s’impliquent pas dans ces formes d’organisation populaire de base ne sont pas politiques au sens classique du mot. Ce sont de fait des partis bureaucratiques opposés à la mise en œuvre d’une politique participative et à la participation des citoyens. La cellule véritable de la vie politique est, en réalité, la commune, la municipalité –soit dans son ensemble, si elle est à l’échelle humaine, soit à travers ses différentes subdivisions, notamment les quartiers.
« La cellule véritable de la vie politique est, en réalité, la commune, la municipalité –soit dans son ensemble, si elle est à l’échelle humaine, soit à travers ses différentes subdivisions, notamment les quartiers. »
L’échelon municipal ne peut servir de support à une vision renouvelée de la politique que si nous prenons au sérieux une conception exigeante de la démocratie. Autrement, nous serons ligotés par l’une ou l’autre variante de gestion étatique, par une structure bureaucratique qui est clairement hostile à toute vie publique active. La commune est la cellule vivante qui forme l’unité de base de la vie politique et de laquelle tout procède : la citoyenneté, l’interdépendance, le fédéralisme et la liberté. Le seul moyen de reconstruire la politique est de commencer par ses formes les plus élémentaires : les villages, les bourgs, les quartiers et les villes, là où les gens vivent au niveau le plus intime de l’interdépendance politique au-delà de la vie privée. C’est à ce niveau qu’ils peuvent commencer à se familiariser avec le processus politique, processus qui va bien au-delà du vote et de l’information. C’est à ce niveau aussi qu’ils peuvent dépasser l’insularité de la vie privée, familiale – cette vie qu’on célèbre actuellement au nom de l’intimité et du retrait hors du monde – et inventer des institutions publiques qui permettent à la communauté de participer largement et de « faire société ».
« La commune est la cellule vivante qui forme l’unité de base de la vie politique et de laquelle tout procède : la citoyenneté, l’interdépendance, le fédéralisme et la liberté. »
En bref, c’est à travers la commune que les gens peuvent se transformer eux-mêmes de monades isolées en un corps politique novateur, et entamer une vie civique féconde sur le plan existentiel, un tissu civique, en quelque sorte protoplasmique, inscrit dans la continuité et doté tant d’une forme institutionnelle que d’un contenu citoyen. Je me réfère ici à ces organisations d’immeubles, assemblées de quartier, town meetings ou confédérations de groupes de citoyens, et à un espace public accueillant une parole qui aille au-delà des manifestations ou des campagnes dédiées à un seul thème, aussi valables qu’elles puissent être pour redresser les injustices sociales. Mais protester ne suffit pas. La contestation limite son message à ce à quoi elle s’oppose, et passe sous silence les changements sociaux que les protestataires peuvent souhaiter. Laisser de côté cette structure citoyenne de base de la politique et de la démocratie, c’est comme jouer aux échecs sans échiquier, car c’est sur ce niveau de la vie civique que les efforts de rénovation sociale sur le long terme doivent porter en fin de compte.
Pour la décentralisation
Toutes objections étatistes mises à part, le problème du rétablissement des assemblées municipales semble insoluble si l’on reste dans le cadre des formes administratives et territoriales actuelles. New York ou Londres n’auraient pas les moyens de « faire assemblée » si elles voulaient imiter l’Athènes antique, avec son corps relativement peu nombreux de citoyens. Ces deux villes ne sont plus, en fait, des cités au sens classique du terme, ni même des municipalités selon les standards urbanistiques du XIXe siècle. Vues sous un angle macroscopique, ce sont des ceintures urbaines proliférantes qui aspirent chaque jour par millions des gens qui habitent très loin des centres d’affaires. Mais New York et Londres sont formées de quartiers, c’est-à-dire de plus petites communautés qui possèdent jusqu’à un certain point une certaine personnalité propre, définie par un héritage culturel partagé, des intérêts économiques ou une communauté de vues sociales, et parfois aussi par une tradition artistique, comme dans le cas de Greenwich Village à New York ou de Camden Town à Londres. Bien que leur gestion logistique, sanitaire et commerciale exige une coordination d’une grande complexité, conduite par tout un appareil d’experts, elles sont potentiellement ouvertes à une décentralisation politique et même, avec le temps, matérielle. Les dimensions d’une ville n’empêchent nullement de constituer des assemblées populaires, ne fût-ce que d’immeuble, à condition qu’on prenne en compte les éléments culturels pour en mettre en valeur la singularité.
« Les dimensions d’une ville n’empêchent nullement de constituer des assemblées populaires, ne fût-ce que d’immeuble, à condition qu’on prenne en compte les éléments culturels pour en mettre en valeur la singularité. »
Sans aucun doute, il faudra du temps pour décentraliser réellement une métropole comme New York en plusieurs municipalités véritables et, finalement, en communes, mais il n’y a pas de raison pour qu’une métropole de cette taille ne puisse progressivement se décentraliser au niveau institutionnel. Il faut toujours bien distinguer la décentralisation territoriale de la décentralisation institutionnelle. On prétend réfuter les arguments des partisans de la décentralisation en semant la confusion entre les deux. Or la décentralisation institutionnelle est parfaitement réalisable. On a avancé d’excellentes propositions pour implanter au niveau local la démocratie dans de telles entités métropolitaines, en restituant le pouvoir aux gens, mais elles ont été bloquées par les centralisateurs qui, avec leur cynisme habituel, ont évoqué toutes sortes d’empêchements matériels pour réaliser une telle entreprise.
Je voudrais souligner que les conceptions municipalistes (ou, c’est la même chose, communalistes) libertaires que je propose ici s’inscrivent dans une perspective dynamique et formatrice – une conception de la politique et de la citoyenneté qui vise en définitive à transformer les cités et les mégalopoles urbaines éthiquement aussi bien que spatialement, et politiquement aussi bien qu’économiquement.
Des assemblées populaires ou même des assemblées de quartiers peuvent être constituées indépendamment de la taille de la cité, pourvu qu’on en identifie les composantes culturelles et qu’on fasse ressortir leur spécificité. Les débats sur leurs dimensions optimales sont politiquement hors de propos, c’est l’objet de discussion préféré des sociologues entichés de statistiques. Il est possible de coordonner les assemblées populaires à travers des délégués pourvus d’un mandat impératif, soumis à rotation, révocables et, surtout, munis d’instructions écrites rigoureuses pour approuver ou rejeter les points à l’ordre du jour des conseils locaux fédérés composés de délégués des différentes assemblées de quartiers. Il n’y a aucun mystère dans cette forme d’organisation. La démonstration historique de son efficacité a été faite à travers sa réapparition constante aux époques de transformation sociale accélérée. Les sections parisiennes de 1793, en dépit de la taille de Paris (entre 500 000 et 600 000 habitants) et des difficultés logistiques de l’époque (où le cheval était le moyen de transport le plus rapide), ont œuvré avec beaucoup de succès, en étant coordonnées par des délégués de section au sein de la Commune de Paris. Fonctionnant sur la base de la démocratie directe, elles étaient non seulement réputées pour leur efficacité dans le traitement des problèmes politiques, mais elles ont aussi joué un rôle important dans l’approvisionnement de la ville, la sécurité alimentaire, l’élimination de la spéculation, le contrôle des prix, et beaucoup d’autres tâches administratives complexes.
Aucune ville n’est par conséquent trop grande pour que des assemblées populaires ne s’y développent, surtout quand elle est constituée de quartiers bien définis susceptibles de se lier à d’autres quartiers pour créer des confédérations de plus en plus vastes. La vraie difficulté est dans une large mesure d’ordre administratif : comment pourvoir aux besoins matériels de la vie de la cité ? Comment affronter les problèmes complexes de la logistique et de la circulation ? Comment préserver la salubrité de l’environnement ? Ces questions sont souvent obscurcies en raison d’une confusion dangereuse entre la formulation d’une politique et sa conduite administrative. Le fait pour une communauté de décider de manière participative quelle orientation suivre pour traiter un problème technique n’implique pas que tous les citoyens participent effectivement à la mise en œuvre de la résolution. Par exemple, la décision de construire une route n’implique pas que tous doivent savoir comment on conçoit et comment on réalise une route. C’est le travail des ingénieurs, qui peuvent présenter plusieurs projets, les experts remplissant là une fonction politique importante, dont l’assemblée des citoyens est toutefois libre de décider de la pertinence. L’élaboration du projet et la construction de la route sont des responsabilités strictement administratives, alors que la discussion et la décision sur la nécessité de cette route, y compris le choix de son emplacement et l’appréciation du projet, relèvent d’un processus politique. Si l’on garde clairement en tête la distinction entre la formulation d’une politique et son exécution, entre la fonction des assemblées populaires et celle des gens qui assurent la mise en œuvre des décisions prises, il est alors facile de distinguer les problèmes logistiques des problèmes politiques, deux niveaux habituellement entremêlés.
Le citoyen véritable
Au premier coup d’œil, le système des assemblées peut sembler proche de la formule du référendum, avec la prise de décision partagée par toute la population et le principe du vote à la majorité. Pourquoi, dès lors, souligner l’importance de la forme de l’assemblée pour l’autogouvernement ? Ne serait-il pas suffisant d’adopter le référendum, comme c’est aujourd’hui le cas en Suisse, et de résoudre la question par une procédure démocratique apparemment beaucoup moins compliquée ? Pourquoi ne pas prendre les décisions politiques chez soi par voie électronique –comme le suggèrent les enthousiastes de la « Troisième Vague » (2) –, chaque individu « autonome », après s’être informé des débats, prenant part au vote dans l’intimité de son foyer ?
Pour répondre à ces questions, il faut prendre en considération une série de thèmes vitaux qui touchent à la nature même de la citoyenneté. L’individu « autonome », qui, selon la théorie libérale, représente, en tant qu’ « électeur », l’unité élémentaire du processus référendaire, n’est qu’une fiction. Abandonné à son destin personnel au nom de l’ « autonomie » et de l’ « indépendance », cet individu devient un être isolé dont la liberté véritable est dépouillée de la matrice politique et sociale vitale sans laquelle l’individualité est privée de chair et de sang... La notion d’indépendance, qui est souvent confondue avec celles de pensée indépendante et de liberté, a été tellement imprégnée du pur et simple égoïsme bourgeois que nous avons tendance à oublier que notre individualité dépend largement des systèmes communautaires de soutien et de solidarité. Ce n’est ni en nous subordonnant de façon infantile à la communauté ni en nous détachant d’elle que nous devenons des êtres humains mûrs. Ce qui fait de nous des êtres sociaux, possédant de préférence des institutions rationnelles, et non des êtres solitaires dépourvus de toute affiliation sérieuse, c’est notre aptitude à pratiquer la solidarité, à stimuler le développement personnel et la créativité les uns des autres, à parvenir à la liberté au sein d’une collectivité socialement créatrice et institutionnellement enrichissante.
Une « citoyenneté » séparée de la communauté peut être tout aussi dégradante pour notre personnalité politique que l’est la « citoyenneté » dans un État totalitaire. Dans les deux cas, nous sommes reconduits à un état de dépendance caractéristique de la petite enfance, qui nous rend dangereusement vulnérables à la manipulation, soit de la part de fortes personnalités dans la vie privée, soit de la part de l’État ou des grandes firmes dans la vie économique. Dans les deux cas, et l’individualité et la communauté nous font défaut. Elles se retrouvent toutes deux dissoutes par l’élimination du terreau communautaire qui nourrit l’individualité authentique. Car c’est l’interdépendance au sein d’une communauté aux institutions riches et bien équilibrées – ce qu’aucun média électronique ne peut produire – qui donne à l’individu cette densité, faite à la fois de rationalité, du sens de la solidarité et de la justice et finalement d’une liberté effective, qui en fait un citoyen créatif et responsable.
« la commune n’est pas seulement la base d’une société libre mais aussi la base élémentaire d’une individualité authentique. »
Si paradoxal que cela paraisse, les éléments authentiques d’une société libre et rationnelle sont communautaires et non individuels. Pour le dire plutôt en termes d’institutions, la commune n’est pas seulement la base d’une société libre mais aussi la base élémentaire d’une individualité authentique. L’importance énorme de la commune est due au fait qu’elle constitue le lieu de parole au sein duquel les gens peuvent se confronter les uns aux autres intellectuellement et émotionnellement, se connaître à travers le dialogue, le langage du corps, l’intimité et l’échange face à face, afin de prendre des décisions collectives. Il s’agit ici d’un processus fondamental de mise en commun, d’interaction continue entre les multiples aspects de l’existence qui rendent la solidarité – et pas seulement la « convivialité » – tellement indispensable pour des rapports interpersonnels vraiment organiques.
« la commune est […] le lieu de parole au sein duquel les gens peuvent se confronter les uns aux autres intellectuellement et émotionnellement, se connaître à travers le dialogue, le langage du corps, l’intimité et l’échange face à face, afin de prendre des décisions collectives. »
Voter lors d’un référendum dans l’intimité de l’« isoloir », ou, comme le voudraient les partisans enthousiastes de la « Troisième Vague », dans la solitude électronique de sa propre maison, privatise la démocratie et ainsi la mine. Le vote, de même que les sondages d’opinion sur les préférences en matière de savons et de détergents, représente une mise en nombres radicale de la citoyenneté, de la politique, et de l’individualité, et une caricature du processus véritable de la formation des idées qui résulte de l’échange d’informations. Le vote est l’expression préformulée d’un « pourcentage » de nos perceptions et de nos valeurs, et non leur expression entière. C’est une technique d’avilissement des opinions en simples préférences, des idéaux en simples goûts, de la compréhension synthétique en pure quantification, de façon à pouvoir réduire les aspirations et les convictions des hommes à des chiffres.
La vraie formation à la citoyenneté
En fin de compte, l’ « individu autonome », privé de tout contexte communautaire, de rapports de solidarité et de relations organiques, se retrouve privé du processus de formation de soi – paideia – que les Athéniens de l’Antiquité assignaient à la politique comme l’une de ses plus importantes fonctions pédagogiques. La vraie citoyenneté et la vraie politique impliquent la formation permanente de la personnalité, l’éducation et un sens croissant de la responsabilité et de l’engagement social au sein de la communauté, lesquels, en retour, sont seuls à donner une vraie substance à celle-ci. Ce n’est pas dans le lieu clos de l’école, pas davantage dans l’isoloir, que des qualités personnelles et politiques vitales peuvent se former. Pour les acquérir, il faut une présence publique, incarnée par des individus qui pensent et qui s’expriment, dans un espace public réceptif et ouvert aux débats. Le « patriotisme », comme l’indique l’étymologie, est un concept typique de l’État-nation, qui traite le citoyen comme un enfant, créature obéissante de l’État-nation conçu comme pater familias, un père sévère qui dicte les convictions et exige la dévotion. Dans la mesure où nous nous comportons en « fils » ou « filles » d’une « patrie », nous nous plaçons nous-mêmes dans une relation infantile avec l’État.
« La vraie citoyenneté et la vraie politique impliquent la formation permanente de la personnalité, l’éducation et un sens croissant de la responsabilité et de l’engagement social au sein de la communauté, lesquels, en retour, sont seuls à donner une vraie substance à celle-ci. »
La solidarité ou philia, au contraire, implique le sens de la responsabilité. Elle est créée par la connaissance, la formation, l’expérience, la raison – en bref, par une éducation politique qui se développe à travers la participation politique. La philia est l’aboutissement du processus d’éducation et d’autoformation qui est la finalité de la paideia. En l’absence d’une commune à l’échelle humaine, dont les institutions sont compréhensibles et accessibles, il est tout simplement impossible d’assurer cette fonction fondamentale de la politique et sa concrétisation dans la citoyenneté. Faute de philia, nous mesurons l’ « engagement politique » au pourcentage des « votants » qui « participent » au processus « politique »: un avilissement des mots qui dénature totalement leur signification authentique et les dépouille de leur contenu éthique.
Qu’elles soient grandes ou petites, les assemblées de base et le mouvement qui cherche à les étendre restent la seule école effective de citoyenneté que nous ayons. Il n’y a pas de « programme » civique autre qu’une sphère politique vivante et créative capable de susciter des gens qui prennent la gestion des affaires publiques au sérieux. À notre époque de marchandisation, de concurrence, d’anomie et d’égoïsme, cela signifie créer consciemment une sphère publique qui introduira les valeurs d’humanisme, de coopération, de communauté et de service public dans la pratique quotidienne de la vie civique.
« La solidarité ou philia, au contraire, implique le sens de la responsabilité. […] La philia est l’aboutissement du processus d’éducation et d’autoformation qui est la finalité de la paideia. »
La polis athénienne, en dépit de ses nombreux défauts, nous offre des exemples significatifs de la façon dont un sens élevé de la citoyenneté peut se trouver renforcé non seulement par une éducation universelle et permanente, mais par le développement d’une éthique du comportement civique et par une culture artistique qui illustre les idéaux de service citoyen par les faits de la vie courante. Le respect de ses opposants au cours des débats, le recours à la parole pour obtenir un consensus, les continuelles discussions publiques sur l’agora, au cours desquelles les personnalités les plus en vue de la polis étaient tenues de discuter des questions d’intérêt public même avec d’obscurs citoyens, l’utilisation de la richesse non seulement à des fins personnelles mais aussi à l’embellissement de la polis (ce qui signifiait qu’on accordait une plus grande valeur à la redistribution qu’à l’accumulation de richesses), un grand nombre de festivités publiques, de tragédies et de comédies en grande partie consacrées à des thèmes civiques et à la nécessaire solidarité, tout cela – et bien d’autres aspects encore de la culture politique d’Athènes – forgea la responsabilité et la solidarité civique de citoyens activement engagés et profondément conscients de leur mission civique.
Pour notre part, nous ne pouvons pas faire moins – et, souhaitons-le, nous pourrons, à terme, faire considérablement plus. Le développement de la citoyenneté doit devenir un art et pas simplement une forme d’éducation – et un art créateur au sens esthétique, qui fasse appel au désir profondément humain de s’exprimer au sein d’une communauté politique porteuse de sens; un art personnel à travers lequel chaque citoyen, homme ou femme, manifeste sa pleine conscience du fait que la communauté confie sa destinée à sa propre probité morale et à sa capacité de raisonner. Si l’autorité idéologique du pouvoir d’État et de l’art de gouverner repose sur la conviction que le « citoyen » est un être incompétent, quelquefois infantile et généralement peu digne de confiance, la conception municipaliste de la citoyenneté repose sur une conviction exactement contraire. Chaque citoyen serait considéré comme compétent pour participer directement aux « affaires publiques » et surtout, ce qui est le plus important, il ou elle devrait être encouragé à le faire.
« Si l’autorité idéologique du pouvoir d’État et de l’art de gouverner repose sur la conviction que le citoyen est un être incompétent, quelquefois infantile et généralement peu digne de confiance, la conception municipaliste de la citoyenneté repose sur une conviction exactement contraire. »
Tous les moyens seraient fournis en vue de favoriser une pleine participation, en tant que processus pédagogique et éthique qui transforme les capacités latentes des citoyens en une réalité effective. La vie politique et sociale serait orchestrée délibérément de manière à aiguiser leur sensibilité et leur implication active dans la résolution des conflits, sans se soustraire, s’il le faut, à la polémique. Le service à la collectivité serait considéré comme un attribut spécifiquement humain, et non comme un « don » que le citoyen offre à la communauté ou une corvée qu’il ou elle est contraint d’accomplir. La coopération et la responsabilité civique deviendraient des expressions de la sociabilité et de la philia, et non des obligations auxquelles le citoyen essaye d’échapper dès qu’il le peut.
Pour le dire une bonne fois clairement, la commune serait un théâtre dont la vie même, sous sa forme publique la plus accomplie, formerait l’intrigue, une pièce politique dont l’ampleur conférerait noblesse et grandeur aux citoyens qui en sont les protagonistes. Tout le contraire de nos villes modernes qui sont devenues dans une large mesure des entassements d’appartements-dortoirs dans lesquels hommes et femmes dépérissent spirituellement et rabougrissent leurs personnalités dans le divertissement, la consommation et les commérages.
L’économie municipale
Le dernier des problèmes que nous rencontrerions, et l’un des plus difficiles, est celui de l’économie. Aujourd’hui, les débats économiques tendent à se focaliser sur la question de « qui possède quoi », « qui a plus que qui » et, surtout, comment les écarts de richesse peuvent se concilier avec le sentiment de communauté civique. Les municipalités ont presque toujours été fragmentées par des différences de statut économique, avec des classes pauvres, moyennes et riches dressées les unes contre les autres jusqu’au point de ruiner les libertés municipales, comme le montre clairement l’histoire sanglante des communes du Moyen Âge et de la Renaissance italienne.
Ces problèmes n’ont pas disparu à l’époque actuelle. Ils sont même assez souvent tout aussi graves que par le passé. Mais ce qui est spécifique à notre époque (et qui a été peu compris par beaucoup de gens de gauche et d’extrême gauche en Amérique et en Europe), c’est l’apparition de questions totalement nouvelles qui transcendent les classes et qui concernent l’environnement, la croissance, les transports, la détérioration de la culture et la qualité de la vie urbaine en général – problèmes suscités par l’urbanisation et non par la constitution de la cité. D’autres questions sont également transversales par rapport aux intérêts conflictuels de classe, comme les dangers de guerre thermonucléaire, l’autoritarisme étatique croissant et finalement la possibilité d’un effondrement écologique de la planète. À une échelle sans précédent dans l’histoire américaine, des gens de toute classe sociale se sont rassemblés dans des groupes citoyens d’une grande diversité, autour de projets communs concernant des problèmes souvent à caractère local mais qui affectent la destinée et le bien-être de l’ensemble de la communauté.
« Le municipalisme libertaire propose que la terre et les entreprises soient placées de façon croissante sous l’autorité de la communauté, ou, plus précisément, des citoyens dans les assemblées libres et de leurs députés dans les conseils fédéraux. »
L’émergence d’un intérêt social général par-delà les vieux intérêts particularistes démontre qu’une nouvelle politique pourrait facilement prendre corps, et qu’elle viserait non seulement à reconstruire le paysage politique au niveau municipal, mais aussi le paysage économique. Les vieux débats entre la propriété privée et la propriété nationalisée sont devenus de la pure logomachie. Non que les différences en termes de type de propriété et de formes d’exploitation qu’elles impliquent aient disparu, mais elles ont été progressivement rejetées dans l’ombre par des réalités et des pré- occupations nouvelles. La propriété privée, au sens traditionnel du terme, en tant qu’elle prétendait faire du citoyen un individu économiquement autosuffisant et politiquement indépendant, perd de sa prégnance. Et cela non pas parce que le « socialisme rampant » dévore la « libre entreprise », mais bien parce que les « multinationales rampantes » ont tout dévoré – au nom, comble de l’ironie, de la « libre entreprise ». L’idéal grec d’un citoyen politiquement souverain, capable de juger rationnellement des affaires publiques parce que libéré du besoin matériel et du clientélisme, n’est plus qu’une plaisanterie. Le caractère oligarchique de la vie économique menace le peu de démocratie que nous avons, non seulement au niveau national mais aussi au niveau municipal, là où elle conservait encore un certain ancrage et un certain champ d’action.
Nous en arrivons ainsi à une approche radicalement nouvelle de l’économie municipale, qui se propose de dissoudre de manière novatrice l’aura mystique entourant la propriété capitaliste et la propriété nationalisée, et de fait aussi, l’élitisme inhérent à l’idéologie du lieu de travail et à la « démocratie sur le lieu de travail ». Il s’agit de la municipalisation de la propriété, par opposition à sa privatisation ou à sa nationalisation. De la même façon que le municipalisme libertaire propose de redéfinir la politique pour y inclure une démocratie communale directe qui s’étendra graduellement sous des formes confédérales, il comporte également une approche municipaliste et fédéraliste de l’économie. Le municipalisme libertaire propose que la terre et les entreprises soient placées de façon croissante sous l’autorité de la communauté, ou, plus précisément, des citoyens dans les assemblées libres et de leurs députés dans les conseils fédéraux. Comment planifier le travail, quelles technologies employer, quels biens distribuer? Il s’agit là de questions qui ne peuvent être résolues que dans la pratique. La maxime « de chacun selon ses capacités, à chacun selon ses besoins », cette exigence célèbre des différents socialismes du XIXe siècle, se trouverait institutionnalisée comme une dimension de la sphère publique. En visant à assurer aux gens l’accès aux moyens de vivre, indépendamment du travail qu’ils sont capables d’accomplir, elle cesserait d’exprimer un credo sans grand fondement : elle deviendrait une pratique, un mode de fonctionnement politique.
« Loin d’être une contrainte, l’interdépendance entre communautés et régions doit être considérée – culturellement et politiquement – comme un avantage. »
Aucune communauté ne peut espérer atteindre l’autarcie économique, ni ne devrait essayer de le faire. Du point de vue économique, la large gamme de ressources nécessaires à la production de nos biens d’usage courant exclut le repli sur soi et l’esprit de clocher. Loin d’être une contrainte, l’interdépendance entre communautés et régions doit être considérée – culturellement et politiquement – comme un avantage. L’interdépendance entre les communautés n’est pas moins importante que l’interdépendance entre les individus. Privée de l’enrichissement culturel mutuel qui a souvent été le produit de l’échange économique, la commune tend à se rétracter sur elle-même et sombre dans une sorte de privatisme civique. Des besoins et des ressources communs impliquent l’existence d’un partage et, avec le partage, d’une communication, d’un rajeunissement grâce à des idées nouvelles, et d’un horizon social élargi forgeant une sensibilité accrue aux expériences nouvelles.
Une question de survie écologique
À la lumière de ces éléments, il est possible d’envisager une nouvelle culture politique avec une nouvelle renaissance de la citoyenneté, des institutions civiques populaires, un nouveau type d’économie et un contre-pouvoir parallèle, dans un réseau confédéral capable d’endiguer et, espérons-le, de renverser la tendance à une centralisation croissante de l’État et des grandes entreprises. En outre, il est possible aussi de concevoir un point de départ tout à fait concret pour le dépassement des villes, grandes et petites, telles que nous les avons connues jusqu’à présent, et pour le développement de nouvelles façons d’habiter réellement communautaires, visant à créer une nouvelle harmonie non seulement entre les gens mais aussi entre l’humanité et le monde naturel. J’ai souligné sa faisabilité, parce qu’il est évident maintenant que toute tentative d’adapter une communauté humaine à l’écosystème naturel qui l’entoure se heurte de plein fouet à la trame du pouvoir centralisé, qu’il s’agisse de celui de l’État ou du capital concentré.
« il est évident maintenant que toute tentative d’adapter une communauté humaine à l’écosystème naturel qui l’entoure se heurte de plein fouet à la trame du pouvoir centralisé, qu’il s’agisse de celui de l’État ou du capital concentré. »
Le pouvoir centralisé reproduit inexorablement sa propre centralisation à tous les niveaux de la vie sociale, économique et politique. Il n’est pas seulement grand : il pense « grand ». Ce mode d’être et de penser est la condition non seulement de sa croissance mais de sa survie même. Nous vivons déjà dans un monde où l’économie est excessivement mondialisée, centralisée et bureaucratisée. Beaucoup de ce qui pourrait être fait au niveau local et régional l’est à l’échelle mondiale – en grande partie pour des raisons de profit, de stratégie militaire et d’ambitions impériales – avec une complexité apparente que l’on pourrait en réalité aisément résorber.
Si toutes ces idées peuvent sembler trop « utopiques » pour notre temps, alors on peut aussi considérer comme utopique l’abondante littérature actuelle qui réclame un changement radical des politiques énergétiques, une réduction drastique de la pollution de l’atmosphère et des mers, et la mise en œuvre de programmes au niveau mondial pour mettre un frein au réchauffement de la planète et à la destruction de la couche d’ozone. On peut à bon droit s’interroger : est-il exagéré de pousser ces revendications un degré plus loin ? Est-il exagéré d’exiger des changements institutionnels et économiques non moins radicaux, mais fondés en réalité sur des traditions profondément enracinées dans les pratiques démocratiques et politiques les plus nobles de l’Amérique – et en fait du monde entier ?
Texte de Murray Bookchin. Illustrations de Moé Muramatsu.
Nous avons découvert ce texte dans l’excellent recueil Pouvoir de détruire, pouvoir de créer. Vers une écologie sociale et libertaire (« Versus », L’échappée, 2019) édité, commenté et traduit par Helen Arnold, Daniel Blanchard, Renaud Garcia et Vincent Gerber. Nous le republions avec l’aimable autorisation des éditions de l’Échappée.
Ce texte a été composé en 1995 par Jean Vogel à partir de plusieurs textes de Bookchin notamment le chapitre 8 de The Rise of Urbanization and the Decline of Citizenship (Cassell, Londres, 1995) ; « The New Municipal Agenda », in From Urbanization to Cities (Cassell, Londres, 1995) ; « Libertarian Municipalism : An Overview », in Green Perspectives no 24, 1991 ; « The Greening of Politics: Toward a new kind of Political Practice », in Green perspectives no 1, 1986. De nombreuses publications francophones ont publié ce texte.
Notes
(1) NdT : Les town meetings (« assemblées municipales ») sont des assemblées générales des habitants d’une localité, au cours desquelles tous les membres de la communauté délibèrent et légifèrent sur les questions publiques. Bien que ces débats soient tranchés par le vote, la discussion y joue un rôle central en tant que moyen de résolution des problèmes politiques. Cette forme de démocratie directe est apparue dans le nord-est des États-Unis au XVIIe siècle, et malgré quelques transformations elle s’y est maintenue en plusieurs endroits jusqu’à nos jours.
(2) NdT : Bookchin fait référence aux théories de l’écrivain et homme d’affaires Alvin Toffler (1928-2016), auteur de deux best-sellers, Le Choc du futur (1970) et La Troisième Vague (1980). Dans ce dernier livre, il décrivait les perspectives d’une société «postindustrielle» (succédant aux deux premières vagues historiques que furent l’avènement de l’agriculture et l’essor de la société industrielle), et prédisait avec enthousiasme l’avènement d’une « culture » digitale.




