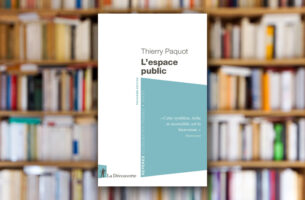Introduction
Écrites au fil du confinement, Emmanuelle Patte nous propose trois tribunes, trois coups de gueule ô combien mérités par une profession si aveugle… Deuxième volet, après la colère, où l’architecte démontre qu’il n’y a de prémonition, en fait, que lucidité. Les derniers mois, entre méga-feux et confinement, auront exacerbé les preuves que nous allons dans le mur et révélé l’aveuglement procédant de l’habitude. Rédigé le 21 avril 2020, en confinement à Montreuil.
« Il sera bientôt trop tard. » C’était le titre du journal le Monde du 14 novembre 2017, en gras et dans une police dramatique prévue pour le déclenchement d’une guerre atomique.
Et puis rien
Comment prendre au sérieux la dramatisation permanente ? A la radio, entendre Nicolas Hulot nous expliquer qu’on va dans le mur à toute vitesse. Puis, la pause publicité qui vante et veut nous vendre une voiture pas chère.
Le poids se fait sentir sur nos consciences
À la fois, nous savons que nous courons à notre perte et nous n’avons pas le pouvoir d’arrêter seul cette course. À quoi bon, même si une poignée d’entre nous s’arrête, cultive bio, se déplace en vélo, répare au lieu de jeter, construit en terre crue, en paille et en bois, investit dans des banques équitables pour le micro crédit, à quoi bon ? C’est une goutte d’eau à la mer. On a beau se sentir colibri, faire sa part, y croire encore et encore. On sent bien que c’est vain. On n’a pas envie d’être les grincheux de service, les rabat-joie. On veut aussi sa part de plaisir, goûter des fruits exotiques, s’envoler vers des terres lointaines, retrouver des amis un week-end, faire les soldes…
Enfin !
Là, c’est réel, sérieux. Le confinement est un soulagement. Enfin nous mettons nos actions en accord avec l’urgence à agir. Certes, ce n’est pas pour l’environnement. C’est le Covid-19 et la mort est immédiate. La mort est proche, il s’agit de nos amis, parents, grands-parents, nos ainés. On sait ce qu’il faut faire.
Restez chez vous
Pour sauver des vies, ne pas bouger, ne rien faire. Arrêter de faire. Rétrécir son champ d’action. Ne pas s’agiter. Stopper l’activité, l’économie, les échanges, la croissance, la course. Rester chez soi. Dans nos vieux draps, nos vieux vêtements, coudre des masques pour se protéger, pour protéger les autres. Ne sortir qu’une heure par jour et profiter de cette heure-là. Regarder minutieusement. On parle déjà du monde d’après.
Je me sens triste
Je voulais parler de la joie, des petits et grands bonheurs du confinement. Mais ce matin, je me sens surtout triste parce que le monde d’après va ressembler au monde d’avant. En pire peut-être, parce qu’on va se préparer à de nouvelles attaques, faire des stocks de masques et de gel hydroalcoolique en pensant que ce coup-ci, on sera bien préparé. Et on domptera tout de suite ce satané virus. Sauf que, sans doute, ce sera autre chose qui nous déstabilisera, qui déstabilisera nos vies si bien réglées, nos habitudes, nos projets. Et nous manquons d’imagination pour savoir ce qui adviendra. Je me sens triste parce que je ne me sens pas écoutée, parce qu’au lieu de fourbir les armes, il faudrait plutôt être attentif. Je me sens triste parce qu’on me prend pour une gentille excentrique.
Un scénario catastrophe
Il y a un an, j’ai fait travailler les étudiants du cycle « Construction et habitat durables » à l’E.S.T.P. sur un scénario fiction assez radical sur l’île Saint-Denis, un scénario absolument pas réel. Un scénario rêvé avec Vania Dormoy, paysagiste de l’agence Panorama et de l’association Anima qui intervient à la pointe de l’île Saint-Denis. Ils étaient une quinzaine d’étudiants arrivés tôt le matin avec quelques accessoires : gants, mouchoirs, couteau, cuillère, bouteille d’eau, sac plastique, mètre roulant, lampe de poche, contenants divers. Le scénario, nous l’avions imaginé pour provoquer les étudiants, et nous-mêmes, pour changer de positionnement quant à la question du bâtiment, de la construction, en regardant différemment, plus attentivement ce qui nous entoure. Pour cela, nous avions réduit en le périmètre d’observation, un peu à la manière des botanistes qui vont inventorier toutes les espèces sur un carré de 1m². Le terrain était la partie nord de l’île Saint-Denis entre la mairie et la pointe avec cette hypothèse : « l’île s’est détachée du continent », tous les ponts sont fermés. Il y a eu une grande catastrophe sanitaire, énergétique ou environnementale, une grande pollution, une famine, une épidémie ou autre chose. On ne sait pas quoi mais c’est sérieux. Il faut se projeter ici et maintenant, se mettre dans l’état. Comme un comédien entre dans un rôle. Est-ce un drame ? Est-ce une chance ? Par quel bout le prendre ? Il faut faire avec ce qu’on a, avec les ressources sur place. Se mettre dans l’état, c’était accepter avec une sorte de naïveté de jouer à Robinson Crusoé, de faire l’inventaire des ressources sur place : matières, abris, bâti — nourriture — énergie, travail — relations, convivialité, gouvernance — savoir-faire, connaissances — garantie, assurance — transport, sport — loisirs, culture — argent, monnaie d’échange, temps. De quoi, de qui avons-nous besoin pour réaliser les projets conçus lors des séances de l’atelier C.H.D. ? Où est-ce ? Comment le déplacer, le mettre en œuvre ? Nous avions préparé des cartes de l’île et des tableaux d’inventaire pour chaque thématique — eau, terre, air, feu — avec des colonnes à renseigner avec des données très concrètes : ressources nécessaires, quantité, mode d’extraction, outils, main d’œuvre, transport, planning.
Bascule du cerveau
L’exercice, si on l’acceptait, bousculait notre mode de pensée vers un mode adaptatif plutôt que le mode automatique. Le mode automatique consiste à chercher sur internet ce dont nous avons besoin sans ne se soucier, ni d’où ça vient, ni comment c’est fait. Car tout est là en abondance, qui clignote dans la vitrine du web en suppliant « achète-moi ». Les étudiants ont joué le jeu. En pensant que c’en était un. Un an plus tard, avec le Covid-19, nous fabriquons des masques avec les moyens du bord. Nous envisageons de rapatrier certaines productions. Car oui, les frontières se sont fermées, les déplacements sont interdits.
Il y a quelques mois aussi, j’ai organisé, sur proposition de Nadège Constant, pour l’association Cyclotranseurope, un atelier de prospective qui s’intitulait « Une ville, un pays, un monde sans voiture ». Là encore, Frédéric Héran, notre invité, a contesté l’idée : « Sans voiture, c’est impossible, de quoi aurions-nous l’air à proposer des idées si peu scientifiques ? » Ce qui nous intéressait dans l’exercice, n’était pas de savoir s’il était réaliste ou pas, souhaitable ou pas, mais d’en imaginer les effets, les conséquences. Et, là encore, de basculer dans un mode adaptatif, réfléchir à nos besoins, à nos actes au lieu de sauter dans une voiture pour 3 km. Et voilà que nous y sommes. Depuis plus d’un mois, quasiment sans voiture sauf les secours, les livraisons, quelques personnes allant travailler aux services quotidiens indispensables : hôpitaux, soins, approvisionnement en nourriture.
Alors oui, l’économie s’effondre, nous dit-on, et c’est certainement vrai pour beaucoup de personnes et de familles en France qui ne sont pas protégées par un statut salarié, donnant droit au chômage technique, et dont l’activité est stoppée. Dans certaines parties du monde, la situation est dramatique, encore plus dramatique qu’avant le coronavirus. Et il faudra s’en préoccuper. Il faudrait s’en occuper. On aurait dû s’en occuper, car le fantasme de croire que l’on peut arrêter les problèmes aux frontières des pays ou des continents est bien naïf.
De l’espace libre
Mais ce que l’on voit de l’espace public, de nos fenêtres quand on a la chance d’avoir des vues, dans les rues quand on s’y déplace pour les motifs autorisés, c’est la place prépondérante prise par les voitures. Dans certaines rues à Montreuil, l’absence de circulation met en évidence cette confiscation de l’espace par les voitures. Par exemple, la rue Kléber, qui n’a qu’une voie de circulation, fait 10 m de large au total. La voie centrale de circulation et les 2 lignes latérales de stationnement des voitures font environ 8 m. Il reste 2 m pour les piétons. La proportion est donc 80 % de l’espace pour les automobiles et 20 % pour les piétons. Certes, la voie de circulation centrale peut aussi être utilisée par les vélos. Mais à leur risques et périls, car les automobilistes les dépassent sans avoir la distance de sécurité requise, ou les talonnent en faisant gronder leur moteur, ce qui constitue une action assez violente d’intimidation. La grande majorité des automobiles étant immobiles en ces temps de confinement, cela rend visible et évident leur encombrement exagéré au regard du service rendu. Car les statistiques disent qu’à Paris, le nombre de déplacement en voiture est de moins de 15 % du nombre total de déplacement. 80 % des voitures concernent les particuliers, 80 % ne transportent qu’une seule personne, 42 % des trajets font moins de 10 km, 13 % des actifs parisiens utilisent leur voiture pour aller travailler, 38 % en petite couronne. Et pourtant, elles occupent majoritairement l’espace de la voirie avec les nuisances de bruits, d’odeurs, et de pollution ; et le danger pour tous les autres usagers. Elles occupent aussi 126 000 places de stationnement sur la voirie.
Le confinement a un effet bénéfique incroyable, c’est frappant. C’est inespéré. Il est enthousiasmant de voir, de sentir, d’éprouver le soulagement physique dans la ville grâce à l’absence quasi-totale des voitures particulières en circulation. De sentir le printemps dans toute sa beauté, sa sensorialité.
De l’air pur
Lumière étincelante. Parfums retrouvés des arbres. Quand une voiture passe, ça pue et on le sent. Alors qu’en temps normal, on est tellement baigné dans cette pollution qu’on ne s’en rend même plus compte.
Silence
On entend les oiseaux, les musiques s’échappant des appartements. On peut se parler de fenêtre à fenêtre. Quand passe une moto, on est choqué de la pétarade assourdissante à laquelle on ne prêtait plus attention, assourdis qu’on était par les bruits de la circulation. La nuit, on dort mieux.
Sécurité
Les enfants jouent dans la rue, font un petit tour (moins d’1 km) à bicyclette. On peut marcher au milieu de la chaussée. Ce qui est d’ailleurs nécessaire pour respecter la distance sociale de 1 m minimum pour échapper à la contamination. Le corps se détend. Les animaux aussi. Et les plantes sauvages fleurissent, grandissent dans les failles des trottoirs, le long des immeubles.
La campagne en ville
C’est comme si tout d’un coup, la campagne revenait en ville. Faut-il dé-densifier ? Peut-être pas, mais libérer l’espace pour en avoir un usage sensuel. Supprimer le stationnement des voitures en surface — il y a beaucoup de places libres dans les parkings souterrains qui ont coûté cher à construire. Supprimer l’usage des voitures pour les déplacements de moins de 10 km. En vélo, c’est 40 min si l’on roule facilement. Ah oui, je ne vous ai pas dit, mais on va beaucoup plus vite en vélo dans une ville sans voiture — sans feu rouge, ce serait encore plus rapide. J’en ai fait l’expérience en allant des Beaumonts à Montreuil jusqu’à la Butte-aux-Cailles. D’habitude cela me prend 1 h. Avec le confinement et l’absence de voiture, cela m’a pris 40 min. Si le périphérique était réservé aux vélos sans aucune interruption, cela prendrait 30 min.
Et alors, qu’est-ce qu’on ferait avec toutes cet espace libre ? Déjà, si l’on supprimait le stationnement en surface : 126 000 places × 10 m² = 1 260 000 m² libérés à Paris. On pourrait y planter des arbres, faire de petits jardins, des petits parcs d’élevages d’animaux, des terrasses pour les cafés (avec la distance sociale), des espaces de jeux pour les enfants, des abris pour faire la sieste car il y aurait moins de bruit, des petites expositions, des lieux d’apprentissage, des ateliers artistiques, de la voirie plus large pour marcher de front avec poussettes et fauteuils roulants en parlant, des kiosques à musique.
1 260 000 m², c’est 311 petits terrains de foot, soit 15 par arrondissement, l’équivalent de 3 000 terrains de basket, soit 150 par arrondissement de Paris, de la nature, de la culture, de la biodiversité, du lien entre les passants, des activités, de l’espace de respiration, de la campagne en ville. Je n’ai pris Paris comme exemple que par facilité. Mais nous pourrions faire cela en banlieue, en région, dans les villages aussi.
Emmanuelle Patte est architecte et fondatrice de Méandre-ETC architecture, urbanisme et environnement.
La troisième tribune s’intitule « Le temps de faire ».