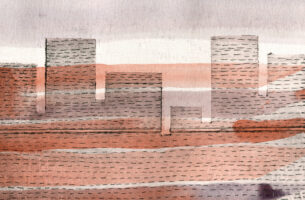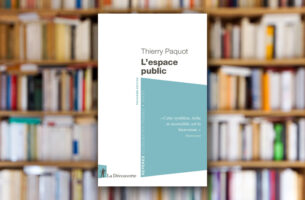Dans le miroir du passé
L’architecture et l’urbanisme en prise avec le pouvoir
Michel Ragon | 5 juin 2024

Introduction
1975, le critique d’art et historien autodidacte de l’architecture et de l’urbanisme Michel Ragon (1924-2020) soutient une thèse sur travaux, à la Sorbonne, intitulée La pratique architecturale et ses idéologies : de la Révolution industrielle à nos jours. À l’occasion du centenaire de sa naissance, nous republions le discours qu’il prononça alors. Celui-ci retrace son cheminement intellectuel au gré de ses nombreux livres sur l’architecture et la ville aux titres évocateurs : Où vivrons-nous demain ? (Robert Laffont, 1963), Les erreurs monumentales (Hachette, 1971), Histoire de l’architecture et de l’urbanisme moderne (Casterman, 1971-1977), L’architecte, le Prince et la Démocratie (Albin Michel, 1977). Cinquante ans plus tard, leur lecture est toujours précieuse non seulement pour leur richesse transdisciplinaire mais aussi pour la lucidité de l’auteur : « Nos villes actuelles sont, on le sait, l’émanation d’une idéologie du pouvoir financier, technocratique et bureaucratique. Mais nos villes actuelles sont aussi un théâtre où se joue une pièce de propagande visant à l’efficacité de la production et à l’intensification de la consommation. […] Les différents pouvoirs qui, toujours, détiennent la ville, se sont perpétuellement efforcés à ce que la fête n’envahisse pas la ville. Ils ont endigué la faculté ludique de la ville dans une sorte de théâtre rituel : commémorations, défilés, processions, cérémonies événementielles. » Il n’est pas dupe, mais ne condamne pas la ville comme source de tous les maux pour autant : « la ville est le lieu de la contradiction. Signe du pouvoir, certes, mais aussi lieu de la liberté, des échanges, de l’aléatoire, des contacts, de la parole. Lieu par excellence de l’utopie. »
Messieurs,
Me trouver aujourd’hui devant vous, dans cette salle de la Sorbonne, tient du miracle et de la fantasmagorie. Au risque de lasser, je ne peux résister à évoquer le petit garçon que je fus, quittant l’école primaire à quatorze ans, nanti de son Certificat d’Etudes et commençant le dur apprentissage de la vie prolétarienne manuelle. C’est que cette formation de prolétaire et d’autodidacte explique toute une partie de mon travail, celle qui commence dès mes vingt-trois ans avec la publication de mon premier livre sur la littérature prolétarienne et qui s’est continuée beaucoup plus tard par le grand rôle que nous avons donné à l’habitat populaire dans l’histoire de l’architecture, et à la ville comme pratique d’un espace de la vie quotidienne.
Entre les deux, la séduction de la pratique picturale, l’amitié des artistes de la génération de l’abstraction lyrique, la pratique de la critique d’art. Littérature prolétarienne et critique d’art dite d’avant-garde peuvent paraître des activités contradictoires. Mais seulement à ceux qui oublient qu’à certains moments de l’histoire, l’avant-garde esthétique et l’avant-garde politique marchent de paires. Avouons néanmoins que dans le milieu confiné de l’art pictural, tel qu’il est actuellement pratiqué, et dans son environnement mercantile, nous nous sommes souvent sentis mal à l’aise. Le petit garçon dont je vous parlais tout à l’heure, revenait me tirer par la main. Avec l’architecture et l’urbanisme nous avons retrouvé, lui et moi, nos préoccupations sociales et politiques premières. L’architecture, qui est à la fois un art et une science, qui conjugue l’esthétique et le politique, nous permet d’unir nos préoccupations sociales à nos préoccupations esthétiques.
Le thème que vous avez bien voulu examiner, et dont nous allons débattre est une tentative de déchiffrage des idéologies et de la pratique architecturale dans le nouveau monde urbain né de l’industrialisation.
La solution est-elle dans la postérité du Bauhaus, de Le Corbusier, de la Charte d’Athènes ? Nous l’avons cru naïvement en écrivant notre première Histoire de l’Architecture moderne publié en 1958. Il est vrai qu’aucun ouvrage semblable n’existait alors en langue française, aussi invraisemblable que cela puisse paraître. Ce livre devait être suivi d’un second qui eut fait un bilan de la pratique architecturale après la seconde guerre mondiale, pratique née des théories des pionniers des années vingt… Or, plus nous avançons dans nos recherches, plus nous nous enfoncions dans une impasse. Si bien que nous en arrivâmes à ne pas publier ce livre. Et qu’à sa place, changeant totalement de cap, nous aboutîmes en 1963 à la publication de Où vivrons-nous demain ? (avec un gros point d’interrogation).
« Réunis dans un seul lieu, ce livre, [ces architectures] forment une sorte de ville imaginaire fabuleuse. Mais c’est un mirage. Détournée de son environnement, la pratique architecturale est devenue là un pieux mensonge. »
Où vivrons-nous demain ? , c’était délaisser la pratique pour la théorie. C’était tenter d’ouvrir la porte de la modernité en architecture par une nouvelle clef : la prospective. Appliquer (ce qui, auparavant, n’avait jamais été fait) les méthodes de la prospective économique et politique à l’architecture et à l’urbanisme aboutissait à quoi ? Eh bien à écrire des sortes de scénarios du futur architectural à partir de propositions nouvelles qui, toutes, rompaient avec la génération de Gropius et de Le Corbusier. C’était poser la question : « Après Le Corbusier quoi ? ». On nous accusa d’utopisme. Une autre clef pouvait peut-être nous être utile : l’esthétique. Réunir la documentation sur les plus belles réalisations de l’architecture de l’après-guerre, la classer par genres, ou plus précisément par signes, aboutissait à quoi ? Eh bien à dresser aussi une sorte de cité utopique. Toutes ces architectures publiées dans notre Esthétique de l’architecture contemporaine existent, mais sont dispersées dans le monde entier. Réunis dans un seul lieu, ce livre, elles forment une sorte de ville imaginaire fabuleuse. Mais c’est un mirage. Détournée de son environnement, la pratique architecturale est devenue là un pieux mensonge.
Alors tout reprendre. Jeter aux oubliettes notre première histoire de l’architecture (qui ne sera jamais rééditée) et revérifier les évènements, les dates, rechercher les influences, les retombées. Tenter de repartir à zéro, comme si nous ne savions rien. Quinze ans de voyages, de lectures, d’études, de réflexions nous amenaient en 1971 à la rédaction de notre Histoire mondiale de l’architecture et de l’urbanisme modernes, histoire des idéologies et des pratiques architecturales, sans cesse confrontées.
Il en ressort que le nouveau monde urbain né de l’industrie est toujours à la recherche de sa ville. Interroger l’histoire, l’histoire de L’homme et (de) ses villes, c’était peut-être aider à mieux comprendre notre ville déchirée par la révolution industrielle, une révolution industrielle qui a certes produit une révolution urbaine, mais une révolution urbaine qui demeure au stade insurrectionnel. Dans cette insurrection de plus d’un siècle, la ville pré-industrielle disparait peu à peu sous les décombres, mais la ville qu’aurait dû accoucher cette révolution, où est-elle ?
« Il en ressort que le nouveau monde urbain né de l’industrie est toujours à la recherche de sa ville. »
Notre dernier travail nous a conduit à constater que la ville démocratique, qui devait être la conséquence de la révolution industrielle, reste un leurre. Mais c’est néanmoins dans cette ville démocratique à construire que notre vie quotidienne pourrait trouver son expression urbaine.
Détermination du champ de recherches
Nous étudions donc l’architecture et l’urbanisme (comme hier la peinture et la sculpture) dans leurs époques de crise :
- Crise de l’architecture confrontée à la société industrielle ;
- Crise de l’urbanisme confronté à l’explosion démographique ;
- Crise du fonctionnalisme confronté à l’actuelle prospective architecturale ;
- Et, dans nos recherches en cours, crise de la prospective architecturale confrontée à la pratique de la vie quotidienne.
Jean Laude, dans La Peinture française et l’art nègre écrit : « Ce qui est important dans la radio ou la télévision, la voiture ou l’avion, c’est moins l’appareil lui-même — quelle que soit la forme qui lui est conférée — que les transformations qu’ils opèrent dans notre vie. Qui voyage en avion ou en automobile, se sert quotidiennement du téléphone, écoute sa radio ou regarde un écran de cinéma ou de télévision n’a plus — et ne peut plus avoir — les mêmes conceptions du temps et de l’espace qu’un homme du XIXe siècle ; de l’espace et du temps, il n’a plus les mêmes expériences vécues. »
« Les appartements populaires d’HLM sont, on le sait, la réduction au minimum de l’appartement bourgeois du Second Empire. »
Siegfried Giedion et Le Corbusier ont des constatations semblables pour l’architecture et pour l’urbanisme. Or, nous vivons dans des appartements dont l’espace à vivre est le même (miniaturisé) que sous Napoléon III et Haussmann. Les appartements populaires d’HLM sont, on le sait, la réduction au minimum de l’appartement bourgeois du Second Empire. Nous pratiquons donc, simultanément, deux espaces vécus : un espace machiniste quotidien, de la fin du XXe siècle, et un espace habité du XIXe siècle. D’où un certain malaise… certain.
Problèmes de méthodes
Devons-nous vous parler maintenant des méthodes auxquelles nous nous sommes trouvées affronter. Il y a certes plusieurs manières de lire, de décoder, l’architecture : la lecture historique classique, la lecture esthétique, la lecture idéologique, la lecture scientifique.
Si nous avons demandé à M. Teyssèdre de patronner notre travail c’est parce que l’un de ses buts est (ou a été) de trouver une issue au schisme français entre l’histoire de l’art et la réflexion sur l’art. Car notre histoire de l’architecture et de l’urbanisme est à la fois histoire des idéologies et des pratiques & histoire de l’affrontement entre ces idéologies et ces pratiques. Car notre histoire refuse aussi la ségrégation entre l’esthétique et la pratique qui fut de mise dans la plupart des histoires classiques de l’architecture.
Nous savons ce que notre travail a d’ambitieusement démesuré. Pour écrire cette histoire idéale de l’architecture et de l’urbanisme, dont nous rêvons, il faudrait être à la fois historien, géographe, esthéticien, sociologue, écologiste, politologue, technicien du domaine bâti. Ambition bien au-dessus de nos moyens. Néanmoins nous avons tenté d’accéder à un maximum de connaissance les plus diverses, d’informations les plus hétéroclites, (et notre dette est grande envers les architectes et les ingénieurs qui ont bien voulu [nous renseigner]) pour tenter de cerner le domaine immense de l’aménagement de l’espace. Car l’espace habitacle est indissolublement lié à l’espace urbain ou rural, lui-même dépendant de l’aménagement général du territoire. Et les espaces intermédiaires, les espaces interstitiels, entre le privé et le public, ces espaces négligés par tant d’architectes contemporains, espaces à vivre, espaces vécus eux-aussi entre l’intérieur et le dehors, espaces élastiques, difficilement repérables, ne sont pas moins importants que la chambre à coucher et l’agora. Bien des névroses viennent de ce que ces espaces de transition n’ont pas été étudiés par des architectes doublés de psychologues.
« Bien des névroses viennent de ce que ces espaces de transition n’ont pas été étudiés par des architectes doublés de psychologues. »
Par ailleurs, si nous comparons l’historien de l’architecture à l’historien d’art, nous voyons que le premier diffère du second ne serait-ce seulement que par rapport à l’approche des sources. L’historien de l’architecture se trouve en effet toujours en butte à des problèmes de sources et de repères parfois insurmontables. Il n’existe pas de dépôt légal des plans d’architecture et d’urbanisme grâce auquel on pourrait étudier l’évolution d’une étude, depuis le premier croquis de l’architecte créateur jusqu’aux corrections apportées par les différentes commissions, corrections telles que le résultat construit n’a souvent qu’un très lointain rapport avec le projet initial. Imagine-t-on une œuvre littéraire où chaque lecteur d’une maison d’édition apporterait sa censure et ses propositions, où à chaque étape de la fabrication du livre chacun retrancherait, ajouterait, modifierait à son gré. Tel est pourtant le destin de la plupart des œuvres architecturales. Que l’architecture soit un art, nul doute, mais un art bien singulier et si dépendant du politique et du financier que la censure et l’autocensure y sont chose convenue.
Ajoutons à cette confrontation de l’idée première de l’architecte à un programme, à différents programmateurs, voire à des usagers, peut être négative, mais peut aussi conduire à certains enrichissements. Une prise de conscience collective de l’œuvre architecturale se fait parfois seulement au niveau de la maquette ou du chantier. L’architecture est donc un art dont la singularité tient aussi dans ce fait qu’il s’agit d’un art collectif.
« Que l’architecture soit un art, nul doute, mais un art bien singulier et si dépendant du politique et du financier que la censure et l’autocensure y sont chose convenue. »
L’histoire de l’architecture, du fait de la difficulté d’accéder aux sources de la création même, comporte d’étranges lacunes, voire des erreurs persistantes. Le rôle de Baltard dans l’histoire de l’architecture métallique est, par exemple, tout à fait exagéré et cela au détriment du visionnaire des espaces couverts en métal et en verre qu’est Hector Horeau. Ne serait-ce que pour notre réhabilitation de Horeau, considéré au XIXe siècle comme le « Victor Hugo » de l’architecture, et qui n’avait plus qu’une citation dans toutes les histoires de l’architecture moderne, sans que l’on sache même s’il s’agissait d’un architecte ou d’un ingénieur, ne serait-ce que pour cette réhabilitation, nous serions heureux d’avoir écrit notre Histoire mondiale de l’architecture et de l’urbanisme moderne.
Mais bien d’autres lacunes restent à combler. Qui entreprendra par exemple, d’étudier les architectes saint-simoniens ? Qui fera, pour les architectes de la Révolution française, dont on sait qu’ils étaient influencés par Ledoux et Boullée, ce qu’Anatole Kopp a fait pour les architectes de la révolution soviétique ? L’histoire de l’architecture est essentiellement l’histoire des monuments, c’est-à-dire des signes du pouvoir, des pouvoirs. L’histoire des cités ouvrières, l’histoire des banlieues pavillonnaires, et l’analyse de leurs motivations, n’ont été esquissés que depuis peu. Mais on ne fait qu’entrevoir le rôle de l’automobile, ou plutôt le rôle des fabricants d’automobiles, dans l’histoire de l’urbanisme des années 1920. De même, aujourd’hui, le rôle grandissant des banquiers ne pourrait-il pas être décelé dans certains plans d’urbanisme, comme il est décelable dans la nouvelle réorganisation du marché de l’art, et par là même, des « valeurs » artistiques que l’on nous impose.
Conclusion
La dichotomie entre idéologies et pratiques est le point crucial de notre sujet. Il est significatif à cet égard, et consternant, de remarquer que nombre d’architectes qui ont voulu en toute bonne foi construire pour la masse se sont trompés. Au lieu de créer une architecture démocratique, ils ont souvent été les interprètes inconscients des pires tyrannies.
« Nombre d’architectes qui ont voulu en toute bonne foi construire pour la masse se sont trompés. Au lieu de créer une architecture démocratique, ils ont souvent été les interprètes inconscients des pires tyrannies. »
C’est une constante dans l’histoire de l’architecture que la complaisance des architectes envers le pouvoir, quel qu’il soit. L’architecte est l’artiste chargé de magnifier le pouvoir, d’imposer à tous la présence quotidienne du Prince par des monuments destinés à inspirer la crainte, le respect et l’amour du monarque. On aurait pu penser que l’avènement de la démocratie fasse éclater cette structure féodale. Mais il n’en a rien été. Chargé d’inventer une architecture pour l’homme ordinaire, l’architecte se sent perdu. Comme Charles Fourier attendait tous les jours à midi, place du Palais Royal, le financier qui lui permettrait de réaliser son phalanstère (et qui ne vint jamais), Le Corbusier attendit toute sa vie que le Pouvoir (qu’il appelait l’Autorité) lui permette de réaliser sa « ville radieuse ». Cette quête du pouvoir peut paraître à la fois irritante et puérile. Mais qui, autre que le Pouvoir (pouvoir politique ou pouvoir financier) a la faculté de décider du sort des villes, comme un module de l’habitat ? Par le biais de l’urbanisme et de l’architecture, tout pouvoir exerce donc une tyrannie insidieuse.
« Par le biais de l’urbanisme et de l’architecture, tout pouvoir exerce donc une tyrannie insidieuse. »
Nous n’en sommes plus à la tyrannie mégalomaniaque d’un Pierre le Grand à Saint-Pétersbourg ou d’un Louis XIV à Versailles, voulant l’un et l’autre édifier des architectures exprimant leur magnificence. Bien qu’encore, lorsque Kubitchek décida d’implanter la nouvelle capitale du Brésil loin de toute agglomération spontanée, et surtout loin de cette frange urbanisée le long de l’Atlantique qui, pour les Brésiliens, signifie la douceur de vivre, ne faisait-il pas acte de despotisme aussi grand que Pierre le Grand décidé à arracher la Russie à l’Asie en lui ouvrant une porte sur l’Europe par la création d’une capitale italianisante sur la Baltique.
Si l’intervention de la population n’est jamais requise par l’administration, ni par les architectes, par contre la population manifeste parfois son désaccord a posteriori. Par exemple, finalement Saint-Pétersbourg n’est pas du tout conforme au rêve de Pierre le Grand, dont le despotisme, pourtant considérable, n’a pas réussi à infléchir le destin de la ville qu’il avait créée. Le plan de l’architecte français Le Blond, approuvé par le tzar en 1716 sera en effet peu à peu abandonné pour la bonne raison que la population boudera les îles qui devaient constituer le cœur de Saint-Pétersbourg et préférera s’installer sur la riva gauche de la Neva. Malgré les interdits des Tzars, qui se poursuivront jusqu’en 1740, c’est sur la rive gauche de la Neva qu’une ville se créera d’elle-même, hors des plans initiaux. Intéressante réaction des citadins qui construisait en quelques sorte leur contre-ville, face à la ville du pouvoir, et qui s’est renouvelé de nos jours lors de la construction d’une autre capitale « artificielle » : Brasilia. Chacun sait que la partie la plus vivante de Brasilia est le bidonville, né spontanément près de la cité monumentale, mais hors des plans.
« Si l’intervention de la population n’est jamais requise par l’administration, ni par les architectes, par contre la population manifeste parfois son désaccord a posteriori. »
La participation des usagers de l’architecture (c’est-à-dire de tous les hommes) est l’objet de notre plus récente recherche. Les idéologies architecturales les plus neuves sont confrontées à de nouvelles pratiques qui semblent échapper à l’architecture, mais qui peuvent aboutir à une nouvelle conception de la ville et de l’habitat : psychologie, psychiatrie, écologie, etc. Une nouvelle idéologie se fait jour à travers certains théoriciens comme Yona Friedman : celle de l’auto-planification, sorte d’auto-gestion architecturale qui a déjà commencé à trouver certaines réponses pratiques : par exemple, « l’habitat à la carte » des frères Arsène-Henry, les diverses approches d’un habitat évolutif. Le recours à la participation des usagers dans la pratique architecturale, la formation de comités de quartiers chargés de la défense de l’environnement, les « luttes urbaines » qui se manifestent aussi bien en Amérique latine qu’en Europe, sont autant de signes avant-coureurs d’une rencontre positive entre idéologie et pratique.
« Nos villes actuelles sont, on le sait, l’émanation d’une idéologie du pouvoir financier, technocratique et bureaucratique. Mais nos villes actuelles sont aussi un théâtre où se jour une pièce de propagande visant à l’efficacité de la production et à l’intensification de la consommation. »
L’idéologie de la ville libérée, d’une ville ludique, rôde au-dessus de nos villes actuelles. Nos villes actuelles sont, on le sait, l’émanation d’une idéologie du pouvoir financier, technocratique et bureaucratique. Mais nos villes actuelles sont aussi un théâtre où se joue une pièce de propagande visant à l’efficacité de la production et à l’intensification de la consommation. Comme l’a souligné Jean Duvignaud, le théâtre est le contraire de la fête. Pas de fête dans le Versailles de Louis XIV, mais du théâtre en permanence. Les différents pouvoirs qui, toujours, détiennent la ville, se sont perpétuellement efforcés à ce que la fête n’envahisse pas la ville. Ils ont endigué la faculté ludique de la ville dans une sorte de théâtre rituel : commémorations, défilés, processions, cérémonies événementielles. La fête n’entre en ville que par effraction, et pour un temps bref, au moment des crises suprêmes : la prise de la Bastille, la Commune, Mai 68.
« Les différents pouvoirs qui, toujours, détiennent la ville, se sont perpétuellement efforcés à ce que la fête n’envahisse pas la ville. Ils ont endigué la faculté ludique de la ville dans une sorte de théâtre rituel : commémorations, défilés, processions, cérémonies événementielles. »
Si l’idéologie d’une ville libérée, d’une ville ludique rôde au-dessus de nos villes aliénées, si un slogan comme « le droit à la ville » a pu être repris par des citadins en colère dans ce qu’il faut bien appeler des « luttes urbaines », c’est-à-dire des luttes pour l’urbain, c’est que le mythe de la fin de la ville est aussi fragile que celui de la fin de l’histoire ou celui de la mort de l’art. La fin de l’histoire signifierait bien sûr la fin de la ville, puisque la ville est par excellence le lieu où se fait l’histoire. Et sans doute aussi la mort de la ville signifierait-elle la mort de l’art.
« La fin de l’histoire signifierait bien sûr la fin de la ville, puisque la ville est par excellence le lieu où se fait l’histoire. Et sans doute aussi la mort de la ville signifierait-elle la mort de l’art. »
Car la ville est une personne. La ville est un être vivant. Comme tout être vivant la ville est le lieu de la contradiction. Signe du pouvoir, certes, mais aussi lieu de la liberté, des échanges, de l’aléatoire, des contacts, de la parole. Lieu par excellence de l’utopie.
« Comme tout être vivant la ville est le lieu de la contradiction. Signe du pouvoir, certes, mais aussi lieu de la liberté, des échanges, de l’aléatoire, des contacts, de la parole. Lieu par excellence de l’utopie. »
Messieurs,
Chacune des étapes que j’ai tenté de cerner dans ce bref exposé constitue une approche. Approche du fonctionnalisme et critique de ce fonctionnalisme. Car une machine peut parfaitement être laide et tout à fait efficace. Peut être notre civilisation est-elle enfin en mesure de surmonter son complexe vis-à-vis de la machine. Et de redécouvrir que si un instrument efficace n’est pas forcément beau, un objet d’art n’est pas forcément utile. Ou, si l’on préfère, n’a pas d’autre utilité que d’être beau.
Approche des arts de l’environnement et, par là même, esquisse de ce qui pourrait redevenir un art urbain.
Approche de l’architecture comme mode de communication social. Car si la peinture et la sculpture sont des modes de communication sociale, que dire de l’architecture qui organise l’espace, justement, à la fois pour la vie privée et pour les relations entre les hommes. C’est d’ailleurs dans cette double fonction de l’architecture : espace privé fermé, espace public ouvert, que réside l’une des grandes difficultés de l’œuvre architecturale.
Et si nous avons fait un chemin qui nous a mené du credo corbuséen à la critique idéologique de Le Corbusier, nous avons néanmoins retenu de notre ancien maître qu’il ne pouvait exister de séparation entre l’architecture et l’urbanisme. Sans urbanisme, l’architecture n’est qu’un objet isolé, privé du contexte qui le rendrait vivant. Sans architecture construite, l’urbanisme demeure du domaine de la sociologie ou de la politique. L’idéologie urbanistique cesse d’être une utopie lorsqu’elle s’incarne dans un ensemble de bâtiments et de « vides » qui constitue une cité.
« Sans urbanisme, l’architecture n’est qu’un objet isolé, privé du contexte qui le rendrait vivant. Sans architecture construite, l’urbanisme demeure du domaine de la sociologie ou de la politique. »
Notre conclusion n’est pas une conclusion puisque nous débouchons sur l’ouverture nécessaire vers d’autres recherches. L’histoire continue, se fait tous les jours… Mais faire l’histoire de l’art présent, de l’architecture actuelle et, a fortiori, de l’architecture prospective, est-ce encore de l’histoire ? Mais qu’est-ce, alors ? Qu’est-ce que l’histoire qui se vit, que l’on vit et que, d’une certaine manière, par une pratique militante, on accouche ? Est-ce que la pratique des idées relève de l’histoire, ou de l’esthétisme, ou de la littérature ?
Je vous laisse, Messieurs, le soin d’en juger. Et c’est pourquoi j’ai remis, avec émotion mais confiance, le dossier de ses trente ans de travaux et d’activités entre vos mains.
Discours prononcé par Michel Ragon lors de la soutenance de sa thèse sur travaux publiés — La pratique architecturale et ses idéologies : de la Révolution industrielle à nos jours — le 14 décembre 1975 à la Sorbonne. Le jury était présidé par Marc Le Bot, et composé de Jean Duvignaud, Jean Laude, Bernard Teyssèdre (directeur) et André Wogenscky.
Nous remercions Françoise Ragon, épouse de Michel Ragon, de nous avoir fait parvenir ce texte et nous avoir autorisé à le reproduire ici. Nous précisons que le titre n'est pas l'auteur mais de l'éditeur. L’œuvre — Le Simoun — en couverture est de Jean-Michel Atlan (1913-1960), grand ami de Michel Ragon.
Bibliographie
De Michel Ragon
Le Livre de l’architecture moderne, Paris, Robert Laffont, 1958.
Où Vivrons-nous demain ? Paris, Robert Laffont, 1963.
Histoire mondiale de l’architecture et de l’urbanisme modernes, tome 1, Idéologies et pionniers, 1800-1910, tome 2, Pratiques et méthodes, 1911-1985, tome 3, Prospective et futurologie, Paris, Casterman 1971-1977, nouvelle édition revue et augmentée, Seuil, 1991.
Les erreurs monumentales, Paris, Hachette, 1971.
L’Homme et les Villes, Paris, Albin Michel, 1975.
L’Architecte, le Prince et la Démocratie, Paris, Albin Michel, 1977.
Sur Michel Ragon
Thierry Maricourt (2023), Une rage de lire : le jeune Michel Ragon, L’échappée.
André Nerval (2024), Michel Ragon. Singulier et pluriel, Albin Michel.